Rechercher : larmes blanches
Flannery O’Connor : Les braves gens ne courent pas les rues
 Mary Flannery O'Connor écrivain américaine est née en 1925 à Savannah, Georgie (Etats-Unis) et décédée en 1964 dans son vaste domaine à Milledgeville (Georgie) où sa santé fragile la condamnait à la réclusion. Elleest l'auteur de deux romans (La sagesse dans le sang ainsi que Et ce sont les violents qui l’emportent) et d’une trentaine de nouvelles.
Mary Flannery O'Connor écrivain américaine est née en 1925 à Savannah, Georgie (Etats-Unis) et décédée en 1964 dans son vaste domaine à Milledgeville (Georgie) où sa santé fragile la condamnait à la réclusion. Elleest l'auteur de deux romans (La sagesse dans le sang ainsi que Et ce sont les violents qui l’emportent) et d’une trentaine de nouvelles.
Les braves gens ne courent pas les rues est un recueil de dix nouvelles écrites entre 1953 et 1955 par lesquelles l’auteur nous plonge dans le Sud des Etats-Unis, cette région où se croisent charlatans et prédicateurs, où de petits fermiers blancs emploient des noirs, où les mentalités esclavagistes et ségrégationnistes sont encore présentes. Néanmoins travail, sueur et larmes sont le lot partagé par tous, un monde dur et âpre de vies misérables, peuplé d’hommes et de femmes ordinaires pourrait-on dire, si Flannery O’Connor ne s’ingéniait à nous faire ingurgiter la méchanceté crasse et les haines mesquines qui embrument les petits cerveaux de ses personnages. Car l’écrivain n’est pas une optimiste, elle ne s’illusionne pas sur la nature humaine, d’ailleurs le titre de l’ouvrage ne le cache pas.
Le premier texte éponyme qui débute le recueil donne le ton et m’a interloqué, surtout si on le replace dans son contexte, les années 50. Une famille quelconque, les parents, enfants et la grand-mère, part en vacances lorsqu’un accident de voiture la met en présence d’un forçat évadé avec ses complices. Avec des mots d’une rare froideur et d’une grande sobriété, O’Connor va faire assassiner toute la famille, un par un, par les malfrats. Le récit est net et sans bavure, aucune pleurnicherie ni pathos, des faits décrits tout simplement, comme si tout cela était presque naturel. En moins de trente pages vous êtes sonné, dérouté par l’écart entre l’horreur décrite et le style épuré de l’écriture.
Les autres nouvelles vous feront croiser les destins d’une sourde-muette, d’un général de cent quatre ans, d’une jeune femme cultivée ayant une jambe de bois, d’un travailleur immigré Polonais assassiné par des « gens ordinaires », une cour des miracles vivant au soleil.
Flannery O’Connor livre personnages et situations, sans fioritures et surtout sans le moindre jugement de sa part, comme une entomologiste qui observerait et décrirait une société d’insectes, le plus objectivement possible. Pourtant parfois, au détour d’un dialogue on peut imaginer que l’écrivain laisse échapper une réflexion personnelle, « ces jeunes générations de malotrus qui avaient mis le monde sens dessus dessous et bouleversé toutes les normes d’une vie décente », ou encore « Nous sommes tous damnés, dit-elle, mais quelques uns d’entre nous ont arraché leurs œillères et voient qu’il n’y a rien à voir. C’est une espèce de salut. » Mais peut-être n’est-ce qu’une impression de lecteur, mis de force face à une humanité quotidienne peu encourageante, faite de bêtise et de petites méchancetés.
Un bouquin chaudement recommandable.
« - J’suppose que beaucoup de garçons viennent vous raconter qu’ils sont étudiants, mais moi je vous dirai pas ça. En fait, je n’veux pas aller à l’Université. Je veux consacrer ma vie au service dela Foi. Vousvoyez, dit-il en baissant la voix, j’ai le cœur fatigué. Il se peut que je vive pas bien longtemps. Quand on sait qu’on n’est pas solide et qu’on peut mourir jeune, alors, madame… Il s’arrêta la bouche ouverte, et la regarda longuement. Il avait la même maladie que Joy ! Elle sentit ses yeux s’emplir de larmes mais elle se domina et dit : « Voulez-vous rester déjeuner ? Ca nous ferait plaisir », et le regretta aussitôt. »
 Flannery O’Connor Les braves gens ne courent pas les rues Folio
Flannery O’Connor Les braves gens ne courent pas les rues Folio
08/10/2012 | Lien permanent
Patrick Graham : L’Evangile selon Satan
 Une extraordinaire histoire qui court du Moyen-Âge à nos jours où le Bien et le Mal s’affrontent pour ce qui risque d’être leur dernier combat. Un complot international venu de la nuit des temps dans le but de retrouver un livre maudit, un Evangile écrit par Satan, qui ferait s’écrouler l’Eglise catholique. Religieuses atrocement mutilées dans leurs couvents par les forces du Mal pour leur faire avouer où se trouve ce livre, prélats assassinant le pape, un mystérieux assassin qui semble traverser les siècles et posséder les âmes de ses victimes, une profileuse du FBI douée de pouvoirs médiumniques et un prêtre exorciste du Vatican qui unissent leurs efforts, ce ne sont là que quelques éléments d’une intrigue qui parfois fout carrément la trouille ! L’histoire est menée tambour battant à un rythme hallucinant, en de très courts chapitres alternant les époques ou les lieux, ce qui relance la machine du suspense. Dès que vous avez lu quelques pages à peine de ce thriller vous devez faire des efforts surhumains pour en abandonner la lecture. Très vivement recommandé mais à vos risques et périls.
Une extraordinaire histoire qui court du Moyen-Âge à nos jours où le Bien et le Mal s’affrontent pour ce qui risque d’être leur dernier combat. Un complot international venu de la nuit des temps dans le but de retrouver un livre maudit, un Evangile écrit par Satan, qui ferait s’écrouler l’Eglise catholique. Religieuses atrocement mutilées dans leurs couvents par les forces du Mal pour leur faire avouer où se trouve ce livre, prélats assassinant le pape, un mystérieux assassin qui semble traverser les siècles et posséder les âmes de ses victimes, une profileuse du FBI douée de pouvoirs médiumniques et un prêtre exorciste du Vatican qui unissent leurs efforts, ce ne sont là que quelques éléments d’une intrigue qui parfois fout carrément la trouille ! L’histoire est menée tambour battant à un rythme hallucinant, en de très courts chapitres alternant les époques ou les lieux, ce qui relance la machine du suspense. Dès que vous avez lu quelques pages à peine de ce thriller vous devez faire des efforts surhumains pour en abandonner la lecture. Très vivement recommandé mais à vos risques et périls.
« Crucifiées à ses côtés, les quatre disparues de Hattiesburg la regardent. Leurs chairs putréfiées se desserrant autour des clous, Caleb a sanglé leurs carcasses pour qu’elles ne risquent pas de se détacher. A travers ses larmes, Marie contemple ces orbites creuses qui la regardent, ces visages gercés et ces lèvres aplaties que la souffrance a retroussées dans la mort. Leurs mains se sont finalement décrochées des clous. Elles pendent au bout des avant-bras retenus par les sangles. Depuis combien de temps sont-elles ainsi suspendues dans le vide ? Pendant combien d’heures se sont-elles raidies et relâchées pour échapper à la morsure des clous ? Combien de jours se sont écoulés dans cette puanteur de charnier avant que la mort ne les délivre ? »
 Patrick Graham L’Evangile selon Satan Pocket n° 13368
Patrick Graham L’Evangile selon Satan Pocket n° 13368
14/10/2012 | Lien permanent
Jean-Jacques Schuhl : Entrée des fantômes
 Jean-Jacques Schuhl, né en 1941 à Marseille, est un écrivain français. Il a reçu le prix Goncourt en 2000 pour son roman Ingrid Caven. Son quatrième ouvrage, Entrée des fantômes, est paru en 2010.
Jean-Jacques Schuhl, né en 1941 à Marseille, est un écrivain français. Il a reçu le prix Goncourt en 2000 pour son roman Ingrid Caven. Son quatrième ouvrage, Entrée des fantômes, est paru en 2010.
Le narrateur, écrivain, tente avec beaucoup de difficultés d’écrire un nouveau roman. L’inspiration le fuit, laissant la place aux souvenirs et aux fantômes envahir son esprit, réveillant le passé.
Roman qui n’appelle pas l’analyse, Entrée des fantômes doit se prendre comme une rêverie, mêlant le vrai et le faux, souvenirs et inventions, personnages réels ou de fiction. Les souvenirs, quand l’écrivain revient sur l’écriture d’Ingrid Caven, son grand succès. Ses fantômes, êtres de chair et de sang venant du cinéma, Jean Eustache, Jim Jarmusch et Raoul Ruiz les réalisateurs comme Jean-Pierre Rassam le producteur, mais aussi de la littérature avec Lafcadio (personnage de Gide) ou Troppmann (personnage de Bataille).
On lit, on se laisse emporter (ou pas, ce sont les limites d’un tel roman) par ces divagations sans queue ni tête qui ne tiennent debout que par le pouvoir du style et l’écriture fluide et élégante de Jean-Jacques Schuhl. Roman de la nuit, vaguement branché, usant du name dropping, mais pas tant que je le craignais avant d’ouvrir ce livre, l’écrivain sait aussi nous passionner en jouant avec les mots et leur sonorité et nous intéresser par ses considérations sur le métier d’acteur ou ses réflexions à propos des gestes qui amèneraient les mots, « Je me revois à mon bureau comme si j’y étais, sept huit dix fois en train de ramasser et d’enrouler et de réenrouler à mon poignet une chaîne absente, afin de faire venir les mots, trouver la phrase précise… »
Roman ou autoportrait, les deux c’est selon, moderne mais pas creux, « morbide chic » d’après le narrateur qui ailleurs en convient « Un thème ? oui vaguement mais, tu sais bien, c’est un prétexte pour faire des images, jouer avec les mots, faire revenir quelques morts… » Un roman comme un film, à moins que ce ne soit l’inverse, Jean-Jacques Schuhl use de sa plume comme d’une caméra, pour faire son cinéma.
« … du rire, des larmes, de l’action, un peu de réflexion quand même, pas trop… une vie… n’oublie pas la vie, Charles… tu oublies trop souvent… remets les pieds sur notre belle planète bleue. Ah ! ah ! ah !... Et puis une femme, faut une femme, Carlito, n’oublie pas ça quand même, sans ça tintin pour le Goncourt. Ah ! ah ! ah ! Quoi encore ? Ah oui, ce qui est toujours bien c’est de les faire voyager les gens… les faire rêver… du rêve, Charles, n’oublie pas le rêve, mais ça tu connais, le rêve, hein ? les beaux voyages, New York, Rome… le cinéma… une actrice ou une grande chanteuse peu importe… comme tu veux… Ah ! ah ! ah ! Mais surtout, mets-moi dedans !! Ca vaut le coup ! »
 Jean-Jacques Schuhl Entrée des fantômes Gallimard - 143 pages -
Jean-Jacques Schuhl Entrée des fantômes Gallimard - 143 pages -
16/05/2014 | Lien permanent
Colum McCann : La Rivière de l’exil
 Colum McCann, né en 1965 à Dublin, est un écrivain Irlandais. Son père, un ancien joueur de football professionnel était également éditeur, éveillant un goût pour les livres chez le jeune Colum. Après des études de journalisme, il travaille comme rédacteur pour l'Evening Herald puis devient correspondant junior pour l'Evening Press de Dublin dans les années 1980. À l'âge de 21 ans il décide de se rendre aux États-Unis y multipliant les petits boulots avant de partir vivre au Japon puis à New York où il vit aujourd'hui. Paru chez nous en 1998 son roman, Les Saisons de la nuit, fut un succès colossal. La Rivière de l’exil, datant de 1999, est un recueil de douze nouvelles.
Colum McCann, né en 1965 à Dublin, est un écrivain Irlandais. Son père, un ancien joueur de football professionnel était également éditeur, éveillant un goût pour les livres chez le jeune Colum. Après des études de journalisme, il travaille comme rédacteur pour l'Evening Herald puis devient correspondant junior pour l'Evening Press de Dublin dans les années 1980. À l'âge de 21 ans il décide de se rendre aux États-Unis y multipliant les petits boulots avant de partir vivre au Japon puis à New York où il vit aujourd'hui. Paru chez nous en 1998 son roman, Les Saisons de la nuit, fut un succès colossal. La Rivière de l’exil, datant de 1999, est un recueil de douze nouvelles.
Bien que la nouvelle soit un genre différent du roman, Colum McCann s’en sort au moins aussi bien. On retrouve sa langue somptueuse où chaque phrase fait sens. Précision des mots et du vocabulaire mais aussi ellipses pour mettre le lecteur en danger, l’obliger à reprendre sa lecture pour s’assurer qu’il a bien compris le sens de la narration. Prose bien sûr mais poésie sous-jacente quand les mots forment des images qui évoquent des sensations ou des impressions. L’écrivain maîtrise parfaitement son art, faisant de chacune des nouvelles de ce recueil, un petit bijou littéraire.
Comme toujours avec ce type d’ouvrage, il faut faire une pause entre chaque nouvelle. Laisser un temps de décantation, digérer les émotions induites par le texte, la folie ou la maladie, la solitude comme le deuil, avant de s’attaquer à l’histoire suivante.
L’eau qui coule est toujours de l’eau mais n’est pourtant jamais la même, La Rivière de l’exil en est une nouvelle preuve. Douze textes, tous différents les uns des autres, mais tous nous parlent plus ou moins directement d’expatriés, l’un est argentin à San Francisco, l’autre japonais en Irlande, nombreux sont irlandais partis aux Etats-Unis, à moins qu’il ne s’agisse d’exilés d’eux-mêmes, abandonnés par la raison. Des personnages quelconques et anonymes au milieu d’une foule, mais des destins uniques superbement composés, le temps de quelques pages rédigées par un grand écrivain. Au fil des textes vous croiserez, une femme qui toilette sa sœur morte, un type qui découvre que sa femme est stripteaseuse dans la journée, un jeune garçon en fauteuil roulant, un assassin qui a peur dans le noir, une femme aveugle qui épouse un vétéran du Viêt-Nam paralytique…
Dans Une enfant volée, McCann cite cet extrait d’une poésie, « Car le monde est plus rempli de larmes que tu ne peux le comprendre » un crédo qu’il s’efforce justement de nous expliquer à travers son œuvre.
 Colum McCann La Rivière de l’exil Belfond
Colum McCann La Rivière de l’exil Belfond
Traduit de l’anglais (Irlande) par Michelle Herpe-Voslinsky
21/08/2013 | Lien permanent
Caryl Férey : Les Nuits de San Francisco
 Caryl Férey, né en 1967 à Caen, est un écrivain français spécialisé dans le roman policier. Après avoir grandit en Bretagne près de Rennes, il parcourt l'Europe à moto, puis fait un tour du monde à 20 ans. Il travaille notamment pour le Guide du routard. Un premier roman en 1994 avant que d’autres suivent. Les Nuits de San Francisco qui date de 2014 vient d’être réédité en poche. Pas vraiment un roman, plutôt une novella.
Caryl Férey, né en 1967 à Caen, est un écrivain français spécialisé dans le roman policier. Après avoir grandit en Bretagne près de Rennes, il parcourt l'Europe à moto, puis fait un tour du monde à 20 ans. Il travaille notamment pour le Guide du routard. Un premier roman en 1994 avant que d’autres suivent. Les Nuits de San Francisco qui date de 2014 vient d’être réédité en poche. Pas vraiment un roman, plutôt une novella.
Sam est un Sioux qui a pas mal bourlingué. Après avoir connu la misère dans sa réserve il a tenté sa chance à droite et à gauche, comme un boulot dans le bâtiment à Las Vegas mais la crise l’a exilé plus à l’Ouest et il se retrouve à San Francisco, noyant dans l’alcool sa détresse. Un soir, il croise une femme avec une prothèse à une jambe, Jane, elle aussi en a bavé. Ils auront droit à une nuit d’errances pour s’accorder quelques heures d’une sorte de bonheur… ?
Le texte étant très court, mon billet se doit de l’être aussi. L’histoire semble connue, voire banale et ce n’est pas faux. Pourtant, Caryl Férey réussit à la magnifier ; je ne sais pas trop comment à vrai dire, l’écriture ne m’a pas paru exceptionnelle, les misères de Sam et de Jane sont du domaine du déjà lu, l’alcool pour l’un, viol, enceinte, accident de voiture et maintenant dope... pour elle.
Pour autant, j’ai trouvé tout cela très beau, si je peux dire. Nous assistons au destin tragique de deux âmes en peine qui partageront une nuit, non pas d’amour dans le sens sexuel du terme, mais de réconfort mutuel dans les bras l’un de l’autre. Pour d’autres ce ne serait pas grand-chose, mais pour nos deux cabossés de la vie, Sam et Jane c’est énorme. « Nos destins sont liés : c’est la nuit qui nous a réunis » déclare Jane à Sam. Liés à la vie à la mort.
Un bien beau petit roman qui a su me toucher.
« Le Sioux ruminait sur le sort des petits cailloux perdus au fond de lui, quand une silhouette apparut dans son angle mort. Elle passa à sa hauteur, et Sam ressentit comme une décharge dans le cœur. La table voisine l’empêcha de la voir en entier : le temps de relever la tête elle était déjà de profil, chaloupant sa croupe au fil de l’air et du temps qui courait à sa suite. Une silhouette féminine, émouvante, qui l’espace d’un instant le ramenait à des plaies heureuses. Sam se revit enfant, regardant sa mère se baigner, son père encore fier à ses côtés, ado sautant plus tard dans la même rivière, amoureux – Shirley « Petit Nuage », une fille de la bande… Des larmes oubliées lui montèrent aux yeux, qui déjà n’y voyaient à moitié plus rien : d’où sortait cette apparition ? »
 Caryl Férey Les Nuits de San Francisco Folio – 105 pages –
Caryl Férey Les Nuits de San Francisco Folio – 105 pages –
09/11/2017 | Lien permanent
Jonathan Tropper : C’est ici que l’on se quitte
 Jonathan Tropper, né en 1970 à New York dans le Bronx, est un écrivain, scénariste et producteur américain. Auteur de cinq romans, C’est ici que l’on se quitte le quatrième, date de 2009.
Jonathan Tropper, né en 1970 à New York dans le Bronx, est un écrivain, scénariste et producteur américain. Auteur de cinq romans, C’est ici que l’on se quitte le quatrième, date de 2009.
Le père vient de décéder des suites d’une longue maladie, « sa mort, en réalité, est donc moins un évènement que l’ultime épisode d’une triste histoire ». Ses enfants reviennent dans la maison familiale, auprès de leur mère, satisfaire au rituel juif de la shiv’ah - nom de la période de deuil observée dans le judaïsme par sept catégories de personnes pendant une semaine à dater du décès d'une personne auquel ces personnes sont apparentées au premier degré -, « ça ressemble à une veillée, sauf que ça dure sept jours et qu’il n’y a pas d’alcool ». Judd, le narrateur, y retrouve ses deux frères et sa sœur, ainsi que leurs conjoints.
Sept jours qui vont sembler long à Judd car si dans cette famille excentrique on s’aime, on s’aime surtout quand on ne se voit pas. Cette semaine va donc ranimer pour notre héros de vieux souvenirs d’enfance puis d’adolescence, d’où ces flashbacks perpétuels. Entre le passé et le présent, une constante : la sexualité qui semble l’élément moteur pour chacun des acteurs.
Et quand débarque Jen, l’ex-femme de Judd en cours de procédure de divorce pour lui annoncer qu’elle est enceinte de lui, le roman tourne au théâtre de boulevard avec portes qui claquent, compteur électrique qui disjoncte et éclats de voix dans la baraque. Ajoutons à ces engueulades familiales un empilage de situations abracadabrantes et le désintérêt croit à mesure que l’on s’enfonce dans cette lecture qui n’en finit pas.
Conclusion : le bouquin n’est pas franchement mauvais, il serait même souriant (si on n’est pas trop difficile) en général, mais il est surtout beaucoup trop long pour si peu à dire. Il y a donc un point sur lequel je suis en phase avec Jonathan Tropper, c’est ici que l’on se quitte pour toujours !
« Les visiteurs ne cessent d’affluer, vieux amis, parents éloignés, les nouveaux succédant aux anciens, en douceur, l’air sombre et mal assuré en entrant, puis ressortant satisfaits et rassasiés. A présent, nous ne les voyons plus comme des individus, mais comme une masse de touristes compatissants, qui boit du café, mastique des bagels, et sourit, les larmes aux yeux. Nous, les endeuillés, nous sourions aussi, hochons la tête, et tenons des conversations en boucle, tandis que nos pensées s’évadent ailleurs, hors de notre corps. »
 Jonathan Tropper C’est ici que l’on se quitte 10-18 - 390 pages –
Jonathan Tropper C’est ici que l’on se quitte 10-18 - 390 pages –
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Carine Chichereau
24/08/2018 | Lien permanent
Don Winslow : Missing : New York
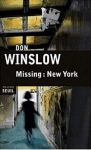 Né en 1953 à New York, Don Winslow a été comédien, metteur en scène, détective privé et guide de safari. Il est l'auteur de nombreux romans dont plusieurs ont été adaptés par Hollywood. Après avoir vécu dans le Nebraska et à Londres, Don Winslow s'est établi à San Diego. Missing : New York, date de 2014.
Né en 1953 à New York, Don Winslow a été comédien, metteur en scène, détective privé et guide de safari. Il est l'auteur de nombreux romans dont plusieurs ont été adaptés par Hollywood. Après avoir vécu dans le Nebraska et à Londres, Don Winslow s'est établi à San Diego. Missing : New York, date de 2014.
Une petite ville du Nebraska. Hailey Hansen, une gamine Afro-américaine est enlevée. Branle-bas de combat pour les équipes de police dirigées par Frank Decker. Les mois passent sans aucun résultat au grand désespoir de Decker qui donne sa démission pour se consacrer entièrement à la mission qu’il s’est donnée et respecter sa parole donnée à la mère, retrouver la fillette. Une année passée à sillonner les Etats-Unis jusqu’à ce qu’une double piste, enfin, l’envoie vers New York…
C’est le premier roman de l’écrivain que je lis, attiré par sa renommée. Bah… si c’est ça Winslow pas de quoi en faire une tartine ! Ce n’est pas franchement mauvais mais enfin c’est d’un quelconque total. Pour être aimable je dirais que ce n’est pas trop mal écrit, le rythme est alerte ; il n’y a pas de digressions qui nous font perdre notre temps et la désagrégation du couple du flic ne tombe pas dans le lourdingue comme souvent. C’est tout ce que j’ai noté de positif dans ce bouquin.
L’intrigue, elle, est archi-lue, un réseau de prostitution enfantine dans les milieux de la photo de mode et des rupins de Park Avenue… bof ! De plus, la construction n’est pas terrible, puisque le lecteur sait avant Decker que la gosse et vivante et où elle se trouve ! Si ça peut en rassurer certains, il n’y a que très peu de violence (soft) et pas de sexe. Quant à l’épilogue, il ne faut pas être à cheval sur la crédibilité des faits.
Voilà, voilà…. Ca se lit facilement, ça fait passer une poignée d’heures, pépère dans son fauteuil. Et pis c’est tout !
« - Voilà ce que je te propose, dis-je à Kelly. Je te donne le signalement, des photos et une courte interview. Tu diffuses les photos aussitôt pendant un flash infos et les deux journaux du soir. En échange, tu ne t’approches pas de la maison. – Tu mettras la mère à ma disposition ? – Ca dépend d’elle. Je voyais le tableau. Nous l’avons tous vu – trop souvent. Les parents angoissés devant les caméras et les micros, en larmes, lançant un appel à la communauté – et au ravisseur. S’il vous plaît, laissez notre enfant rentrer à la maison auprès de nous. S’il vous plaît, laissez-la rentrer à la maison. Ce qu’ils ne comprenaient pas, c’est que, par définition, un sociopathe est incapable de ressentir la douleur d’autrui. Ou pire, ça l’éclate. »
 Don Winslow Missing : New York Seuil – 303 pages –
Don Winslow Missing : New York Seuil – 303 pages –
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Philippe Loubat-Delranc
10/12/2018 | Lien permanent
Hillary Jordan : Mississippi
 Hillary Jordan est un écrivain américain. Elle a passé sa jeunesse entre le Texas et l’Oklahoma et vit actuellement à Brooklyn, New York. Deux romans à son actif et un troisième en cours d’écriture. Mississippi est le premier, paru en 2008.
Hillary Jordan est un écrivain américain. Elle a passé sa jeunesse entre le Texas et l’Oklahoma et vit actuellement à Brooklyn, New York. Deux romans à son actif et un troisième en cours d’écriture. Mississippi est le premier, paru en 2008.
Memphis, Etat du Mississippi, dans la seconde partie des années 40, après la Seconde Guerre mondiale. Laura, professeur d’anglais, issue de la moyenne bourgeoisie, a épousé à plus de trente ans, Henry ingénieur de son métier. La vie confortable qui s’annonçait pour Laura va vite être chamboulée quand Henry, sans la consulter, annonce qu’il a acheté une ferme dans un bled du Delta ; victime d’une arnaque le couple et leurs deux petites filles vont devoir vivre dans une masure sans eau courante, ni électricité, et cohabiter avec Pappy, le père d’Henry, un ignoble personnage. Hap, un métayer Noir travaille sur la ferme tandis que Florence, sa femme, aide au ménage et fait office de sage-femme pour le voisinage. D’Europe, où la guerre s’achève, reviendront au pays, Jamie, frère cadet d’Henry, pilote de bombardier, ainsi que Ronsel, fils de Hap et Florence, qui servait dans les blindés. Quand débute le roman, on enterre Pappy à la sauvette…
Roman choral, chaque chapitre donne la parole à l’un des acteurs de ce drame pour tenter d’expliquer les raisons, les enchainements de faits, qui aboutiront au meurtre de Pappy et aux tragiques évènements connexes. Tragique, dramatique, ces mots sont trop faibles pour décrire ce que relate ce roman. Lecteur, toi qui t’engageras dans ce terrible ouvrage, sache que tu vas connaitre comme ses acteurs, la déception quand Laura découvrira le cadre de sa nouvelle vie et le poids accablant de la présence permanente du beau-père qui sème la terreur, « il aimait juste savoir qu’elle avait peur de lui », les amours interdites quand Jamie de retour du front, traumatisé et alcoolique, recueilli par Henry, apportera une note de gaité dans la maison et le cœur de Laura.
Pourtant tout cela n’est rien, en comparaison avec le sort réservé à Ronsel. En Europe, malgré les horreurs de la guerre, la vue des camps de concentration, le jeune homme a goûté au bonheur, celui d’être un homme Noir pouvant vivre avec des Blancs et des Blanches, sans être rejeté. Son retour au pays n’en sera que plus difficile dans cet état Sudiste où règne la ségrégation raciale, dans ce bled où une petite bande d’affiliés au Ku Klux Klan entend faire sa loi.
Sans jeu de mot malvenu, le roman est épouvantablement noir, le racisme y est effroyable et sous toutes ses formes : chez Henry, il s’agit d’un racisme de tradition locale et - si j’ose dire – sans plus, les Blancs d’un côté, les Noirs de l’autre, tandis que chez Pappy il est plus virulent, violent et bestial, comme chez ses amis à cagoule blanche.
La technique du roman choral donne une force inouïe au texte, chacun exprimant ses propres souffrances et ses craintes. Laura bien sûr mais Florence, femme de caractère et mère elle aussi, Jamie le cadet torturé psychologiquement par la guerre et surtout par l’éducation reçue de son père, Ronsel qui paiera physiquement le prix de son émancipation vis-à-vis des Blancs… Tout sonne parfaitement juste, c’est très joliment écrit (quel étrange – mais très réel - qualificatif pour ces horreurs insoutenables !) et le lecteur, témoin impuissant autant qu’exaspéré, ne peut que voir venir l’irrémédiable.
Un très bon roman.
« On peut raconter ce qu’on veut, honnête ou pas, pour moi, la sueur sent toujours la sueur. Ca n’avait pas l’air de déranger Henry, mais personnellement je ne m’y suis jamais habituée. Je repensais à ma petite salle de bains sur Evergreen Street avec une nostalgie étourdissante. J’avais trouvé tout naturel d’en disposer, j’avais même ronchonné à l’occasion contre le manque de pression et les éclats sur la porcelaine de la baignoire. A présent que je me débrouillais d’un seau d’eau froide pour faire des toilettes de chat dans la cuisine, cette petite salle de bains me paraissait le comble du luxe. »
 Hillary Jordan Mississippi Belfond - 361 pages –
Hillary Jordan Mississippi Belfond - 361 pages –
Traduit de l’américain par Michèle Albaret-Maatsch
11/08/2016 | Lien permanent
Sue Burke : Semiosis
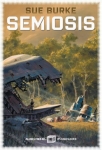 Sue Burke, née en 1955 à Milwaukee (Wisconsin), a travaillé comme journaliste et éditrice pour de nombreux journaux et magazines. Longtemps installée à Madrid elle vit désormais à Chicago. Semiosis, est son premier roman.
Sue Burke, née en 1955 à Milwaukee (Wisconsin), a travaillé comme journaliste et éditrice pour de nombreux journaux et magazines. Longtemps installée à Madrid elle vit désormais à Chicago. Semiosis, est son premier roman.
En 2065. La Terre est devenue invivable, un groupe d’une cinquantaine de colons envoyés dans l’espace à la recherche d’une planète où tout recommencer atterrit sur Pax. La gravité est importante mais les conditions de vie paraissent satisfaisantes même si les dangers sont nombreux, les pertes en vies humaines conséquentes et les surprises qui les attendent innombrables… Le récit va s’étaler sur une centaine d’années où nous suivrons plusieurs générations d’humains décidés à reconstruire un environnement autre que celui abandonné sur leur ancienne planète.
Pour évacuer immédiatement le sens du titre de ce roman et vous fournir quelques indications sur son contenu profond, la sémiologie est une science qui étudie la vie des signes (langues, codes, signalisations etc.) au sein de la vie sociale.
Le plus étonnant pour nos colons et le lecteur, ce sont la faune et la flore de cette planète, et là il faut saluer l’inventivité de Sue Burke. Pour la faune, citons par exemple, de dangereux aigles vivant en bandes et qui font rôtir leurs proies avant de les manger, les fippochats (une variante du chat que je vous laisse découvrir) etc. Quant à la flore – point essentiel dans ce roman – c’est une extrapolation bien venue des idées et découvertes concernant le monde végétal qui circulent actuellement un peu partout : la communication entre les arbres et les plantes, leurs extraordinaires pouvoirs de lutte contre les nuisibles ou maladies, leurs liens donnant/donnant avec la faune… Ici, les premiers colons devront affronter les lianes blanches, puis plus tard le bambou qui s’avèrera un élément/personnage central du bouquin.
Les colons vont s’apercevoir que le bambou est le véritable maître de la planète, grâce à son réseau racinaire qui s’étend pour ainsi dire à l’infini et par sa capacité à réguler à travers ses racines des flux chimiques modifiables à volonté, il peut dialoguer ou forcer les autres plantes à lui obéir ; de là à en faire autant avec les humains par le biais de ses fruits, il n’y avait qu’un pas que l’auteure franchit hardiment. Les hommes et le bambou après de multiples événements vont finir par dialoguer, nommer la plante Stevland et en faire au final l’un des co-leaders de leur groupe. Et il faudra toute la science et les pouvoirs de ce végétal pacifiste pour résister à l’attaque des Verriers - ancien peuple mi-insecte/mi-humain de la planète ayant perdu ses connaissances technologiques avancées - décidés à exterminer les colons.
Telles sont les grandes lignes de ce roman où les événements dramatiques et plus surprenants les uns que les autres s’enchaînent à un bon rythme car si l’extérieur est plein de danger, tous les colons ne vivent pas en harmonie absolue et leur mode de vie a bien évolué au fil des décennies… de plus on notera que les femmes (humaines ou pas) tiennent la majorité des rôles importants.
Le roman est très documenté, l’auteure ne lésine pas sur les détails touchant la nouvelle organisation sociale des humains, le mode de vie des animaux et de la végétation, les moyens de communication des uns et des autres entre eux puis avec les espèces opposées, d’où le titre du livre.
Conclusion en deux temps : Oui c’est un bon roman mais ne tombons pas non plus dans un excès d’enthousiasme. Le point fort c’est son inventivité comme je l’ai déjà dit et ses rebondissements, la surprise ou l’étonnement surgissant à chaque ligne. Mais il y a aussi quelques petites longueurs, des points pas très clairs ou inexpliqués. Ca, se sont les remarques objectives.
Reste l’angle subjectif qui fera qu’on aime ou pas le livre : Sue Burke surfe sur les idées à la mode ou dans l’air du temps, le péril écologique sur Terre et le rêve à la Elon Musk, notre connaissance plus précise de la vie secrète des plantes, le tout plaidant pour un message de paix et de fraternité, laquelle inclut bêtes et plantes. Difficile de critiquer un bouquin qui glorifie des vertus positives.
« A présent, je porte des fruits qui plaisent aux étrangers et les gardent en bonne santé – un équilibre complexe entre le plaisir et l’utilité. Ils me donnent de l’eau et des nutriments, dressés comme des fippochats par les lianes blanches, mais ils sont bien plus forts que des fippochats car, comme les premiers étrangers, ils font des plantes et des animaux leurs serviteurs. Par exemple, les tulipes recherchent la domestication, leur intelligence infime les pousse à se soumettre ; je les ai encouragées ainsi que d’autres à servir les étrangers, et j’ai protégé leurs cultures de plantes concurrentes. »
 Sue Burke Semiosis Albin Michel – 435 pages –
Sue Burke Semiosis Albin Michel – 435 pages –
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Florence Bury
01/06/2020 | Lien permanent | Commentaires (4)
Louis-Philippe Dalembert : Milwaukee blues
 Louis-Philippe Dalembert, né en 1962 à Port-au-Prince (Haïti) est un écrivain d'expression française et créole. De formation littéraire et journalistique, il travaille comme journaliste d'abord dans son pays natal avant de partir en 1986 en France poursuivre des études qu'il achève par un doctorat en littérature comparée et un diplôme de journalisme. Louis-Philippe Dalembert a enseigné dans plusieurs universités aux Etats-Unis et en Europe. Son dixième et dernier roman à ce jour, Milwaukee blues, date de 2021.
Louis-Philippe Dalembert, né en 1962 à Port-au-Prince (Haïti) est un écrivain d'expression française et créole. De formation littéraire et journalistique, il travaille comme journaliste d'abord dans son pays natal avant de partir en 1986 en France poursuivre des études qu'il achève par un doctorat en littérature comparée et un diplôme de journalisme. Louis-Philippe Dalembert a enseigné dans plusieurs universités aux Etats-Unis et en Europe. Son dixième et dernier roman à ce jour, Milwaukee blues, date de 2021.
Un roman construit à partir de deux drames, le lynchage d’Emmett Till (1941-1955) dans le Mississipi par deux frères qui seront acquittés avant qu’ils n’avouent bien plus tard leur acte, certains de leur impunité ne pouvant être condamnés deux fois pour un même crime. Et plus récemment, la mort de George Floyd en 2020 victime de violences policières à Minneapolis (Minnesota).
Le roman relate la courte vie d’Emmett, un jeune Noir qui veut se sortir du ghetto par le biais du sport en obtenant une bourse pour une université et accéder ensuite au football professionnel. Un rêve qui n’aboutira jamais.
Le roman se découpe en trois parties et les deux premières sont particulièrement bien troussées par l’écrivain car judicieusement conçues : le drame a déjà eu lieu et les chapitres font défiler ceux qui l’ont bien connu, chacun donnant son point de vue et les relations qu’il entretenait avec Emmett. Son institutrice (blanche) qui s’était prise d’affection pour le gamin, une amie d’enfance amoureuse/sœur du jeune homme, un pote dealer ; puis son coach sportif à l’université et nous apprenons qu’un premier drame l’a fortement marqué, gravement blessé lors d’un match, la carrière ambitionnée doit s’arrêter là. Sa fiancée (blanche) intervient aussi etc.
Les deux tiers du roman sont vraiment plaisants à lire - même si le sujet est grave – car chaque intervenant ou presque, s’exprime dans son langage pittoresque, s’adressant directement au lecteur. L’humour n’est pas absent et c’est vraiment très bien.
La dernière partie change de ton. Finis les dialogues en continu, on entre dans le plus émouvant. Le meurtre vient d’avoir lieu, le policier assassin donne son point de vue sur cette mort, la pasteure Ma Robinson organise les funérailles avec la famille, son magnifique sermon tentant d’apaiser les tensions qui montent, la marche digne et puissante de cette communauté qui relève la tête et crie « assez ! »
Un très beau roman, ne cherchant jamais à forcer sur l’émotion du lecteur, les faits se suffisent à eux-mêmes. Et si Ma Robinson a foi dans des jours meilleurs à venir, le lecteur perplexe, se demande si ces jours viendront … ? « I have a dream »
« « As-tu déjà vécu, ne serait-ce qu’un instant, en étant obligée de raser les murs ? me dit-il. Pas parce que les autres te le commandent avec des mots, mais par leur regard. A chaque coup d’œil, ils te font sentir que t’as pas le droit d’être là. Alors, pour éviter ces regards assassins, tu rases les murs. T’exiges rien, tu revendiques rien. Tu prends l’habitude d’être transparent, d’être une ombre. De pas faire de vague pour ne pas être remarqué, car t’es pas à ta place. » C’est la leçon que sa mère lui enseigna en fin d’après-midi, de retour à la maison. »
 Louis-Philippe Dalembert Milwaukee blues Sabine Wespieser Editeur - 281 pages -
Louis-Philippe Dalembert Milwaukee blues Sabine Wespieser Editeur - 281 pages -
28/02/2022 | Lien permanent | Commentaires (4)


