Rechercher : les grands cerfs
Pavel Sanaïev : Enterrez-moi sous le carrelage
 Né à Moscou en 1969, Pavel Sanaïev est un réalisateur, scénariste et écrivain russe. Enterrez-moi sous le carrelage, son premier roman (2003), a été traduit chez nous en 2009.
Né à Moscou en 1969, Pavel Sanaïev est un réalisateur, scénariste et écrivain russe. Enterrez-moi sous le carrelage, son premier roman (2003), a été traduit chez nous en 2009.
Sacha, le narrateur, est un gamin à la santé fragile qui vit chez ses grands-parents depuis quatre ans, depuis que sa mère s’est remise en ménage avec « un nabot buveur de sang » selon les dires de sa mémé Nina. Une grand-mère forte en gueule, grossière dans son langage, menant à la baguette son entourage.
Récit de cette époque de son enfance, le môme nous la fait revivre à travers une dizaine de textes contant chacun un épisode de sa vie chaotique. Atteint de mille maladies, au point qu’on s’interroge sur la véracité de toutes, Sacha doit accepter contraintes et avaler potions sous l’œil sévère de la mémé qui appelle son petit-fils, « ce salaud ». Quasi interdit d’école, surveillé constamment, le gosse lui n’a qu’un rêve, passer une journée entière avec sa maman qu’il ne voit guère souvent.
Roman truculent et burlesque, tout en exagérations et propos outranciers proférés par Nina qui critique tout et tout le monde, du matin au soir. Ce que nous appellerons « l’âme slave ». Pourtant sous la rudesse de la bonne femme on devine l’amour porté à Sacha, mais il est bien caché et d’un type très particulier ! C’est aussi ce caractère de cochon qui éloigne la mère de son enfant, les deux femmes se querellant sans cesse quand elles sont à portée de voix l’une de l’autre.
Je n’ai pas grand-chose à dire de ce roman car il n’est ni mauvais ni incontournable. Il est souvent amusant, genre souriant, tendre parfois mais il y a aussi des longueurs… Et qu’en retenir ? « La fête avait ses règles, la vie avait les siennes », une fatalité qui rendrait incompatible la vie et le bonheur ? Finalement, sous l’humour, un bouquin pas si marrant que cela…
« Je m’appelle Sacha Savéliev. Je suis en CM1 et je vis avec ma grand-mère et mon grand-père. Maman m’a échangé contre un nabot buveur de sang et a accroché une lourde croix au cou de grand-mère. Et j’y suis pendu depuis l’âge de quatre ans. J’ai décidé de commencer par le récit de mon bain. Sachez que ce sera une histoire intéressante. Le bain chez grand-mère relevait d’une importante procédure : vous allez en être convaincus. »
 Pavel Sanaïev Enterrez-moi sous le carrelage Les Allusifs – 266 pages –
Pavel Sanaïev Enterrez-moi sous le carrelage Les Allusifs – 266 pages –
Traduit du russe par Bernard Kreise
11/08/2017 | Lien permanent
Christophe Boltanski : La Cache
 Christophe Boltanski, né en 1962, est un journaliste, écrivain et chroniqueur. Après des études achevées en 1987 au Centre de formation des journalistes, Christophe Boltanski travaille au Progrès égyptien (dans le cadre de son service national) puis pour le quotidien Libération de 1989 à 2007 et depuis, pour le magazine L’Obs. Lauréat du prix Femina 2015 pour son roman La Cache qui vient de paraître en collection de poche.
Christophe Boltanski, né en 1962, est un journaliste, écrivain et chroniqueur. Après des études achevées en 1987 au Centre de formation des journalistes, Christophe Boltanski travaille au Progrès égyptien (dans le cadre de son service national) puis pour le quotidien Libération de 1989 à 2007 et depuis, pour le magazine L’Obs. Lauréat du prix Femina 2015 pour son roman La Cache qui vient de paraître en collection de poche.
« Que se passe-t-il quand on tête au biberon à la fois le génie et les névroses d’une famille pas comme les autres, les Boltanski ? Que se passe-t-il quand un grand-père qui se pensait bien français, mais voilà la guerre qui arrive, doit se cacher des siens, chez lui, en plein Paris, comme un clandestin ? Quel est l’héritage de la peur, mais aussi de l’excentricité, du talent et de la liberté bohème ? Comment transmet-on le secret familial, le noyau d’ombre qui aurait pu tout engloutir ? » S’interroge la quatrième de couverture en listant les thèmes abordés par ce livre.
Comme il s’agit d’un roman autobiographique, autant savoir dès maintenant que l’écrivain est le fils du sociologue Luc Boltanski et le neveu du linguiste Jean-Elie Boltanski et de l'artiste plasticien Christian Boltanski, et que sa grand-mère Myriam a publié sous le pseudonyme d’Annie Lauran. Tous ces personnages étant au cœur du bouquin.
Honnêtement, je craignais un peu en ouvrant ce livre de retomber dans du déjà lu, la persécution des Juifs durant la seconde Guerre mondiale, les planques, toutes choses épouvantables certes et qui doivent être dites et redites pour les jeunes générations d’aujourd’hui et de demain, mais dont je ne suis plus. Et puis, divine surprise, s’il s’agit bien du sujet du livre, Christophe Boltanski a trouvé l’art et la manière de le raconter de manière carrément éblouissante.
Saluons la construction de ce roman. Un récit linéaire aurait sûrement finit par ennuyer le lecteur, Boltanski propose donc une construction légèrement déconcertante (incluant des retours en arrière) qui induit une part de mystère – surtout au début du bouquin, le temps de s’y glisser et d’accepter les bizarreries de vie de la famille – et une lecture attentive pour ne pas en perdre le fil et les liens familiaux entre les uns et les autres. Parallèlement à ces astuces narratives, l’architecture du roman se calque sur celle de l’hôtel particulier, situé rue de Grenelle à Paris où vit la tribu Boltanski : un chapitre, une pièce de l’appartement. L’architecture du bâtiment proposant elle aussi une astuce au grand-père de l’auteur, car c’est dans un vide anachronique qu’il trouvera une cache minuscule pour se terrer durant vingt mois et échapper aux rafles de l’Occupation.
Ces vingt mois de planque sauveront physiquement le grand-père mais il en gardera un profond traumatisme psychologique qui s’étendra au reste de la famille. Paradoxalement, si le titre du livre fait référence à la cachette du grand-père, ce n’est pas lui le personnage central du roman mais la grand-mère, « Mère Grand », une femme à la forte personnalité, c’est le moins que l’on puisse dire. Paralysée par la poliomyélite mais menant tout son monde à la baguette, régissant son entourage, organisant les faits et gestes des uns et des autres. C’est elle qui marque ses proches, tout comme elle marquera les lecteurs par son parcours exemplaire.
J’ai évoqué la construction du roman mais l’écriture elle aussi mérite des louanges : rythmée, légère et jamais pleurnicharde, drôle parfois (le déguisement prévu par le grand-père pour fuir en zone libre !), touchante souvent.
J’ai ouvert le bouquin sur la pointe des pieds comme je l’ai dit, mais bien vite je me suis senti happé par ce scénario qui mêle souvenirs d’enfance, enquête sur le terrain (à Odessa) et supputations ; et plus le livre se rapproche de la fin, plus le texte prend de l’épaisseur.
Un très bon bouquin, tant sur la forme que sur le fond.
« Tiré de sa cachette, il fit ce qu’on attendait de lui. Il réintégra la société. Il recommença sa vie d’avant, comme si de rien n’était, sans plaintes, sans esprit de vengeance, sans rien demander à personne. Il reprit son travail et retrouva ses collègues. Le chef de service qui avait pris sa place, l’interne qui se réjouissait de le voir porter l’étoile jaune, le grand patron responsable de son expulsion. Tous ces gens estimés qui espéraient ne plus le revoir. Il ne leur fit aucun reproche. Il se contenta de les éviter en dehors de l’hôpital. Parmi ses pairs, il ne fréquentait que les parias. »
 Christophe Boltanski La Cache Folio – 329 pages –
Christophe Boltanski La Cache Folio – 329 pages –
02/02/2017 | Lien permanent | Commentaires (4)
Elisa Shua Dusapin : Les Billes du Pachinko
 Elisa Shua Dusapin, née en 1992 en Corrèze, est une écrivaine franco-coréenne vivant en Suisse romande. Fille d'un père français et d’une mère sud-coréenne, journaliste à la radio alémanique, elle grandit entre Paris et Zurich avant que sa famille s'installe, en 1995, à Porrentruy dans le canton du Jura en Suisse. Après des études littéraires, un premier roman en 2011 et ce quatrième en 2018 Les Billes du Pachinko.
Elisa Shua Dusapin, née en 1992 en Corrèze, est une écrivaine franco-coréenne vivant en Suisse romande. Fille d'un père français et d’une mère sud-coréenne, journaliste à la radio alémanique, elle grandit entre Paris et Zurich avant que sa famille s'installe, en 1995, à Porrentruy dans le canton du Jura en Suisse. Après des études littéraires, un premier roman en 2011 et ce quatrième en 2018 Les Billes du Pachinko.
Claire, la trentaine, vit en Suisse comme ses parents, mais vient passer les vacances chez ses grands-parents maternels à Tokyo. Son but, les décider à entreprendre un voyage en Corée pour revoir leur pays natal... Pour s’occuper entretemps, elle donne des cours de français à Mieko, une gamine qui vit avec sa mère.
Le roman aurait été traduit d’un texte écrit par une Japonaise, je n’aurais pas vu la différence tant il s’inscrit parfaitement dans cette littérature asiatique où prédomine le non-dit, le ressenti, les gestes qui restent en suspens. Ce genre qui peut laisser insensibles certains, n’y voyant qu’un flou artistique peu accrocheur, mais qui moi, au contraire, me séduit toujours.
Le livre est très court, l’écriture n’est même pas dense, un survol pourrait laisser à penser qu’il ne se passe pas grand-chose, et pourtant, tant de choses profondes s’y devinent ou s’esquissent pour le lecteur qui fait l’effort de se plonger dans ce très beau texte. Elisa Shua Dusapin écrit avec retenue, divulgue par petites touches discrètes des faits ou des liens entre les personnages, dans une ambiance ouatée.
Pour en revenir au propos du livre, le titre évoque le « pachinko » c’est un appareil que l'on peut décrire comme un croisement entre un flipper et une machine à sous. Le grand-père gère une boutique ou l’on s’adonne à cette distraction, à quatre-vingts ans, c’est la seule source de revenus pour le couple de vieillards. L’écrivaine nous donne avec beaucoup de tact, de nombreux détails sur la vie au Japon ou en Corée, pour ces deux exilés depuis près de cinquante ans. Sans qu’elle s’attarde, on ressent la douleur de ce qu’ont enduré ces gens.
Il est encore question des souvenirs de Claire, enfant, avec sa mère et sa grand-mère au Japon. Des liens familiaux difficiles entre chaque, pas tant pour des questions de ressentiment mais plus de communication. Car en fait, il y a beaucoup d’amour entre les uns et les autres, mais personne ne sait le dire ou l’exprimer clairement. Un des fils rouges du livre, dur dur de communiquer les uns avec les autres : que ce soit Claire avec ses grands-parents mais aussi avec la petite Mieko et la mère de la gamine. Tous paraissent introvertis, taiseux de leurs sentiments, ayant du mal à exprimer face à l’autre, amour ou amitié. Du moins comme on est habitué à le faire dans nos sociétés occidentales. Problème de culture et de langage. Tour de Babel, Claire doit aider au perfectionnement du français une gamine, elle s’exprime dans un japonais qu’elle croit excellent mais qui ne l’est pas assez pour la mère de Mieko ; la grand-mère ne veut pas parler japonais mais coréen… alors qu’elle réside à Tokyo depuis cinquante ans ! La question de l’identité peut se poser.
Je pourrais évoquer mille autres petits détails, tous sont émouvants ou touchants. Un très beau roman, très fin et subtil.
« Quand la Corée a été divisée, notre nationalité était encore celle de la Corée unifiée. On l’appelait Choson. A la séparation, le gouvernement japonais nous a autorisés à conserver l’identité coréenne, mais il fallait choisir entre le Nord et le Sud. Beaucoup ont choisi le Nord, pour leur famille, ou alors parce qu’ils estimaient que le Nord était plus proche des traditions de notre pays. On ne pouvait pas savoir comment la situation évoluerait. Ta grand-mère et moi avons choisi le Sud parce qu’on venait de Séoul. C’était l’unique raison. On ignorait tout du reste. On ne savait rien des raisons politiques, la guerre froide, la Russie, les Etats-Unis. Pour les Coréens du Japon, il n’y a jamais eu de Nord ni de Sud. Nous sommes tous des gens de Choson. Des gens d’un pays qui n’existe plus. »
 Elisa Shua Dusapin Les Billes du Pachinko Les Editions Zoé - 140 pages -
Elisa Shua Dusapin Les Billes du Pachinko Les Editions Zoé - 140 pages -
21/06/2019 | Lien permanent
Louis Guilloux : Le Pain des rêves
 Louis Guilloux (1899-1980) journaliste, natif de Saint-Brieuc, publie son premier roman en 1927 et en 1935 Le Sang noir rate de peu le prix Goncourt (raflé par Joseph Peyré avec Sang et Lumière). Ses convictions humanistes le conduiront à devenir secrétaire du 1er Congrès mondial des écrivains antifascistes et responsable du Secours Populaire. Le Pain des rêves date de 1942.
Louis Guilloux (1899-1980) journaliste, natif de Saint-Brieuc, publie son premier roman en 1927 et en 1935 Le Sang noir rate de peu le prix Goncourt (raflé par Joseph Peyré avec Sang et Lumière). Ses convictions humanistes le conduiront à devenir secrétaire du 1er Congrès mondial des écrivains antifascistes et responsable du Secours Populaire. Le Pain des rêves date de 1942.
Peu avant 1914 dans une petite ville de Bretagne. Le narrateur, un jeune enfant d’une dizaine d’années, vit dans une ancienne écurie avec sa mère Mado, son grand-père paternel et ses frères. Le père ayant abandonné femme et enfants, le grand-père fait survivre la maisonnée grâce à son métier de tailleur ou plutôt ravaudeur. Un des frères du narrateur, marin au long cours, n’est jamais là tandis que Pélo, le cadet estropié, végète dans un fauteuil. Dans ce monde de pauvreté, débarque la cousine Zabelle, venue de Toulon avec son mari, son amant, son clebs adoré… et tout va changer… !
En partie autobiographique, le roman est en deux parties. La première retrace les conditions de vie de la famille du narrateur, la seconde voit entrer en scène un personnage exubérant, la cousine Zabelle. De l’ombre à la lumière, mais toujours avec le regard d’un enfant, ce qui nous vaut un roman initiatique.
Dans cette première partie, si le lecteur adulte devine la grande détresse matérielle des protagonistes, celle-ci se trouve adoucie par le regard innocent que porte sur elle l’enfant, d’autant qu’il est un peu rêveur aux dires de son instituteur. Par contre son étonnement est grand : portraits saisissants des gens peuplant son quartier et la rue du Tonneau à la triste réputation locale, comme ce Durtail, le tonnelier qui voudrait être marin. A moins que ce ne soit de l’émerveillement devant la procession religieuse ou plus encore avec la parade du cirque ambulant (seule la parade est gratuite)… Et si l’école apporte ses moments difficiles, engueulades du maître, elle sait aussi offrir des heures enchantées.
La seconde partie, plus solaire, explose d’agitation et de surprises renouvelées avec cette Zabelle, une cousine éloignée et inconnue de l’enfant qui débarque en fanfare dans l’univers morose de nos Bretons. Avec sa petite troupe (mari, amant, chien) docile et entièrement à sa botte, elle va régenter la vie de Mado et de son fils, qui entretemps ont vu leurs conditions de vie s’améliorer un peu grâce aux bonnes œuvres d’une comtesse.
Si le roman s’achève sur une fin un peu abrupte, il n’en reste pas moins magnifique à tout point de vue. L’écriture est superbe sans être datée, ce que certains pourraient craindre au regard de sa date de parution. Mais on en retiendra surtout, l’empathie profonde de l’écrivain pour tous ses personnages, un quasi amour pour ces pauvres gens, sans jamais tomber dans le pathos dégoulinant de mièvrerie. Jamais Guilloux ne cherche à tirer une larme au lecteur, au contraire, par le biais du regard d’un enfant, il réussit à rendre la misère heureuse – si j’ose dire – car elle n’est pour lui que source d’étonnement.
Un très beau roman que j’invite tout le monde à lire.
« Quelqu’un heurtait une chaise, et dans l’instant, la lampe s’allumait. Je comprenais que ma mère s’était levée sans rien dire, qu’elle avait trouvé et remis au grand-père les allumettes, puis, s’était recouchée bien vite. Car il ne lui était pas permis d’allumer elle-même la lampe. Seul, mon grand-père avait ce droit. C’était sa lampe, elle était sacrée. La lampe de ses veillées, et des veillées de son père avant lui. Tout autant que de l’horloge il en prenait un soin pieux, mais comme si, plus encore que de la tenir en bon état, il avait dû la défendre contre les autres, c'est-à-dire contre nous-mêmes. »
 Louis Guilloux Le Pain des rêves Folio – 477 pages –
Louis Guilloux Le Pain des rêves Folio – 477 pages –
20/11/2017 | Lien permanent
Simeon Wade : Foucault en Californie
 Simeon Wade (1944-2017) a enseigné l’histoire dans plusieurs universités dans les années 1970, avant de devenir infirmier à l’hôpital psychiatrique du comté de Los Angeles puis infirmier en chef à l’hôpital du comté de Ventura (Californie). Foucault en Californie, un récit inédit depuis quarante ans, vient de paraître.
Simeon Wade (1944-2017) a enseigné l’histoire dans plusieurs universités dans les années 1970, avant de devenir infirmier à l’hôpital psychiatrique du comté de Los Angeles puis infirmier en chef à l’hôpital du comté de Ventura (Californie). Foucault en Californie, un récit inédit depuis quarante ans, vient de paraître.
Californie en 1975. Simeon Wade, maître de conférences à l’Ecole d’études supérieures de Claremont et grand admirateur du travail de Michel Foucault, se demande comment le faire venir dans sa modeste université lors de sa venue aux Etats-Unis. Au culot, Simeon et son compagnon Michael Stoneman, proposent au philosophe une expérience originale : un court séjour de deux ou trois jours dans la Vallée de la Mort sous l’emprise du LSD et surprise, le frenchie accepte !
Pour rappel : Paul-Michel Foucault dit Michel Foucault (1926-1984), est un philosophe français. Il est connu pour ses critiques des institutions sociales, principalement la psychiatrie, la médecine, le système carcéral, et pour ses idées et développements sur l'histoire de la sexualité, ses théories générales concernant le pouvoir et les relations complexes entre pouvoir et connaissance.
Cette aventure était sujette à caution, jusqu’à ce que Heather Dundas ne retrouve Simeon Wade, quasi retiré du monde et le persuade de lui confier son récit pour publication. La preuve de cette aventure étant corroborée par quelques photos (incluses dans l’ouvrage) où l’on voit Foucault – avec son fameux pull-over à col roulé blanc malgré la chaleur ! - et ses deux compagnons dans le désert californien. Le récit de Wade est complété par un court entretien entre Heather Dundas et Simeon Wade.
Pour l’auteur, il s’agissait de « voir comment l’un des esprits les plus éminents de l’histoire réagirait à une expérience inédite pour lui : absorber une dose appropriée de LSD thérapeutique dans un cadre désertique extraordinaire ». Deux jours et une nuit, dans le désert, ou le compte-rendu de ces quelques jours…
Concrètement, que contient ou révèle cet ouvrage ? Tout d’abord, sachez qu’il n’y a pas de scènes de délires psychédéliques ou de visions hallucinatoires, ce n’était pas le but du trip, mais plutôt de s’interroger sur les conséquences éventuelles d’une telle expérience sur le cerveau et le mode pensée d’un grand intellectuel. Lequel déclarera plus tard en avoir été fortement ébranlé, au point de lui faire réécrire en partie, le livre sur lequel il travaillait alors (Histoire de la sexualité).
Nous avons donc un texte très agréable à lire car très décontracté, le Grand Intellectuel, en mode cool et intime, loin du côté guindé de l’intelligentsia de cette époque. Le récit de nos trois gay lurons est une virée cultivée entre jeunes universitaires faite de conversations à bâtons rompus, sautant du coq à l’âne, Simeon et Michael avides de découvrir notre philosophe, ce qu’il pense d’untel ou de telle théorie. Leurs discussions abordent toutes les disciplines, musique, philosophie, littérature, peinture, sociologie etc. et les grands noms de ces catégories abondent, Foucault les ayant plus ou moins bien connus ou fréquentés : Pierre Boulez, Jean-Luc Godard, Jean Genet, Gilles Deleuze, Magritte, Cooper et Laing etc. un véritable annuaire.
On se délecte, d’autant que n’ayez crainte, ce n’est pas complexe à lire. Par ailleurs, c’est aussi amusant, nos deux fans transis ne rechignant pas à poser des questions saugrenues du genre «A Paris, faites vous vos courses au marché ? »
Conclusion, j’ai beaucoup aimé ce livre qui m’a rappelé les thèmes intellectuels de l’époque et mes lectures d’alors.
« On dit que la révélation de saint Jean sur l’île de Patmos a été provoquée par un champignon, l’Amanita muscaria. Le LSD est un produit chimique à la puissance analogue à celle de ces champignons. Tant de grandes inventions à l’origine de la civilisation ont été réalisées dans des sociétés qui utilisaient des champignons magiques dans leurs rituels religieux. Si cela est vrai, ai-je pensé, si les substances chimiques ont un tel pouvoir, alors que pourraient-elles bien faire au grand esprit de Foucault ? »
 Simeon Wade Foucault en Californie Zones – 142 pages –
Simeon Wade Foucault en Californie Zones – 142 pages –
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Gaëtan Thomas
Le chauve en col roulé dans la Vallée de la Mort en mai 1975
08/03/2021 | Lien permanent
Edward Abbey : Désert solitaire
Une nouvelle fois nous retrouvons Edward Abbey dans un bouquin qui magnifie le désert, son désert, le désert américain au cœur de l’Utah. Dans les années cinquante, l’auteur prend un job saisonnier de ranger dans un parc national au sud-est de l’Etat d’avril à septembre. Plusieurs années de suite il renouvellera l’expérience, tenant un journal où il y consigne ce qu’il voit et fait. C’est à partir de ce matériau que ce livre a été écrit dix ans plus tard, en 1967, et dès la préface il prévient « la plus grande partie de ce sur quoi j’écris dans ce livre a déjà disparu ou est en train, rapidement, de disparaître ». D’où l’amertume qui sue parfois au détour de quelques phrases quand il constate que le paradis terrestre n’est plus ce qu’il était. A contrario, c’est aussi cette déception qui rend ces pages plus attachantes encore. Edward Abbey nous livre ce qui aurait pu être un texte écrit par Adam après son expulsion du Paradis. Ici la nature est dure et sauvage, sublime et immense, cachant des merveilles inaccessibles au fond des canyons où seules les prouesses physiques et la volonté de l’auteur lui permettent de les entrevoir. Pour le néophyte, désert semble rimer avec rien, pourtant le bouquin regorge de noms de plantes, de pierres et d’animaux souvent peu familiers, trahissant la grande culture de l’écrivain et de l’homme de terrain. A lire avec une bouteille fraîche à portée de la main.
« C’est une chose étrange que, dans le pays canyons, plus on s’approche du fleuve, qui est l’artère vivante de toute la région, plus la terre devient sèche et nue, moins elle devient habitable. De ce point de vue, le désert du Colorado est à l’opposé de celui du Nil, en Egypte, et de celui du Rio Grande, au Nouveau-Mexique, où la vie, les hommes et les villes se regroupent sur les rives. Le long du Colorado, il n’y a aucune ville entre Moab, en Utah, et Needles, en Californie, qui en est distante de plus de mille miles. »
 Edward Abbey Désert solitaire Petite Bibliothèque Payot
Edward Abbey Désert solitaire Petite Bibliothèque Payot
08/10/2012 | Lien permanent
Cyril Hofstein : Atlas des fortunes de mer
 Historien de formation, passionné par le monde maritime et les récits de marins, Cyril Hofstein a fait ses premières armes au Chasse-Marée, avant de rejoindre Le Figaro puis Le Figaro Magazine où il est grand reporter.
Historien de formation, passionné par le monde maritime et les récits de marins, Cyril Hofstein a fait ses premières armes au Chasse-Marée, avant de rejoindre Le Figaro puis Le Figaro Magazine où il est grand reporter.
Atlas des fortunes de mer récemment paru s’inscrit dans une collection d’autres atlas aux titres évocateurs, comme celui consacré aux « pays qui n’existent pas » ou « aux zones extraterrestres », ou plus sages comme celui dédié à la « zoologie poétique » etc.
L’ouvrage est découpé en cinq parties géographiques (Mers et côtes du ponant, De la Baltique au Grand Nord, Mers et côtes du Levant, Caraïbes et Du Pacifique à l’océan Indien) regroupant une quarantaine de textes de deux ou trois pages, chacun accompagné d’une carte pleine page (d’où le terme d’atlas) mais hélas trop sobres pour faire rêver, avec les coordonnées GPS du lieu où se situe l’épisode.
Comme le précise l’introduction, « fortune de mer » n’a rien à voir avec la richesse ou la quête d’un trésor englouti, il faut prendre l’expression dans le sens d’aléa, bon ou mauvais sort. Encore que les mauvais sorts soient plus nombreux : naufrages, disparitions au large, cannibalisme…
Si vous êtes amateur de ces histoires de marins qu’on se raconte le soir à la veillée ou au comptoir des tavernes des ports, vous y retrouverez des aventures connues (la légende du Hollandais volant) et d’autres qui ne le sont pas trop, à moins que ça ne vous remette en mémoire des faits oubliés (la mort mystérieuse d’Albert Londres dans l'incendie du Georges Philippar, paquebot de la Compagnie des messageries maritimes dans la nuit du 15 au 16 mai 1932 au large d'Aden, alors que le grand reporter semblait avoir découvert un grand scandale en Chine…). On picore dans cet ouvrage au gré de son humeur ou de l’histoire qui suscite notre intérêt du moment.
Pour le dire autrement, il s’agit d’un bouquin d’initiation à ce genre de récits maritimes, idéal pour les débutants, les jeunes enfants ou pour trouver un sujet de lecture pour un malade alité. Un livre qui donne envie d’en lire d’autres, plus complets dans le déroulement des faits ou rédigés dans un style moins journalistique, plus littéraire et plus prenant…
 Cyril Hofstein Atlas des fortunes de mer Arthaud – 131 pages –
Cyril Hofstein Atlas des fortunes de mer Arthaud – 131 pages –
Illustrations de Karin Doering-Froger
03/01/2020 | Lien permanent | Commentaires (3)
Michael Connelly : Darling Lilly
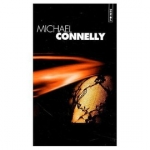 Michael Connelly, né en 1956 à Philadelphie, est l'un des principaux écrivains américains de romans policiers. Diplômé de l'université de Floride en journalisme, en 1986 il est le coauteur d'un article sur les rescapés d'un crash d'avion, qui figure parmi les finalistes pour le prix Pulitzer, ce qui lui permet de devenir chroniqueur judiciaire pour le Los Angeles Times. Il se lance dans la carrière d'écrivain en 1992 avec Les Egouts de Los Angeles, son premier polar, où l'on découvre le personnage d’Harry Bosch. Darling Lilly, roman indépendant de ses séries (comme celle avec Harry Bosch donc) date de 2002.
Michael Connelly, né en 1956 à Philadelphie, est l'un des principaux écrivains américains de romans policiers. Diplômé de l'université de Floride en journalisme, en 1986 il est le coauteur d'un article sur les rescapés d'un crash d'avion, qui figure parmi les finalistes pour le prix Pulitzer, ce qui lui permet de devenir chroniqueur judiciaire pour le Los Angeles Times. Il se lance dans la carrière d'écrivain en 1992 avec Les Egouts de Los Angeles, son premier polar, où l'on découvre le personnage d’Harry Bosch. Darling Lilly, roman indépendant de ses séries (comme celle avec Harry Bosch donc) date de 2002.
Santa Monica, Californie. Henry Pierce, notre héros, a fait une découverte majeur en matière d'ordinateurs moléculaires et se prépare à signer un énorme contrat avec un investisseur, ce qui assurera la renommée de sa boîte. Dans le même temps il s’est fait larguer par son amie Nicole, par ailleurs son assistante démissionnaire. Déménagement, nouveau numéro de téléphone qui à peine installé est assailli d’appels d’hommes voulant parler avec une certaine Lilly qui s’avère être une escort girl dont les coordonnées sont sur un site web porno. Henry se persuade qu’il doit retrouver cette femme pour qu’elle change de numéro !
Bien entendu l’idée est débile et les ennuis vont s’empiler les uns sur les autres sur Henry quand il va sembler évident que la demoiselle a certainement été assassinée. Tabassage, puis suspect potentiel pour l’inspecteur Renner etc.
Quelle misère !
L’intrigue est d’une grande faiblesse, noyée dans des longueurs sans grand intérêt non plus mais, je le reconnais, relativement bien écrites ou disons plutôt, qui n’interdisent pas d’aller au bout. Henry devra se débattre avec des gros méchants, un flic qui ne le lâche pas, sa copine qu’il voudrait récupérer, le contrat en cours de signature qui doit rester en retrait de cette affaire et ses pistes foireuses, sans compter un traumatisme remontant à son enfance avec la disparition de sa sœur prostituée… Le roman s’achève par un épilogue d’une grande niaiserie entre Henry et le responsable de ses ennuis. Le bouquin s’appuyant sur le thème des manœuvres employées par les grands groupes industriels de la pharmacie pour préserver leurs bénéfices.
PS : Si vous ne comprenez rien aux ordinateurs moléculaires, vous pouvez sauter les pages...
« Si le cliché n’avait pas été retouché et si c’était vraiment elle, Lilly était très belle. Tout à fait comme l’avait dit Franck Behmer. Fantasme pur, hôtesse de rêve. Il comprit pourquoi son téléphone n’arrêtait pas de sonner depuis qu’il avait sa ligne. La concurrence sur ce site et sur les autres était peut-être forte mais ne comptait pas. Tout homme faisant défiler ces photos dans l’espoir de se payer une femme aurait eu bien du mal à ne pas s’y arrêter et décrocher son téléphone. »
 Michael Connelly Darling Lilly Points - 441 pages -
Michael Connelly Darling Lilly Points - 441 pages -
Traduit de l’américain par Robert Pépin
29/07/2022 | Lien permanent | Commentaires (4)
La voix du texte
Vous je ne sais pas, mais moi quand je lis un roman, je me fais tout un cinéma intérieur – du moins quand le bouquin est bien écrit. C’est l’un des grands plaisirs de la lecture, activer l’imagination, lâcher la bride à l’esprit. La contrepartie, c’est que je ne peux pas aller voir un film adapté d’un roman quand sa lecture m’est encore fraiche en tête. Je suis toujours déçu, obligatoirement déçu.
Si je ne m’en tiens qu’aux personnages, les acteurs – quelque soit leur talent – ne pourront jamais rivaliser avec la construction subjective que je me suis faite de leur rôle : leurs voix, leurs attitudes, leur physique parfois, trahiront ma lecture.
C’est pour cette même raison que je ne pourrai jamais écouter un livre-audio. L’invention est très belle et force le respect, destinée aux malvoyants ou autres handicapés ne pouvant lire, elle remplit un rôle essentiel. Mais pour moi, ce me serait impossible : la voix du lecteur, imposée donc, le rythme dicté par le récitant, me retireraient une grande partie de ce qui m’attire dans la lecture. Du rôle d’acteur secondaire du roman, observateur/voyeur interne de l’intrigue, je deviendrais simple spectateur extérieur.
Pour les pièces de théâtre, c’est par contre l’inverse. J’ai du mal à lire ce genre de textes, j’ai besoin d’être guidé, il faut qu’un acteur le dise pour que je l’assimile mieux. Il est vrai aussi que le théâtre est écrit pour être joué prioritairement.
Ce n’était qu’une petite réflexion en passant…
01/10/2018 | Lien permanent
Elvira Navarro : La Ville heureuse
 Elvira Navarro, née en Espagne en 1978, a passé son enfance entre Valence et Cordoue et elle vit désormais à Madrid où elle a obtenu son diplôme de Lettres. Son premier livre est paru en 2007, La ville en hiver, chaleureusement accueilli par la critique et récompensé par le prix Fnac du Jeune Talent. Elle a été choisie par la revue Granta parmi les 22 meilleurs auteurs de langue espagnole de la jeune génération. En 2009 elle publie La ville heureuse qui vient tout juste d’être traduit chez nous.
Elvira Navarro, née en Espagne en 1978, a passé son enfance entre Valence et Cordoue et elle vit désormais à Madrid où elle a obtenu son diplôme de Lettres. Son premier livre est paru en 2007, La ville en hiver, chaleureusement accueilli par la critique et récompensé par le prix Fnac du Jeune Talent. Elle a été choisie par la revue Granta parmi les 22 meilleurs auteurs de langue espagnole de la jeune génération. En 2009 elle publie La ville heureuse qui vient tout juste d’être traduit chez nous.
Un gamin arrive de Chine pour rejoindre sa famille émigrée en Espagne depuis trois ans, où elle tient un modeste petit commerce de restauration. Sara, une fillette, cherche à entrer en contact avec un vagabond qui l’effraie et la fascine tout autant.
Etrange roman que cet ouvrage d’Elvira Navarro, constitué de deux parties complètement distinctes l’une de l’autre, comme deux novellas accolées par un lien ténu, le jeune chinois et la fillette vivent dans le même quartier et ont été copains de jeux à une époque. Même la forme accentue cette dichotomie puisque l’écriture diffère entre les deux parties. La première recèle des phrases curieusement construites ou la présence de mots ne semblant pas toujours adéquats (traduction ?), tandis que la seconde est rédigée d’une écriture beaucoup plus évidente et banale. La première est racontée par une voix extérieure, la seconde par la jeune Sara. Mais point commun à ces deux formes narratives, une langue à la musique peu attractive.
Tout est froid dans ce roman. Les décors sont abstraits, les noms de lieux sont identifiés par une lettre initiale, rien n’est chinois, rien n’est espagnol, la mondialisation aseptisée. Comme l’écriture n’incite pas à l’empathie pour les deux gamins, on a du mal à s’intéresser au texte. Un point de vue d’écrivain trop cérébral, intellectuel dans le sens négatif du terme.
Que veut nous dire Elvira Navarro avec ce roman peu évident. J’avouerai ne pas trop savoir et j’assume mon ignorance crasse. Certes, il y est question de difficultés à communiquer, comme entre le garçon et sa mère, « ils étaient allés trop loin dans l’incompréhension mutuelle » constate-t-il. Ou bien entre Sara et ses parents, « Ils ne savent pas non plus comment aborder le sujet avec moi », et aussi entre la fillette et le vagabond « et en réalité nous n’arrivons jamais à un toi et moi, mais seulement à son univers et mon univers. » Un thème bien connu et qui n’a rien de novateur ici.
Pourtant d’autres aspects, bien qu’esquissés, ouvrent une porte de réflexion plus intéressante, comme le rôle de la langue du pays d’accueil et son importance pour un immigré qui tout en l’acquérant constate « une subtile variation dans son identité ». A moins que ce ne soit le passage de l’enfance au stade du jeune adulte, faisant dire par son amie à Sara, « Tu deviens sérieuse » et « venant de sa bouche l’accusation est grave. »
Un roman qui m’a laissé de glace, à l’image de son titre relevant de l’humour froid et pince-sans-rire.
« Désormais, son père ne signifiait plus grand-chose pour sa mère, et pour son grand-père, tout comme le pensait sa mère, il ne signifiait rien de plus que son désir de l’anéantir. D’un autre côté, si sa mère et son grand-père avaient appris un peu plus l’espagnol, ne serait-il pas renfermé ? La liberté de son père ne dépendait-elle pas du fait que ni sa mère ni le grand-père ne le comprenaient pas ? Sa mère communiquait avec son père avec de brèves phrases informatives : « La facture du gaz est arrivée », « Il faut aller racheter des fûts de bière », « La charnière de la porte droite du buffet s’est dévissée ». Son grand-père ne communiquait jamais directement avec son père, mais à travers eux. « Dis à ton père, disait-il à Chi-Huei devant son père, qu’il vérifie l’inventaire de la réserve ».
 Elvira Navarro La Ville heureuse Editions Orbis Tertius - 217 pages –
Elvira Navarro La Ville heureuse Editions Orbis Tertius - 217 pages –
Traduit de l’espagnol par Alice Ingold
11/07/2014 | Lien permanent | Commentaires (2)



