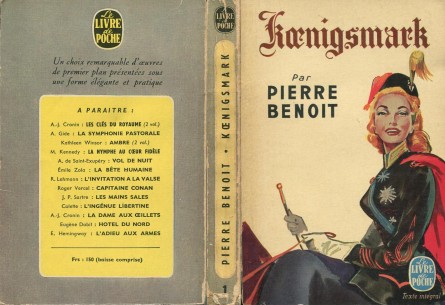Rechercher : les marches de l'amérique
Raymond Dumay : Ma route de Bourgogne
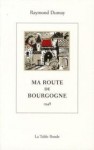 Né dans l’Ain en 1916, Raymond Dumay fut instituteur puis professeur avant de devenir journaliste et rédacteur en chef de la Gazette des Lettres. Il a écrit de nombreux ouvrages traitant de gastronomie et d’œnologie ainsi que des romans et des essais, avant de disparaître en 1999.
Né dans l’Ain en 1916, Raymond Dumay fut instituteur puis professeur avant de devenir journaliste et rédacteur en chef de la Gazette des Lettres. Il a écrit de nombreux ouvrages traitant de gastronomie et d’œnologie ainsi que des romans et des essais, avant de disparaître en 1999.
Publié en 1948 Ma route de Bourgogne est le premier d’une série qui se poursuivra avec Ma route d’Aquitaine (1949), Ma route de Languedoc (1951) et Ma route de Provence (1954). Nous sommes dans les années d’après-guerre, la France est en reconstruction, Raymond Dumay enfourche sa pétrolette qu’il a surnommée « Pégazou », « Pour tout dire, il s’agissait d’un vélomoteur Terrot, natif de Dijon, qui ramait dans les côtes, mais galopait sur terrain plat » et il s’élance sur les routes et chemins de France, en l’occurrence ici, à travers la Bourgogne son pays natal.
Qu’on se comprenne bien, il ne s’agit pas d’un guide de voyage même si l’envie de faire son sac nous prend tout au long de cette lecture qui va son petit bonhomme de chemin. Nous sommes loin des voyages touristiques comme on les envisage de nos jours, le Raymond son but c’est de goûter les pinards du coin et rencontrer les écrivains de Bourgogne ou leur souvenir, qu’ils soient morts ou vivants quelle importance. Pèlerinage ludique d’un gourmet gourmand de nectars et de littérature, deux vices ou vertus qui se marient bien ensemble.
Le programme est alléchant, nous le suivons sans barguigner. L’été est chaud cette année là, « lundi 21 juillet 1947 marqua le début de la vague de chaleur qui pulvérisa tous les records établis depuis cent ans », un verre de blanc par-ci, un de rouge par-là, il faut que le gosier reste humide pour s’entretenir commodément avec les gens de rencontres. Chablis, Clos Vougeot, Gevrey-Chambertin, rythment l’escapade qui nous mène aussi bien à Saint-Sauveur où vécu un temps Colette qu’à Chitry dont Jules Renard fut un maire redouté et Sacy où naquit Restif dela Bretonne. Pérégrinationscultivées en compagnie d’un épicurien qui ponctue son livre de remarques piquantes, « Si le lecteur voulait bien dépenser pour acheter son livre la même intelligence que l’auteur le plus borné a mise à écrire le sien, la situation deviendrait claire ».
Après cette mise en bouche au cœur de la Bourgogne, je suis candidat pour continuer le voyage à travers l’Aquitaine, le Languedoc et la Provence en compagnie de Raymond Dumay, notre cicérone.
« Romain Rolland présente une seconde particularité curieuse : son exemplaire famille. Son adolescence fut illuminée par un trait cornélien. Brillant élève du collège de Clamecy, ses professeurs lui conseillaient de continuer sa carrière à Paris, mais sa sensibilité et sa santé délicate ne permettaient pas à sa mère de songer à le mettre en pension. Le père de Romain Rolland tenait une étude. Héritier de plusieurs générations de notaires, il aimait son métier et sa ville. Cependant, il n’hésita pas : pour cet enfant qui, brillant à Clamecy, pouvait se révéler terne à Paris, il vendit son étude et accepta un petit emploi dans une banque. Romain Rolland aimait à raconter ce trait. Il prétendait que s’il avait pu se laisser aller à l’indifférence et à la paresse, le souvenir du courage souriant de son père aurait suffi à lui rendre son énergie. »
 Raymond Dumay Ma route de Bourgogne La Table Ronde
Raymond Dumay Ma route de Bourgogne La Table Ronde
12/10/2012 | Lien permanent
Morgan Sportès : Tout, tout de suite
 Morgan Sportès né en 1947 à Alger, est un écrivain français. Il a publié dix-huit livres, nombre d’entre eux ont été traduits en de nombreuses langues et ont attiré l'attention de personnalités comme Claude Lévi-Strauss ou Guy Debord avec lequel il se lie d’amitié après la publication de La Dérive des continents en 1984. Il partage actuellement sa vie entre la rédaction de ses livres et de nombreux voyages de recherche.
Morgan Sportès né en 1947 à Alger, est un écrivain français. Il a publié dix-huit livres, nombre d’entre eux ont été traduits en de nombreuses langues et ont attiré l'attention de personnalités comme Claude Lévi-Strauss ou Guy Debord avec lequel il se lie d’amitié après la publication de La Dérive des continents en 1984. Il partage actuellement sa vie entre la rédaction de ses livres et de nombreux voyages de recherche.
En préambule à son roman Tout, tout de suite qui vient tout juste de paraître, Morgan Sportès nous prévient : « En 2006, un citoyen français musulman d’origine ivoirienne a kidnappé et assassiné, dans des conditions particulièrement atroces, un citoyen français de confession juive. J’appelle le premier Yacef, le second Elie. L’un a 25 ans, l’autre 23. J’ai réélaboré ces faits, à travers mon imaginaire, pour en nourrir une création littéraire, une fiction. »
L’auteur est donc très clair, ceci est un roman écrit à partir d’un fait divers réel et si vous ne vous souvenez plus exactement de quelle affaire il s’agit, sachez qu’il s’agit de celle que la presse avait baptisée à l’époque, « le gang des barbares ».
Pour écrire ce livre, Morgan Sportès s’est livré à une véritable contre-enquête, épluchant la presse, interrogeant certains témoins, lisant des documents de source policière etc. Tous ces faits sont la base même de ce récit certifié exact, seuls les dialogues sont de la fiction, la sauce littéraire et le liant qui constitue le roman,la fiction. D’où une avalanche de détails qui ne servent à rien dans le récit mais qui rappellent les rapports de police, comme indiquer le numéro d’une cabine de téléphone public ou préciser qu’une boucherie fait aussi volaille, triperie, charcuterie ! Tous les faits et gestes des protagonistes sont intégralement mentionnés, les noms des rues empruntées, les noms des cybercafés et des commerces où ils entrent.
Tout est épouvantable dans ce drame car tout est nul. Si le terme « gang des barbares » sonne bien et a fait de beaux titres de presse, il ne correspond pas à la réalité car il n’y a pas de gang. Yacef est un tocard de banlieue avec une grande gueule - mais qui bégaye sous le coup de l’émotion - qui a réussi, grâce à un séjour en prison, à se faire une réputation de petit caïd et se créer une petite cour de plus minables que lui. A peine libéré, « c’est à la société qu’il déclarela guerre. Ilveut du fric, vite. » Les barres HLM, les caves et les halls d’immeubles investis pour des trafics en tous genres, les jeunes en sweat-shirts à capuche, le chômage, l’immigration, l’échec scolaire, l’exclusion sociale etc. tel est le décor sordide et connu de cette histoire horrible.
La bêtise crasse de Yacef laisse pantois et effraie car elle défie les raisonnements logiques. Si la brute enlève Elie, la victime est choisie au hasard, c’est tout simplement parce que juif, il est sensé avoir de l’argent et qu’une rançon pourra être demandée. Sauf que Elie n’est pas d’une famille fortunée. Le montant de cette rançon fluctuera à la baisse au fil des trois semaines que durera cet enlèvement.
Le roman fait plus de 370 pages, mais il se lit à une vitesse hallucinante car le style est sec fait de phrases courtes alignant les faits les uns après les autres, froidement. On connaît la fin puisqu’elle est connue, pourtant on ne peut se retenir de dévorer l’ouvrage pour en venir à bout et être bien certain que Yacef va se faire coffrer. Un thriller sans suspense final mais tout aussi prenant.
Morgan Sportès ne donne jamais son avis, seules quelques phrases nous interrogent, la tactique policière pour retrouver Elie était-elle la bonne, demande le père de la victime tout en rendant hommage aux membres de la Crim’ qui ont « travaillé comme des fous », ce « monstre » comme d’autres du même tonneau n’arrive pas de Mars, il est issu de notre société, qu’elles sont les raisons et les causes d’une telle furie ? La question n’est pas nouvelle, des réponses – incomplètes peut-être - ont été fournies mais que faisons-nous pour que cela change ?
Un livre coup de poing, à lire bien évidemment.
« Honnête voyou, Krack, alias Grand Black, ne songe qu’à gagner malhonnêtement son pain. Yacef, « qui mélange tout », foi, politique, finance, participe, comme le dit la formule célèbre, de ce « socialisme des imbéciles : l’antisémitisme ». Le « Juif » incarnant à ses yeux le Capital, devient symbole du monde qui l’oppresse. C’est qu’il n’a pas les instruments intellectuels qui lui permettraient de comprendre ce qui, dans le monde spectaculaire qui est le nôtre, l’opprime en effet. »
 Morgan Sportès Tout, tout de suite Fayard
Morgan Sportès Tout, tout de suite Fayard
Pour aller plus loin, une interview de Morgan Sportès sur le site de Marianne
16/10/2012 | Lien permanent
Stendhal : Vie de Henry Brulard
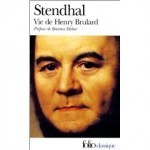 Henry Beyle plus connu sous le nom de Stendhal naquit le 23 janvier 1783 et s’éteignit le 23 mars 1842. On lui doit entre autres, Le Rouge et le Noir et La chartreuse de Parme. C’est à l’âge de cinquante ans que Stendhal décide d’écrire son autobiographie dans un but bien précis car il estime « qu’il serait bien temps de me connaître ».
Henry Beyle plus connu sous le nom de Stendhal naquit le 23 janvier 1783 et s’éteignit le 23 mars 1842. On lui doit entre autres, Le Rouge et le Noir et La chartreuse de Parme. C’est à l’âge de cinquante ans que Stendhal décide d’écrire son autobiographie dans un but bien précis car il estime « qu’il serait bien temps de me connaître ».
Livre d’auto introspection, cette Vie de Henry Brulard relate la vie de l’écrivain jusqu’à l’année 1800, c'est-à-dire jusqu’à son arrivée à Milan en Italie. Le texte ne paraîtra qu’en 1890 soit longtemps après le décès de Stendhal. Dès qu’on ouvre le livre ce qu’on remarque immédiatement ce sont les innombrables croquis qui ponctuent le texte, traits fin à la plume, qui croquent le plan d’une habitation ou un trajet entre deux villes etc. On ne sait si Stendhal craignant de se faire mal comprendre préfère ajouter un dessin à son propos, ou si plus certainement il fait un croquis afin de mieux faire remonter ses souvenirs pour nous les narrer.
De quoi sont faits ces souvenirs, de l’amour démesuré qu’il porte à sa mère mais/parce que elle meurt alors qu’il est très jeune encore (7 ans). De la haine qu’il voue à son père, le rendant responsable de la mort de sa mère. Freud n’était pas né, mais Stendhal l’avait inventé serais-je tenté d’écrire. C’est d’ailleurs cette haine qui le voit titrer cette autobiographie « Vie de Henry Brulard » et non Henry Beyle. Brulard étant le nom d’un oncle paternel, il conserve donc le lignage généalogique tout en escamotant le nom de son père.
On trouve aussi ici, tout ce qui caractérise l’écrivain, sa haine de la religion et de la monarchie « à l’annonce de la mort de Louis XVI, le jeune Beyle est saisi d’un des plus vifs mouvements de joie ». Et par-dessus tout de l’hypocrisie dont il accable son précepteur et sa tante Séraphie « Cette tante Séraphie a été mon mauvais génie pendant toute mon enfance ». En lisant ce texte on constate que Stendhal adorait les mathématiques et leur raisonnement exact, ce qui peut d’une certaine façon expliquer sa haine de l’hypocrisie.
On notera aussi que ce roman (?) au-delà de la découverte de lui-même comme il le souhaitait, permet à Stendhal de s’adonner à la belle écriture sans rechigner à glisser dans son texte des anglicismes, ce qui le rend très moderne et fait sourire car il renvoie à des querelles linguistiques d’aujourd’hui sur ce genre de pratiques.
« La canonnade épouvantable dans ces rochers si hauts, dans une vallée si étroite, me rendait fou d’émotion. Enfin le capitaine me dit : « Nous allons passer sur une montagne à gauche ». J’ai appris depuis que cette montagne se nomme Albaredo. Après une demi-lieue, j’entendis donner cet avis de bouche en bouche : « Ne tenez la bride de vos chevaux qu’avec deux doigts de la main droite afin que s’ils tombent dans le précipice ils ne vous entraînent pas. – Diable ! Il y a donc danger ! Me dis-je. On s’arrêta sur une petite plateforme. « Ah !voilà qu’ils nous visent dit le capitaine. – Est-ce que nous sommes à portée ? Dis-je au capitaine. – Ne voilà-t-il pas mon bougre qui a déjà peur ? » me dit-il avec humeur. Il y avait là sept à huit personnes. Ce mot fut comme le chant du coq pour Saint-Pierre. Je revois, je m’approchai du bord de la plateforme pour être plus exposé, et quand il continua la route je traînai quelques minutes pour montrer mon courage. Voilà comment je vis le feu pour la première fois. C’était une espèce de pucelage qui me pesait autant que l’autre. »
 Stendhal Vie de Henry Brulard chez Folio
Stendhal Vie de Henry Brulard chez Folio
16/10/2012 | Lien permanent
Sylvain Tesson : Dans les forêts de Sibérie
 Sylvain Tesson né en 1972 est écrivain et voyageur, fils du journaliste Philippe Tesson. Géographe de formation, il voyage la plupart du temps par ses propres moyens, c'est-à-dire sans le soutien de la technique moderne, en totale autonomie. Ses expéditions sont financées par la réalisation de documentaires, par des cycles de conférences et par la vente de ses récits d'expédition. Il obtient le prix Goncourt de la nouvelle en 2009, pour Une vie à coucher dehors. .
Sylvain Tesson né en 1972 est écrivain et voyageur, fils du journaliste Philippe Tesson. Géographe de formation, il voyage la plupart du temps par ses propres moyens, c'est-à-dire sans le soutien de la technique moderne, en totale autonomie. Ses expéditions sont financées par la réalisation de documentaires, par des cycles de conférences et par la vente de ses récits d'expédition. Il obtient le prix Goncourt de la nouvelle en 2009, pour Une vie à coucher dehors. .
Sylvain Tesson a passé six mois de février à juillet 2010, en ermite dans une cabane au sud de la Sibérie, sur les bords du lac Baïkal, non loin d'Irkoutsk. C’est cette expérience qu’il relate dans son nouveau bouquin, Dans les forêts de Sibérie, présentée sous la forme d’un journal intime.
On passe rapidement sur les préparatifs, la liste du matériel essentiel à emporter, la liste des bouquins à emmener, « sachant qu’il ne faut jamais voyager avec des livres évoquant sa destination » nous prévient l’auteur et surtout, des cigares et des litres de vodka, compagnons des joies et des peines, et pour la vodka compagnon tout court, car le gars tête plus souvent qu’à son tour !
Je me suis immédiatement plongé avec une délectation gourmande dans ce roman, car dès les premières pages j’ai eu la sensation étrange que Sylvain Tesson l’avait écrit pour moi exclusivement, mettant sous mes yeux mon rêve le plus intime. « Assez tôt, j’ai compris que je n’allais pas pouvoir faire grand-chose pour changer le monde. Je me suis alors promis de m’installer quelque temps, seul, dans une cabane. » De tous temps certains hommes ont eu le besoin de s’éloigner des autres, de vivre en ermite pour des motifs divers, spirituels pour trouver leur dieu, ou bien plus simplement pour retrouver l’essentiel de leur condition d’humain. C’est cette seconde voie qui anime l’écrivain, se délester de tout ce superflu que nous offre la modernité, ce mirage du bonheur, revenir aux basiques, pêcher pour se nourrir, couper son bois pour se chauffer et en savourer la juste valeur. Et surtout, luxe suprême à notre époque, être maître de son temps.
Dans sa cabane, Tesson n’a pas de téléphone (si, un téléphone satellitaire pour les urgences uniquement) qui sonne, d’ordinateur avec les emails qui tombent sans arrêt, d’obligations sociales de toutes sortes. Il n’a que ses besoins physiologiques à satisfaire au prix d’efforts qui leurs restituent leur juste valeur. Et il possède le temps, il passera des heures à contempler les mésanges devant sa fenêtre, à écouter les craquements de la glace recouvrant le lac Baïkal gelé, à lire et écrire sur sa table de bois construite de ses mains. « Avoir peu à faire entraîne à porter attention à toute chose » constate-t-il justement.
En feuilletant le bouquin pour écrire cette chronique, je constate que j’y ai souligné un nombre invraisemblable de phrases et de passages, tous s’adressent à moi et me disent, le monde tel que nous le vivons n’est pas la vraie vie, tout ce qui nous éloigne de la Nature nous éloigne du bonheur, sachons prendre le temps d’apprécier chacun des gestes qui ponctuent nos journées, sachons apprécier le spectacle offert par une pluie de printemps ou une tempête de neige en hiver.
La cabane chère à Sylvain Tesson est, paradoxalement, un luxe pour beaucoup d’entre nous, alors à défaut contentons-nous d’en retenir les enseignements généraux, « habiter le silence est une jouvence », « la virginité du temps est un trésor », pour les reproduire avec nos moyens, dans notre vie quotidienne.
« L’ennui ne me fait aucune peur. Il y a morsure plus douloureuse : le chagrin de ne pas partager avec un être aimé la beauté des moments vécus. La solitude : ce que les autres perdent à n’être pas auprès de celui qui l’éprouve. A Paris, avant le départ, on me mettait en garde. L’ennui constituerait mon ennemi mortifère ! J’en crèverais ! J’écoutais poliment. Les gens qui parlaient ainsi avaient le sentiment de constituer à eux seuls une distraction formidable. « Réduit à moi seul, je me nourris, il est vrai, de ma propre substance, mais elle ne s’épuise pas… » écrit Rousseau dans les Rêveries. »
 Sylvain Tesson Dans les forêts de Sibérie Gallimard
Sylvain Tesson Dans les forêts de Sibérie Gallimard
16/10/2012 | Lien permanent
Roger Vailland : Drôle de jeu
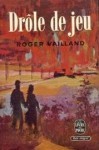 Roger Vailland, écrivain français (1907-1965) fondateur d’une revue surréaliste (Le Grand Jeu), il s’affirma dans ses romans (Drôle de jeu, La Loi) et son théâtre comme un moraliste ironique. Son roman Drôle de jeu paru en 1945 a reçu le Prix Interallié la même année.
Roger Vailland, écrivain français (1907-1965) fondateur d’une revue surréaliste (Le Grand Jeu), il s’affirma dans ses romans (Drôle de jeu, La Loi) et son théâtre comme un moraliste ironique. Son roman Drôle de jeu paru en 1945 a reçu le Prix Interallié la même année.
Le bouquin se déroule dans le Paris de l’occupation et nous décrit la vie quotidienne d’un tout petit groupe de jeunes résistants. Marat, pseudonyme de François Lamballe, 36 ans, le narrateur et chef de groupe, Rodrigue un romantique de 21 ans et Frédéric un quasi gamin, « il est puceau ». Côté féminin, Chloé et Annie, mais dans leur mouvance il y a aussi Mathilde « une grande brune un peu mûre », une ex de Marat, jolie femme vénéneuse aux relations troubles avec des officiers allemands et des collabos, qui amènera le drame.
Roger Vailland, résistant lui-même, connaît parfaitement les arcanes de cette vie dans l’ombre, les rendez-vous secrets, le cloisonnement entre les membres d’un groupe pour en assurer la sécurité maximum, les messages et les rapports transmis aux instances supérieures, les pseudonymes et les logements anonymes, toute une culture du secret et de la clandestinité.
Paris est occupé, la population souffre des restrictions alimentaires, mais des adresses connues des initiés seuls permettent de dîner aussi bien ou presque qu’avant guerre si on en a les moyens, s’y croisent mouchards, femmes vénales, occupants et résistants. Marat, sorte de dandy libertin toujours à l’aise, s’y faufile avec souplesse et y mène comme les autres, un drôle de jeu où se mêlent cyniquement la mort et la séduction amoureuse.
Le roman est divisé en cinq chapitres, cinq journées non consécutives. Le rythme est enlevé, il est même léger si on considère le sujet, la lecture rapide. Aux évènements de la journée racontés par Marat, s’intercalent ses pensées ou des extraits de son journal, l’occasion pour Vailland de distiller des réflexions politiques (« Le révolutionnaire est celui qui ne se résigne pas au malheur de l’homme ») ou psychologiques et surtout des méditations sur les grands thèmes de nos existences, la vie/la mort, l’amour.
« Oui, tout ce jeu que vous faites semblant, les uns et les autres, de prendre au sérieux… Car enfin, vous jouez… j’imagine que vous, vous êtes assez cynique pour l’avouer… en petit comité… le curé joue au chef de bande : le Roi des Montagnes, Edmond About lui a tourné la tête, il choisit mal ses auteurs… poser des bombes au clair de lune, faire dérailler un train, c’est évidemment un jeu passionnant… même pour un curé. Frédéric s’excite d’une autre manière : il joue à la Révolution, c’est lui l’Incorruptible, il s’imagine Robespierre comme les gosses s’imaginent chauffeurs de locomotives ; en fin de compte il joue au même jeu que le curé, tous les jeux de garçons se ressemblent, il s’agit de bousiller le canapé du salon, le train de von X… ou le monde bourgeois. »
 Roger Vailland Drôle de jeu Le Livre de Poche
Roger Vailland Drôle de jeu Le Livre de Poche
17/10/2012 | Lien permanent
Edith Wharton : Le vice de la lecture
 La Petite Collection des Editions du Sonneur a été créée pour que puissent exister des textes trop courts pour être publiés dans un grand format, mais trop grands pour ne pas être édités, nous prévient l’éditeur. Car effectivement il s’agit non pas d’un « livre » (une trentaine de pages) mais d’un article paru en 1903 dans la North American Review pour la première fois et aujourd’hui exhumé de l’oubli.
La Petite Collection des Editions du Sonneur a été créée pour que puissent exister des textes trop courts pour être publiés dans un grand format, mais trop grands pour ne pas être édités, nous prévient l’éditeur. Car effectivement il s’agit non pas d’un « livre » (une trentaine de pages) mais d’un article paru en 1903 dans la North American Review pour la première fois et aujourd’hui exhumé de l’oubli.
Edith Wharton (1862-1938) vient de la haute bourgeoisie New Yorkaise, voyage en France et en Angleterre où elle rencontre Gide, Cocteau, Henry James et d’autres artistes. En 1920 elle est la première femme à obtenir le prix Pulitzer avec Le Temps de l’Innocence. Son œuvre s’étale sur une quarantaine de romans, des poèmes, des critiques et des ouvrages sur la décoration des jardins.
En ce temps de rentrée littéraire, selon la formule consacrée à l’avalanche de livres qui déboulent sur les étals des librairies, la lecture de ce Vice de la lecture ne pouvait pas mieux tomber. Il s’agit donc comme je l’ai dit, d’un article critique consacré à la lecture et surtout aux lecteurs. Edith Wharton estime qu’il y a deux sortes de lecteurs, le « lecteur mécanique » et le « lecteur né ». Le premier lit ce que nous nommerions aujourd’hui les best-sellers, les livres dont on parle, bref les livres qu’il faut avoir lus pour ensuite pouvoir en parler en société, alors que le second serait un vrai lecteur, réellement intéressé par le texte et seul à même de le comprendre. De cette catégorisation il en découle selon elle, que le « lecteur mécanique » est une des causes de la mauvaise littérature, puisque c’est lui qui lit les écrivains médiocres ; les lire c’est les faire vivre, les faire vivre c’est les pousser à « commettre » de nouveaux livres de piètre qualité que le « lecteur mécanique » s’empressera de lire, etc. la boucle est bouclée.
On voit que l’auteur a une vision assez élitiste de la lecture et qu’elle ne manque pas de l’écrire « Lire n’est pas une vertu, mais bien lire est un art que seul le lecteur-né peut acquérir ». Un texte qui fait grincer des dents, qui peut lancer un débat mais qui ne s’engage pas sur de bonnes voies.
« C’est lorsque le lecteur mécanique, armé de la haute idée de son devoir, envahit le domaine des lettres – discussions, critiques, condamnations ou, pire encore, éloges – que le vice de la lecture devient une menace pourla littérature. Alorsmême qu’il pourrait sembler d’un goût douteux de s’offusquer de cette intrusion motivée par de si respectables motifs, n’eût été cette incorrigible suffisance de lecteur mécanique qui fait de lui une cible légitime. L’homme qui joue un air sur u orgue de Barbarie ne cherche pas à soutenir la comparaison avec Paderewski ; le lecteur mécanique, lui, ne doute jamais de sa compétence intellectuelle. Tout comme la grâce mène à la foi, tant de zèle investi pour progresser est supposé conférer une cervelle. »
 Edith Wharton Le vice de la lecture La Petite Collection – Editions du Sonneur
Edith Wharton Le vice de la lecture La Petite Collection – Editions du Sonneur
17/10/2012 | Lien permanent
Yves Crumeyrolle : Le manteau de la reine
Avertissement : c’est l’auteur, que je ne connais absolument pas, qui m’a contacté pour me proposer son ouvrage afin que j’en fasse une chronique sur ce blog. Par ce geste, il se jette à l’eau car il s’agit de son premier livre et bien entendu on devine le trac qui taraude un écrivain quand il livre son travail pour la première fois au jugement d’un inconnu.
 Yves Crumeyrolle est né en 1948 dans le Cantal. Après des études de philosophie et de techniques en bâtiment, Yves est devenu maître artisan, puis expert en construction. Depuis quelques années, il a commencé à écrire de la poésie et son premier livre, Le manteau de la reine, vient de paraître.
Yves Crumeyrolle est né en 1948 dans le Cantal. Après des études de philosophie et de techniques en bâtiment, Yves est devenu maître artisan, puis expert en construction. Depuis quelques années, il a commencé à écrire de la poésie et son premier livre, Le manteau de la reine, vient de paraître.
Quand j’ai reçu l’opus, j’ai failli renoncer à ma mission car on ne m’avait pas prévenu qu’il s’agissait de poésies, or c’est un genre littéraire que je n’apprécie pas car je ne le comprends pas. J’ai néanmoins accepté le challenge mais je tenais à le préciser, par honnêteté intellectuelle et pour que vous me lisiez en gardant en mémoire ce paramètre.
L’objet en lui-même est assez réussi, couverture sobre et élégante en cartonnage glacé. A l’intérieur, vingt-huit poèmes accompagnés chacun d’une illustration en couleur, précédés par une préface d’une amie de l’auteur. Il faut absolument lire ce texte d’introduction, car il présente admirablement bien le travail d’Yves Crumeyrolle, désamorçant à la source, critiques et interrogations qui sans lui, ne manqueraient pas de troubler le lecteur.
En exergue à chacun des poèmes, une citation latine donne le ton de la poésie mais plus généralement de l’ensemble, à savoir un recueil particulièrement pointu et savant qu’un empilage de notes en bas de pages viennent expliciter. Notre poète ne manque pas de culture, qu’il se réfère aux mythologies antiques (banal chez les poètes classiques me direz-vous), aux termes dialectaux, aux références philosophiques et particulièrement à Leibniz, aux sciences mathématiques (notre classique devient alors plus moderne) rien ne semble échapper au domaine du savoir de l’auteur, « Chasseur impénitent de l’épithète rare ».
Il y a peut-être là, dans cet étalage de culture trop ostentatoire, un point faible. Je l’ai dit, je ne suis pas un familier de la poésie, pour lire ce livre ma vision s’est donc focalisée sur mes repères connus, c’est à dire les mots. Tous ces termes rares glissés dans un roman m’auraient fait croire que j’étais intelligent car le sens général du texte ne m’aurait pas échappé, mais là, cumuler vocabulaire recherché et idées découlant des sensations poétiques – qui hélas me sont étrangères - voulues par l’auteur, ça fait beaucoup de chausse-trapes pour mon petit cerveau.
Bien que je ne me sente aucune légitimité dans ce domaine, je vous livre néanmoins mes impressions concernant les poèmes proprement dit. Les plus courts m’ont semblé les meilleurs car le poète à tendance à se rengorger de mots, asphyxiant ses vers à la recherche de la rime adéquate au point de paraître parfois, souvent diront d’autres, trop lourd. Il en est de la poésie comme de la cuisine, ce n’est pas la plus riche, la meilleure. Si j’osais un conseil amical à l'auteur, attention à ne pas confondre style et esbroufe.
D’autre part, j’ai été étonné par les sujets abordés, récriminations contre un contrôleur de la SNCF, évocations d’instants professionnels et j’ai cru noter aussi de bien nombreuses allusions au monde judiciaire. Tout cela dit en alexandrins bien entendu.
Pour résumer mon sentiment, ces poésies sont en réalité un acte militant, un manifeste rédigé par un amoureux de la langue française qui n’entend pas s’en laisser compter par le mouvement général d’avilissement de la langue et donc de la pensée. Yves Crumeyrolle mène un combat qui lui tient à cœur, dans ces conditions je ne peux que saluer et souhaiter bonne chance à l’auteur pour son projet littéraire.
 Yves Crumeyrolle Le manteau de la reine
Yves Crumeyrolle Le manteau de la reine
Avec des illustrations d’Isabelle Morange et une préface de Claire Michel. Ouvrage édité par l’auteur dont vous trouverez tous les détails, ici sur le site dédié au recueil.
15/11/2012 | Lien permanent | Commentaires (37)
Le Livre de Poche a 60 ans
 C’est le 9 février 1953 qu’est paru le premier volume de la collection Le Livre de Poche, il s’agissait de Koenigsmark, roman de Pierre Benoit. Ce concept révolutionnaire a été conçu par Henri Filipacchi, à cette époque secrétaire général de la Librairie Hachette.
C’est le 9 février 1953 qu’est paru le premier volume de la collection Le Livre de Poche, il s’agissait de Koenigsmark, roman de Pierre Benoit. Ce concept révolutionnaire a été conçu par Henri Filipacchi, à cette époque secrétaire général de la Librairie Hachette.
Il est vrai que des bouquins de ce format facile à glisser dans une poche, existaient déjà. Dès 1905, les éditions Jules Tallandier commercialisaient, sous l'appellation Livre de poche, des romans populaires à petit prix, dont Hachette devra d'ailleurs racheter le nom. Pourtant, si cette nouvelle collection rencontra le succès, c’est parce qu’elle satisfaisait pleinement la demande populaire et estudiantine d'un livre bon marché (en 1953, il est six fois moins cher qu'un ouvrage grand format) et désacralisé, présenté sous des couvertures rappelant les affiches de cinéma, mais néanmoins véhicule d'une littérature de qualité.
Henri Filipacchi réussit à convaincre ses amis éditeurs Albin Michel, Calmann-Lévy, Grasset et Gallimard de s'associer à son projet et de devenir ainsi les « pères fondateurs » du Livre de poche.
Chaque quinzaine, un nouveau titre sort. Puis la fréquence augmente : 4 titres par mois en 1955, 12 au milieu des années 1960. Puis tout s’emballe, de 8 millions d'exemplaires en 1957-1958, les ventes passent à 28 millions en 1969.
Les différentes collections utilisent le même numérotage, si bien que des titres arrivent (en 2007) à des numéros au-delà de 20 000, mais il existe des trous de numération, par exemple de 9 800 à 13 899, et des plages de 100 à 500 numéros consécutifs sont réservées à des collections précises. De ce fait un certain désordre s'est créé au fil du temps.
Devant ce succès colossal, la concurrence s’organise. C’est ainsi que naitront, J'ai lu créé par Flammarion en 1958, Presses Pocket créé par les Presses de la Cité et Folio créé par Gallimard en 1972 après son retrait de la Librairie Générale Française. Mais, avec près d'un milliard de volumes diffusés depuis sa création et plus de 18 millions d’exemplaires vendus en 2002, Le Livre de Poche demeure la première collection de poche française.
Dans les 2 000 premiers numéros, on retrouve la majorité des classiques français. Du no 1 au no 1800 (1967), les couvertures, souvent signées Jean-Claude Forest, sont du style « affiche peinte » caractéristique. Ensuite elles se modernisent. Pierre Faucheux a donné également des couvertures célèbres notamment pour Paroles de Jacques Prévert.
À l'origine l'initiative est dénigrée par certains qui y voient l'émergence d'une sous-culture. Le philosophe Hubert Damisch dénonce dans Le Mercure de France « une entreprise mystificatrice puisqu'elle revient à placer entre toutes les mains les substituts symboliques de privilèges éducatifs et culturels ». Dans Les Temps modernes, Jean-Paul Sartre s'interroge, « Les livres de poche sont-ils de vrais livres ? Leurs lecteurs sont-ils de vrais lecteurs ? ». Par contre Jean Giono écrit en 1958 : « Je considère aujourd'hui Le Livre de poche comme le plus puissant instrument de culture de la civilisation moderne ». On constatera que dans ce domaine comme dans tant d’autres, tout ce qui est nouveau effraie et doit affronter la critique, même de gens dont on attendrait une plus grande ouverture d’esprit…
De nos jours, les auteurs modernes sont plutôt flattés de cohabiter avec les grands écrivains du passé. Le livre de poche leur permettant d'être plus longtemps en librairie.
Les chiffres : Le capital de la Librairie générale française, société anonyme, est détenu à 80 % par Hachette-Livre et, à hauteur de 20 %, par les Éditions Albin Michel. Il y avait plus de 20 000 titres publiés depuis 1953. Chaque année, on compte 400 nouveautés pour 1000 réimpressions.
Enfin sachez que l'ouvrage le plus vendu en Livre de poche est Le Grand Meaulnes d'Alain-Fournier, suivi de Vipère au Poing d'Hervé Bazin (plus de 4 millions d'exemplaires chacun) et que l’auteur le plus vendu est Agatha Christie (plus de 40 millions de volumes), suivie d'Émile Zola (22 millions).
Pour célébrer cet anniversaire, une exposition de 200 mètres carrés sera consacrée au Livre de Poche lors du Salon du Livre à Paris, du 22 au 25 mars prochain.
09/02/2013 | Lien permanent
Marcel Pagnol : La Gloire de mon père
 Marcel Pagnol est un écrivain, dramaturge et cinéaste français, né en 1895 à Aubagne (Bouches-du-Rhône), mort le 18 avril 1974 à Paris à l'âge de 79 ans. Il devient célèbre avec Marius, une pièce de 1929. Cinq ans plus tard, à Marseille, il créé sa propre société de production et ses studios de cinéma, et réalise de nombreux films – entrés dans mon panthéon culturel - avec entre autres Raimu, Fernandel, Pierre Fresnay, Louis Jouvet ; citons pour exemples, Angèle (1934), Regain (1937), La Femme du boulanger (1938) etc. En 1946, il est élu à l'Académie française. En 1957, après s’être éloigné du cinéma et du théâtre, il entreprend la rédaction de ses Souvenirs d'enfance avec notamment La Gloire de mon père et Le Château de ma mère.
Marcel Pagnol est un écrivain, dramaturge et cinéaste français, né en 1895 à Aubagne (Bouches-du-Rhône), mort le 18 avril 1974 à Paris à l'âge de 79 ans. Il devient célèbre avec Marius, une pièce de 1929. Cinq ans plus tard, à Marseille, il créé sa propre société de production et ses studios de cinéma, et réalise de nombreux films – entrés dans mon panthéon culturel - avec entre autres Raimu, Fernandel, Pierre Fresnay, Louis Jouvet ; citons pour exemples, Angèle (1934), Regain (1937), La Femme du boulanger (1938) etc. En 1946, il est élu à l'Académie française. En 1957, après s’être éloigné du cinéma et du théâtre, il entreprend la rédaction de ses Souvenirs d'enfance avec notamment La Gloire de mon père et Le Château de ma mère.
Dans ce premier tome des souvenirs d’enfance de Pagnol, nous faisons connaissance avec son père Joseph, instituteur laïque et républicain, sa mère Augustine, couturière et son petit frère Paul plus jeune de trois ans. Dès la première phrase de l’ouvrage, le ton est donné, « Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers ». La ville évoque le soleil et l’accent chantant des provençaux, et les chevriers et leurs bêtes, des temps anciens dans des campagnes rocailleuses.
A cette époque, Marcel a huit ans et ses parents ne sont guère âgés, son père « c’était vingt-cinq ans de plus que moi, et ça n’a jamais changé » et sa mère en a six de moins que son époux. Pagnol ne vivra que trois ans à Aubagne car son père est muté à Marseille. Quand l’enfant n’a pas école, il fait une promenade dans le parc Borely avec sa tante Rose et c'est d'ailleurs là qu'elle rencontrera le futur oncle Jules.
Les rapports entre Joseph l'instituteur anticlérical et l’oncle Jules jovial catholique, causent parfois quelques frictions vivement éteintes par leurs épouses. Néanmoins, les deux couples décident de louer ensemble une maison de campagne dans la garrigue, la Bastide Neuve pour y passer les vacances d'été. Excellent passage où Joseph, chez un brocanteur, achète les quelques meubles qui serviront à meubler leur futur paradis. Dès lors, le bouquin devient un enchantement, car après un long trajet dans la rude garrigue, derrière la mule tirant les meubles et les provisions nécessaires au séjour, ils parviennent à la petite villa, et l’on s’imagine dans un film en compagnie des acteurs cités plus haut.
Ces vacances sont une révélation pour le jeune Marcel qui tombe amoureux de la nature, sa faune, sa végétation sauvage, ses collines, décors réels où il pourra revivre les histoires d’Indiens dont il se régale avec son frère. Le livre aborde alors sa dernière partie, la découverte de la chasse - à l’instigation de l’oncle Jules - autant pour Joseph que pour Marcel.
Le gamin suivra les deux hommes à leur insu, à travers broussailles, vallons et chemins creux, décidé coûte que coûte à valoriser son père novice en l’art cynégétique, en tentant de rabattre vers lui des proies pour son fusil. A l’issue d’une journée riche en péripéties et efforts pour l’enfant, Joseph réussira un coup de maître, tuer deux bartavelles, des perdrix locales, un exploit incroyable même aux yeux des chasseurs aguerris du village. Les deux hommes et Marcel enfin réunis, rentreront à la maison, le gosse fou de bonheur car « dans mes petits poings sanglants d’où pendaient quatre ailes dorées, je haussais vers le ciel la gloire de mon père en face du soleil couchant ».
Un très joli livre, qu’on ne peut s’empêcher de lire à haute voix dans sa tête, pour lui donner cet accent merveilleux nous rappelant le chant des cigales, le goût du pastis et la chaude caresse du soleil.
« - En voilà un qui n’est guère sympathique, dit mon père. – Ils ne sont pas tous comme ça, dit le paysan. Celui-là me veut du mal, parce que c’est mon frère. Cette raison lui paraissant assez claire, il entraîna le mulet, qui laissa tomber quelques brioches et, pour finir, mit son rectum à l’envers, sous la forme d’une tomate. Je crus qu’il allait en mourir, mais mon père me rassura : - Il fait ça par hygiène, me dit-il. C’est sa façon à lui d’être propre. »
 Marcel Pagnol La Gloire de mon père – Souvenirs d’Enfance 1 Editions Pastorelly
Marcel Pagnol La Gloire de mon père – Souvenirs d’Enfance 1 Editions Pastorelly
Marcel Pagnol évoque sa candidature à l’Académie Française :
07/01/2013 | Lien permanent
Sylvia Plath : La Cloche de détresse
 Sylvia Plath, née en 1932 dans la banlieue de Boston et décédée en 1963 à Londres, est une écrivaine américaine. Elle a principalement écrit des poèmes et un seul roman, La Cloche de détresse, paru en 1963, peu de temps avant son suicide.
Sylvia Plath, née en 1932 dans la banlieue de Boston et décédée en 1963 à Londres, est une écrivaine américaine. Elle a principalement écrit des poèmes et un seul roman, La Cloche de détresse, paru en 1963, peu de temps avant son suicide.
Esther Greenwood, dix-neuf ans, est l'une des douze lauréates d'un concours de poésie organisé par un magazine de mode de New York pour y suivre un stage durant l'été. Elle fait la connaissance de Doreen, qu’elle méprise un peu tout en cherchant à lui ressembler et à la suivre lors de ses sorties de réceptions en soirées futiles, elle mène ainsi une vie mondaine à laquelle elle n'était pas habituée.
A son retour chez sa mère, près de Boston, elle apprend qu’elle n’est pas reçue au cours de littérature, avenir qu’elle envisageait. Elle se trouve alors confrontée à un choix de vie, se lancer dans l’étude de la sténodactylo pour avoir un vrai métier, comme sa mère secrétaire le lui suggère fortement, ou bien espérer un mariage et une vie de femme au foyer avec les enfants à éduquer. Elle ne sait quel choix faire car Esther n’est pas de cette espèce et cette alternative n’offre aucune possibilité satisfaisante pour elle. D’où, insomnies et dépression.
Elle consulte alors un psychiatre, qui lui prescrit une thérapie par électrochocs, sans résultats tangibles si ce n’est de la pousser à faire des tentatives de suicide divers, la dernière la conduisant dans une institution psychiatrique où elle se fera de nouveaux amis certes, mais où elle sera encore une fois soumise à un traitement par électrochocs.
On ne peut lire ce roman sans faire le rapprochement avec la vie réelle de Sylvia Plath qui se suicidera après sa parution, car il porte la marque d’une confession ou plus exactement, d’un compte-rendu exact et vécu d’une mort annoncée. C’est en cela qu’il est poignant et émouvant, car le lecteur sait que ce qu’il lit n’est pas une fable ou un habile roman écrit par un écrivain bien documenté. Personnellement, j’ai ressenti l’importance de savoir cela avant d’entamer ma lecture, car sinon on risque de passer à côté de l’aspect tragique du roman. Peut-être est-ce un peu malsain ou voyeur, mais nier ce fait serait mentir et l’on risque de lire cet ouvrage rapidement sans en mesurer toute son ampleur.
Je m’explique, Sylvia Plath a une écriture énergique, pleine de vie oserais-je écrire, ce qui ne colle pas avec l’idée qu’on se fait d’une personne dépressive. Ainsi, si cette histoire n’était vraie ou presque, on aurait du mal à y croire ou s’y intéresser, on pourrait chipoter qu’il s’agit d’une crise d’adolescence pas si originale que cela. Pourtant Esther va entrer en dépression, mais avec tellement de délicatesse, comme sur la pointe des pieds, qu’on ne s’en rend quasiment pas compte.
Son héroïne, Esther Greenwood, fine observatrice, porte des jugements acérés sur ceux qui l’entourent, fait preuve d’un tempérament froid et réfléchi, elle ne manque pas de tonus. Par contre, elle est tiraillée intérieurement entre son envie d’écrire et d’y consacrer sa vie, et ce que lui propose le monde dans lequel elle vit en cette fin des années 50, un boulot de secrétaire ou une place de femme au foyer. Jeune fille mal dans sa peau et en avance sur son temps par sa préfiguration de ce que seront les mouvements féministes à venir, elle n’est jamais à sa place où qu’elle soit et quoi qu’elle fasse. Elle se regarde survivre avec effarement, prise entre plusieurs personnalités, écartelée. « Pour celui qui se trouve sous la cloche de verre, vide et figé comme un bébé mort, le monde lui-même n’est qu’un mauvais rêve ».
La fin de l’ouvrage n’en est que plus dramatique et émouvante, Esther Greenwood va peut-être quitter l’établissement psychiatrique où elle est traitée mais nous ne le savons pas réellement, par contre l’avenir de Sylvia Plath est écrit, l’Histoire nous l’a dit.
« Au Japon, ils s’ouvrent les entrailles dès qu’il y a quelque chose qui cloche. Je me suis demandé comment ils font. Ils doivent avoir un couteau très affûté… Non probablement deux couteaux bien aiguisés. Ils doivent s’asseoir en tailleur, un couteau dans chaque main. Puis ils croisent les bras et plantent un couteau de chaque côté de leur ventre. Ils sont nus, parce que sinon les couteaux se coinceraient dans leurs vêtements. D’un seul coup, rapide comme l’éclair, avant d’avoir eu le temps d’y songer à deux fois, ils s’enfoncent les couteaux et découpent un demi-cercle en haut et un demi-cercle en bas ; comme ça, la peau du ventre tombe par terre comme une assiette et recueille leurs boyaux qui tombent dedans, alors, ils meurent. »
 Sylvia Plath La Cloche de détresse Gallimard collection L’Imaginaire
Sylvia Plath La Cloche de détresse Gallimard collection L’Imaginaire
Traduit de l’anglais par Michel Persitz
13/04/2013 | Lien permanent