Rechercher : les marches de l'amérique
Conte de Noël
 Colette, de son vrai nom Sidonie-Gabrielle Colette, est une romancière française, née à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne) le 28 janvier 1873 et morte à Paris le 3 août 1954. Elle a été élue membre de l’Académie Goncourt en 1945. Femme libre et se revendiquant bisexuelle, cet aspect de sa vie personnelle se retrouve dans son œuvre, voir par exemple la série des Claudine. Elle est aussi une subtile analyste de l’âme féminine (Chéri en 1920) ou encore une briseuse de tabous pour l’époque avec Le Blé en herbe en 1923.
Colette, de son vrai nom Sidonie-Gabrielle Colette, est une romancière française, née à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne) le 28 janvier 1873 et morte à Paris le 3 août 1954. Elle a été élue membre de l’Académie Goncourt en 1945. Femme libre et se revendiquant bisexuelle, cet aspect de sa vie personnelle se retrouve dans son œuvre, voir par exemple la série des Claudine. Elle est aussi une subtile analyste de l’âme féminine (Chéri en 1920) ou encore une briseuse de tabous pour l’époque avec Le Blé en herbe en 1923.
Néanmoins son œuvre est multiple et elle trouve sa place parmi les romanciers régionalistes qui se sont imposés durant l'entre-deux-guerres, à travers, entre autres, les descriptions de sa région natale, la Bourgogne (Les vrilles de la vigne par exemple).
En dépit de sa réputation sulfureuse et du refus par l'Église catholique d'un enterrement religieux, Colette est la première femme à laquelle la République ait accordé des obsèques nationales. Elle est enterrée au cimetière du Père-Lachaise à Paris.
Un très court préambule pour vous présenter Colette, auteure du conte de Noël que je tenais à vous offrir en cette période de cadeaux.
Les Sabots ont été publiés dans Paris Théâtre, numéro de Noël 1909, à la suite d’une enquête dont, en épigraphe, l’auteure rappelle la question qui avait été posée : « Envoyez-nous, m’écrit Paris Théâtre, un de vos souvenirs d’enfance, un souvenir de vos souliers de Noël… ». Bien après la mort de Colette, le texte sera recueilli dans les Contes des mille et uns matins (Flammarion).
« Je n’ai jamais eu, dans mon enfance, de soulier de Noël. Cela me fait un peu de peine à présent, mais, dans ce temps-là, je n’y pensais pas. Je suis l’enfant d’un pays très « mal pensant », où les gobettes et les gamins, mécréants, eussent dit au petit Jésus en personne, descendu lumineux et blanc par la cheminée :
- Attends ta mère, qu’elle te fichera une bonne taraudée pour t’apprend’ à sortir tout nu en chemise !
Le soir de Noël je quittais mes sabots trempés de neige, et je les portais, comme les autres soirs, dans la cuisine, sur le fourneau tiède, où ils séchaient jusqu’au matin. Maintenant que je vieillis, il me vient un regret tardif, hors de saison – fleur romanesque, bouquet sentimental et démodé – le regret d’une foi que je n’ai pas eue…
Non, je n’ai pas connu les souliers de Noël. Par-dessus mes chaussons de laine, je remettais mes sabots au nez pointu, sans regarder, au matin de la nuit miraculeuse, s’ils gardaient la trace dorée, le givre diamanté d’un effleurement divin… Ils avaient ce matin-là, leur museau noir et ciré, leur bricole souple comme d’habitude… Comme d’habitude, ils claquaient sous mon pas vif et autoritaire, en trottant dans la neige, et glissaient sur les patinoires miroitantes, le long du mur de l’école… Ils m’annonçaient de loin, quand je revenais vers midi à la maison, sabotant et gambadant sur les pavés inégaux, sur les têtes-de-chat qui rendent si dangereuses les ruelles de ma petite ville… Je revenais toute violette de froid, essoufflée de m’être battue et roulée dans la neige fraîche, le capuchon de travers, les mains rouges sous les mitaines tricotées…
- Colette, tes sabots !
La voix de ma mère me rappelait à l’ordre, au moment de franchir le seuil de la salle à manger. Docile, j’entrais sur mes chaussons muets, et, jusqu’à l’heure où l’attrait de la neige, la folie du jeu m’entraînaient de nouveau, mes sabots m’attendaient dans le corridor, couplés, pointus, avec l’air patient de deux rats noirs, guettant museau contre museau… Que de fois ils m’ont attendue, sournois, complices, jusqu’au moment de la récréation défendue !…
À cinq heures, en décembre, sous le ciel presque noir, la neige est bleue. Contre la fenêtre, cachée sous le rideau de mousseline, je regardaisla rue. Jesavais que, sur une placette écartée, se nouait une ronde silencieuse, frénétique de gamines déchaînées, qui s’échappaient tous les soirs pour le plaisir intense de se rouler dans la neige, s’y colleter, s’y ensevelir, et rentrer vers six heures, mouillées, cafardes, risquant la gifle ou la fessée… Un nocturne diablotin me tirait par la manche, et je le suivais bientôt, mes sabots dans la main… Dehors, mes yeux habitués à la nuit, distinguaient d’autres ombres enfantines, portant à la main leurs sabots, légères, démoniaques, comme de jeunes chattes du sabbat, grisées par la bise d’est et la neige volante… Crépuscules d’hiver, lampe rouge dans la nuit, vent âpre qui se lève après la chute du jour – jardin deviné dans l’air noir, rapetissé, étouffé de neige, sapins accablés qui laissiez, d’heure en heure, glisser en avalanches le fardeau de vos bras, coups d’éventail de passereaux effarés, et leurs jeux inquiets, leur coucher dans une poudre de cristal ténue, irisée comme la brume d’un jet d’eau…
Ô tous les souvenirs d’hivers, tous les noëls de mon enfance, que cette rêverie de Noël vous rende à moi ! Que mes souvenirs, avec une chute molle et silencieuse de pétales, viennent un à un remplir cette mule étroite, tombée de mon pied nu, devant un feu échevelé où ressuscite et se consume l’image d’une enfant fraîche et saine, en tablier d’escot noir, hâlée de froid, roussie de soleil, les pieds impatients dans ses sabots de frêne noirci, et qui ne connut pas les sabots de Noël !… »
24/12/2013 | Lien permanent
Balzac : La peau de chagrin
 C’est un téléfilm diffusé par France2 il y a quelques semaines à peine qui m’a donné l’envie de me replonger dans ce classique de la littérature française. Si le thème « fantastique » nous est familier à tous, rien ne vaut la lecture du texte qui bien entendu dépasse ce simple aspect pour le reléguer au second plan – tout le contraire de l’adaptation filmée qui par essence ne peut montrer que ce qui se voit.
C’est un téléfilm diffusé par France2 il y a quelques semaines à peine qui m’a donné l’envie de me replonger dans ce classique de la littérature française. Si le thème « fantastique » nous est familier à tous, rien ne vaut la lecture du texte qui bien entendu dépasse ce simple aspect pour le reléguer au second plan – tout le contraire de l’adaptation filmée qui par essence ne peut montrer que ce qui se voit.
Honoré de Balzac (1799-1850) a 31 ans quand paraît son premier chef-d’œuvre La peau de chagrin qui sera suivi l’année suivante du Colonel Chabert, premières pierres de la longue litanie de près de 90 romans et 2000 personnages qui constitueront La Comédie Humaine.
Ruiné par le jeu et à deux doigts de se suicider, Raphaël de Valentin achète à un vieil antiquaire un talisman, une peau de chagrin aux pouvoirs magiques. On appelle chagrin, un cuir grenu en peau de chèvre ou de mouton utilisé en reliure, ce qui ici constitue une sorte de jeu de mot entre la matière et l’effet obtenu. La peau réalisera tous ses vœux mais en contrepartie, représentant sa durée de vie, elle rétrécira d’autant à chacun de ces désirs comme lui explique le vendeur « Après tout, vous vouliez mourir ? hé ! bien, votre suicide n’est que retardé… ». Raphaël va se jeter dans le luxe et la débauche contaminé par une fièvre du toujours plus qui le mènera inéluctablement vers le tombeau.
Le roman est composé de trois parties distinctes, « Le talisman » nous présente Raphaël au bord du suicide, l’acquisition de la peau de chagrin, le premier souhait exaucé qui le mène à un grand dîner organisé par un banquier lançant un nouveau journal ; « La femme sans cœur » Raphaël nous raconte sa vie, sa chambre minable louée àla pauvre Mme Gaudinet sa fille Pauline où il écrit son grand œuvre, sa rencontre favorisée par son ami Rastignac avec Foedora, une courtisane, sa vie de débauche, les dettes et la misère, son souhait exaucé et la peau qui rétrécit ; « L’agonie » Raphaël et Pauline devenue riche à son tour se retrouvent et s’avouent leur amour, le temps du bonheur total, la peau qui s’amenuise jusqu’à l’issue fatale.
Balzac utilise l’aspect du conte – le talisman magique – mais déjà il nous montre son époque (ou la notre ?) faite d’égoïsme (Raphaël en fait ne pense qu’à lui, Foedora n’existe que pour elle-même), où l’argent est le sang qui fait vivrela cité. L’écrivain invite l’esprit de Molière quand il raille les scientifiques et médecins ne pouvant expliquer ni le mystère de la peau, ni la maladie de son propriétaire et l’on retrouve son style fait de phrases riches en descriptions ou précisions sur les dernières découvertes scientifiques de son époque.
Néanmoins on ne sait pas vraiment ce que Balzac a voulu dénoncer ici, l’excès de la passion chez l’homme ou la puissance du désir ? « Vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit ». A moins qu’il n’ait voulu montrer tout simplement, à travers ses personnages, la naissance d’une société égoïste.
Enfin j’en terminerai avec une question primaire mais non moins essentielle à mes yeux. Quand Raphaël est presque arrivé au terme de son existence, pourquoi ne fait-il pas un dernier vœu, celui de continuer de vivre ? La situation aurait alors été troublante et paradoxale puisque le talisman pouvant encore exaucer le souhait aurait du sauver le jeune homme, mais par contre étant le dernier vœu exaucé, la peau réduite à rien devait conduire son propriétaire à la mort ! Je suppose qu’il aurait fallu écrire un autre livre et celui-ci dans une collection de Science-Fiction.
« - Hé ! Hé ! S’écria-t-il en pensant tout à coup à son talisman qu’il tira de sa poche. Soit que, fatigué des luttes de cette longue journée, il n’eût plus la force de gouverner son intelligence dans les flots de vin et de punch ; soit qu’exaspéré par l’image de sa vie, il se fût insensiblement enivré par le torrent de ses paroles, Raphaël s’anima, s’exalta comme un homme complètement privé de raison. – Au diable la mort ! S’écria-t-il en brandissantla Peau. Jeveux vivre maintenant ! Je suis riche, j’ai toutes les vertus. Rien ne me résistera. Qui ne serait pas bon quand il peut tout ? He ! Hé ! Ohé ! J’ai souhaité deux cent mille livres de rentes, je les aurai. Saluez-moi, pourceaux qui vous vautrez sur ces tapis comme sur du fumier ! Vous m’appartenez, fameuse propriété ! Je suis riche, je peux vous acheter tous, même le député qui ronfle là. Allons, canaille de la haute société, bénissez-moi ! Je suis pape. »
 Honoré de Balzac La peau de chagrin Pocket
Honoré de Balzac La peau de chagrin Pocket
09/10/2012 | Lien permanent
Colette : Dialogues de Bêtes
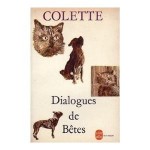 Colette, de son vrai nom Sidonie-Gabrielle Colette, romancière française née à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne) le 28 janvier 1873, clouée dans un fauteuil par l'arthrose elle s'éteint dans son appartement du Palais-Royal le 3 août 1954. Elle a été élue membre de l’Académie Goncourt en 1945.
Colette, de son vrai nom Sidonie-Gabrielle Colette, romancière française née à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne) le 28 janvier 1873, clouée dans un fauteuil par l'arthrose elle s'éteint dans son appartement du Palais-Royal le 3 août 1954. Elle a été élue membre de l’Académie Goncourt en 1945.
Paru en 1904 Dialogues de Bêtes est l’un de ses premiers ouvrages. Deux personnages, Toby-Chien -un chien- et Kiki-La-Doucette -un chat Chartreux-, discutent. Ils parlent de leur vie quotidienne rythmée par les saisons et les actions de Elle et Lui, leurs maîtres « seigneurs de moindre importance ». Comme une pièce de théâtre en douze tableaux, les deux acteurs dialoguent, seuls sur scène. Elle et Lui ne sont qu’évoqués, toujours proches mais jamais vus.
On connaît le monologue de la Pomponette dans La Femme du Boulanger de Marcel Pagnol, l’homme s’adresse à l’animal pour mieux dire à sa femme ce qu’il a sur le cœur, ici c’est un peu l’inverse, les animaux discutent entre eux pour mieux nous faire entrer dans l’intimité de leurs maîtres. Les couples sont formés, le chien et sa maîtresse qu’il adore et ne quitte pas d’une semelle, elle fut artiste de music-hall, le chat et son maître ; les premiers sont actifs, les seconds sont plus calmes, le maître passant son temps à écrire dans son bureau.
Le chien est un peu primaire, le chat plus délicat ; le chien est à la solde de sa maîtresse, le chat plus indépendant ; le premier est tout fou, le second réfléchi. Colette maîtrise parfaitement les codes et les habitudes des animaux, leur transposition dans ce texte au zoomorphisme évident est un pur régal, les caractères des bêtes sont magnifiquement cernés et traduits. Quant au style, même si ce sont principalement des dialogues, il transpire un phrasé et une langue riche et élégante, de la belle ouvrage !
« Toby-Chien. – Tout le bien et tout le mal me viennent d’Elle… Elle est le tourment aigu et le sûr refuge. Lorsque, épouvanté, je me jette en Elle, le cœur fou, que ses bras sont doux, et frais ses cheveux sur mon front ! Je suis son « enfant-noir », son « Toby-Chien », son « tout petit h’amour »… Pour me rassurer Elle s’assoit par terre, se fait petite comme moi, se couche tout à fait, pour m’enivrer de sa figure au-dessous de la mienne, renversée dans sa chevelure qui sent bon le foin et la bête ! Comment résister alors ? Ma passion déborde, je la fouis d’une truffe énervée, je cherche, trouve, mordille le bout croquant et rose d’une oreille – Son oreille ! – jusqu’à ce qu’Elle crie, chatouillée : « Toby ! c’est terrible ! au secours, ce chien me mange ! ».
 Colette Dialogues de Bêtes Le Livre de Poche
Colette Dialogues de Bêtes Le Livre de Poche
10/10/2012 | Lien permanent
Steinbeck : Rue de la sardine
 John Steinbeck est né à Salinas (Californie) en 1902, prix Nobel en 1962 pour l’ensemble de son œuvre, il décède en 1968. En plus de son talent littéraire, ses romans s’adaptant facilement au cinéma lui vaudront une grande renommée. Quelques bouquins incontournables, Des souris et des hommes, Tortilla Flat et son chef d’œuvre Les raisins de la colère. Ce dernier, se déroulant durant la crise économique des années 30, fait partie de ces livres qui vous marquent pour la vie, à lire absolument.
John Steinbeck est né à Salinas (Californie) en 1902, prix Nobel en 1962 pour l’ensemble de son œuvre, il décède en 1968. En plus de son talent littéraire, ses romans s’adaptant facilement au cinéma lui vaudront une grande renommée. Quelques bouquins incontournables, Des souris et des hommes, Tortilla Flat et son chef d’œuvre Les raisins de la colère. Ce dernier, se déroulant durant la crise économique des années 30, fait partie de ces livres qui vous marquent pour la vie, à lire absolument.
Revenons-en à notre sardine. L’action se déroule à Monterey un port de pêche, non loin de Salinas, dans la rue dela Sardine. JohnSteinbeckva nous décrire la vie de ce microcosme vivant entre terrains vagues et rues délabrées. Chômeurs, épicier chinois, bordel, docteur etc. tous les habitants de ce quartier vivent comme ils peuvent. Tous se connaissent et s’observent. Chaque chapitre raconte une petite histoire différente mais tout du long nous suivons Mack et ses potes, des bras cassés au chômage vivant de petites rapines mais caressant des rêves de midinettes ; quand ils récupèrent un entrepôt désaffecté pour y loger, ils se hâtent de le meubler et d’y mettre des rideaux, plus tard Mack s’occupera avec un dévouement attachant d’une petite chienne. Les gros durs du quartiers ne sont en fait que des brutes au grand cœur incapables de mesurer la portée de leurs actes quand par exemple, voulant organiser une petite fête pour remercier le docteur de ses bienfaits, ils vont déclencher une catastrophe en chaîne cassant tout dans la maison du malheureux toubib, qui finalement leur pardonnera.
John Steinbeck nous donne à voir à prime abord, une population miséreuse de petits arnaqueurs, mère maquerelle et putes, mais si on prend le temps de mieux connaître ces gens, ils cachent des trésors de tendresse. « Quelqu’un eut-il regardé par l’autre bout de la lorgnette, il eût pu dire « ce sont des saints, des anges et des martyrs » et ce serait revenu au même ».
« J’ai jamais roulé un homme saoul, c’est pas maintenant que je commencerai ! déclara Mack. Faut tout de même qu’on sorte d’ici. Y va se sentir tout chose, quand y se réveillera, et y va nous met’ tout sur le dos, ça c’est couru ! Ah ! non je veux pas rester ici ! » Mack jeta un coup d’œil sur les rideaux brûlés, sur le plancher trempé de whisky et de trace de chiots, sur la graisse de lard coagulée après le fourneau. Il se dirigea vers les chiots, les examina soigneusement, tâta les os, souleva les paupières, retroussa les babines, et fit choix d’une petite chienne superbement tachetée, d’œil noir et de museau grenat. »Viens, viens, chérie » murmura-t-il. »
 John Steinbeck Rue de la sardine chez Folio
John Steinbeck Rue de la sardine chez Folio
16/10/2012 | Lien permanent
Timur Vermes : Il est de retour
 Timur Vermes, né en 1967 à Nuremberg, est un écrivain allemand d'origine hongroise par son père. Après des études d’histoire et de sciences politiques, il devient journaliste et contribue à de nombreux journaux et magazines. Ancien nègre littéraire, son premier roman, Il est de retour, est paru en 2014.
Timur Vermes, né en 1967 à Nuremberg, est un écrivain allemand d'origine hongroise par son père. Après des études d’histoire et de sciences politiques, il devient journaliste et contribue à de nombreux journaux et magazines. Ancien nègre littéraire, son premier roman, Il est de retour, est paru en 2014.
Dans le Berlin de nos jours, un homme se réveille dans un terrain vague, Adolph Hitler que l’on croyait mort depuis 1945 est de retour ! Voici le pitch sur lequel Timur Vermes a construit son premier roman, une idée originale et provocante à la fois. A priori.
Hitler, le narrateur, ne s’explique pas sa « résurrection » et l’écrivain, à juste titre ne s’y attarde pas non plus. D’emblée le parti pris humoristique de Timur Vermes s’impose ; le ton de la narration et les étonnements successifs du fraichement débarqué face au monde qui a bien changé, amusent le lecteur. La télévision, internet etc. tout est découverte pour le fameux moustachu. Puis les sourires virent au rire jaune quand l’humour noir entre en scène, « La création d’un Etat d’Israël avait visiblement provoqué un appel d’air. On avait eu la bonne idée de placer cet Etat en plein milieu de peuplades arabes, si bien que toutes les parties étaient occupées à se battre les unes contre les autres depuis des décennies et des décennies. » Mais où l’humour est plus subtile, c’est dans les multiples recours au quiproquo : Hitler parle au premier degré tandis que ses interlocuteurs y entendent du second degré, « Et aujourd’hui, vous faites des plaisanteries sur ce sujet à la télévision… - Voilà qui est nouveau, dis-je sur un ton grave. Les juifs ne sont pas un sujet de plaisanterie. » Là, le lecteur rit moins, instruit par l’Histoire passée.
Hitler se baladant dans Berlin ne pouvait passer inaperçu, repéré par une chaîne de télévision et considéré comme un comique de haut niveau, « jouant » son personnage vingt-quatre heures sur vingt-quatre, il fait un tabac à l’audimat avant d’investir le royaume de YouTube. L’écrivain en profite pour fustiger les médias, de l’audiovisuel à la presse du Bild Zeitung. Les uns propulsant un soi-disant comique vers la starisation, l’autre reconstruisant sa popularité passée en vue de continuer son combat d’hier en utilisant cette tribune. Le plus agaçant pour le lecteur – mais c’est aussi le ressort principal et voulu du bouquin – c’est que cet Hitler n’est pas aussi antipathique qu’on le voudrait, comparé aux crétins qui le montent en épingle.
Globalement le roman est souriant et intéressant mais il souffre aussi de longueurs parfois, d’un manque de punch dans l’écriture et surtout de profondeur dans la dénonciation du système. On comprend bien le propos de l’écrivain, nous mettre en garde contre le possible retour de leaders extrémistes qui n’utiliseraient que les outils modernes de communication pour parvenir à leurs fins, mais tout cela reste bien gentillet. Enfin, c’est mieux que rien.
PS : Je vais faire le boulot de l’éditeur, puisqu’il ne l’a pas fait. Information importante pour les lecteurs amateurs, qui n’ont pas comme moi, l’habitude d’éplucher de fond en comble un bouquin avant de le lire, en fin d’ouvrage il y a un glossaire bien venu pour éclairer des points d’Histoire oubliée ou méconnue ; or ce glossaire n’est indiqué nulle part et aucun astérisque ou autre moyen dans le texte n’y renvoie.
« C’était peut-être une erreur ? Déclarai-je. Je veux dire : ces gens ne ressemblent pas du tout à des… - C’est quoi cet argument ? demanda Melle Krömeier d’un ton froid. Et s’ils ont été tués par erreur, ça veut dire que ce n’est pas grave ? Un type s’est dit un jour qu’il fallait tuer les juifs, la voilà l’erreur ! Et les gitans ! Et les homosexuels ! Et tous ceux qui ne lui convenaient pas. Je vais vous dire une chose assez simple : si on ne tue pas, on ne risque pas de se tromper de personnes ! C’est simple comme bonjour ! »
 Timur Vermes Il est de retour Belfond – 393 pages –
Timur Vermes Il est de retour Belfond – 393 pages –
Traduit de l’allemand par Pierre Deshusses
25/11/2015 | Lien permanent | Commentaires (5)
Honoré de Balzac : Séraphîta
 Honoré de Balzac, né à Tours le 20 mai 1799 et mort à Paris le 18 août 1850, romancier, dramaturge, critique littéraire, critique d'art, essayiste, journaliste et imprimeur, il a laissé l'une des plus imposantes œuvres romanesques de la littérature française, avec plus de quatre-vingt-dix romans et nouvelles parus de 1829 à 1855, réunis sous le titre La Comédie humaine. A cela s'ajoutent Les Cent Contes drolatiques, ainsi que des romans de jeunesse publiés sous des pseudonymes et quelque vingt-cinq œuvres ébauchées.
Honoré de Balzac, né à Tours le 20 mai 1799 et mort à Paris le 18 août 1850, romancier, dramaturge, critique littéraire, critique d'art, essayiste, journaliste et imprimeur, il a laissé l'une des plus imposantes œuvres romanesques de la littérature française, avec plus de quatre-vingt-dix romans et nouvelles parus de 1829 à 1855, réunis sous le titre La Comédie humaine. A cela s'ajoutent Les Cent Contes drolatiques, ainsi que des romans de jeunesse publiés sous des pseudonymes et quelque vingt-cinq œuvres ébauchées.
En lisant récemment la biographie de Balzac écrite par François Taillandier, je suis tombé sur cette phrase : « Il considérait Séraphîta comme son chef-d’œuvre. » N’ayant jamais entendu parler de cet ouvrage auparavant j’ai bien entendu été intrigué et obligé d’aller voir par moi-même.
Le roman a fait l’objet de plusieurs éditions, la première en 1834 en feuilleton dans une revue et la dernière et définitive en 1846 dans les Études philosophiques de La Comédie humaine.
Le récit se déroule en Norvège, dans un village du bord de mer, ce qui n’est pas banal car Balzac nous a plus habitués à séjourner à Paris ou en province, très rarement à l’étranger. Les personnages sont peu nombreux ; il y a le pasteur Becker et sa fille Minna ; Wilfrid un jeune homme échoué là par hasard après un long voyage sensé le guérir de son mal-être ; et dans un château, secondé par un vieux serviteur, l’énigmatique Séraphîtüs/Séraphîta. L’ambiguïté autour de cette étrange créature de dix-sept ans s’installe d’emblée pour le lecteur car lorsqu’elle est avec Minna, la fille du pasteur s’adresse à elle comme à un homme et se comporte comme une amoureuse éperdue, puis dans le chapitre suivant, en compagnie de Wilfrid, la situation s’inverse, l’homme avoue son désir charnel à l’être féminin.
Le fantastique, Balzac nous y a déjà habitués (La peau de chagrin) et ce n’est pas réellement son propos ici. En fait il exploite sous forme romanesque, les travaux d’Emanuel Swedenborg (1688-1772) un scientifique, théologien et philosophe suédois qui en fin de vie entra dans une phase spirituelle, avec des rêves et des visions mystiques dans lesquels il discuta avec des anges et des esprits et tant qu’à faire, avec Dieu et Jésus-Christ eux-mêmes.
Séraphîta, appelons-là ainsi, possède des pouvoirs quasi surnaturels et des connaissances inexpliquées au vu de son jeune âge. Elle rêve de connaître un amour transcendant qui consisterait à aimer deux êtres de sexes opposés. Sous la plume de Balzac, de très longues pages exposent ses croyances et sa vision de Dieu, « Ou nous sommes Dieu, ou Dieu n’est pas ! ». Quand le roman s’achève, le corps de Séraphîa meurt mais son esprit s’élève vers les cieux sous les yeux de Minna et Wilfrid et qui décident alors de consacrer le reste de leur vie à retrouver la sensation de bien-être ressentie quand ils étaient en présence de l’Ange, « Nous voulons aller à Dieu, dirent-ils… »
Pour être plus précis, voici le résumé qu’en faisait l’auteur dans une de ses lettres à Mme Hanska, « Il s’agit de montrer un être à la nature double, considéré comme un ange terrestre, objet de l’amour concurrent d’un homme et d’une femme, mais arrivé à sa dernière transformation et qui, témoignant, par son assomption dans les cieux, de la perfectibilité de l’être humain, délivre un message selon lequel l’amour du couple est la figure réelle de l’androgyne mystique et préfigure la reconstitution de l’unité originelle de l’être qui attend l’homme devenu ange au sein de la substance divine. »
J’ai donné au début de ce billet, la raison de mon intérêt - à priori - pour ce livre et je vous promets qu’il faut être sacrément motivé pour lire ce roman ! Outre le sujet, même le style de l’écrivain semble ici particulièrement ampoulé et plein d’emphase. Les longues notes explicatives chères à La Pléiade permettent certes, de remettre cet ouvrage dans son contexte et dans la vison de son auteur ; il n’empêche qu’en tant que simple lecteur, j’ai trouvé cette lecture assez pénible malgré quelques réflexions philosophiques intéressantes, « Si je vous démontre que votre esprit ignore tout ce qui se trouve à sa portée, m’accorderez-vous qu’il lui soit impossible de concevoir ce qui le dépasse ? »
« Séraphitüs défit sa pelisse fourrée de martre, s’y roula, et dormit. Le vieux serviteur resta pendant quelques moments debout à contempler avec amour l’être singulier qui reposait sous ses yeux, et dont le genre eût été difficilement défini par qui que ce soit, même par les savants. A le voir ainsi posé, enveloppé de son vêtement habituel, qui ressemblait autant à un peignoir de femme qu’à un manteau d’homme, il était impossible de ne pas attribuer à une jeune fille les pieds menus qu’il laissait pendre, comme pour montrer la délicatesse avec laquelle la nature les avait attachés ; mais son front, mais le profil de sa tête eussent semblé l’expression de la force humaine arrivée à son plus haut degré. « Elle souffre et ne veut pas me le dire, pensa le vieillard ; elle se meurt comme une fleur frappée par un rayon de soleil trop vif. » Et il pleura, le vieil homme. »
 Honoré de Balzac Séraphîta Gallimard La Pléiade – 131 pages –
Honoré de Balzac Séraphîta Gallimard La Pléiade – 131 pages –
Inclus dans le tome XI de La Comédie humaine (Etudes philosophiques Etudes analytiques)
02/04/2015 | Lien permanent
Conte de Noël
 François Édouard Joachim Coppée (1842 – 1908), est un poète, dramaturge et romancier français. Coppée fut le poète populaire et sentimental de Paris et de ses faubourgs, des tableaux de rue intimistes du monde des humbles. Poète du souvenir d'une première rencontre amoureuse, de la nostalgie d'une autre existence ou de la beauté du crépuscule, il rencontra un grand succès populaire.
François Édouard Joachim Coppée (1842 – 1908), est un poète, dramaturge et romancier français. Coppée fut le poète populaire et sentimental de Paris et de ses faubourgs, des tableaux de rue intimistes du monde des humbles. Poète du souvenir d'une première rencontre amoureuse, de la nostalgie d'une autre existence ou de la beauté du crépuscule, il rencontra un grand succès populaire.
C’est à lui que j’ai confié le soin, cette année, de nous fournir notre conte de Noël : Les sabots du petit Wolff.
« Il était une fois, – il y a si longtemps que tout le monde a oublié la date, – dans une ville du nord de l’Europe, – dont le nom est si difficile à prononcer que personne ne s’en souvient, – il était une fois un petit garçon de sept ans, nommé Wolff, orphelin de père et de mère, et resté à la charge d’une vieille tante, personne dure et avaricieuse, qui n’embrassait son neveu qu’au Jour de l’An et qui poussait un grand soupir de regret chaque fois qu’elle lui servait une écuellée de soupe.
Mais le pauvre petit était d’un si bon naturel, qu’il aimait tout de même la vieille femme, bien qu’elle lui fit grand peur et qu’il ne pût regarder sans trembler la grosse verrue, ornée de quatre poils gris, qu’elle avait au bout du nez. Comme la tante de Wolff était connue de toute la ville pour avoir pignon sur rue et de l’or plein un vieux bas de laine, elle n’avait pas osé envoyer son neveu à l’école des pauvres ; mais elle avait tellement chicané, pour obtenir un rabais, avec le magister chez qui le petit Wolff allait en classe, que ce mauvais pédant, vexé d’avoir un élève si mal vêtu et payant si mal, lui infligeait très souvent, et sans justice aucune, l’écriteau dans le dos et le bonnet d’âne, et excitait même contre lui ses camarades, tous fils de bourgeois cossus, qui faisaient de l’orphelin leur souffre-douleur. Le pauvre mignon était donc malheureux comme les pierres du chemin et se cachait dans tous les coins pour pleurer, quand arrivèrent les fêtes de Noël.
La veille du grand jour, le maître d’école devait conduire tous ses élèves à la messe de minuit et les ramener chez leurs parents. Or, comme l’hiver était très rigoureux, cette année-là, et comme, depuis plusieurs jours, il était tombé une grande quantité de neige, les écoliers vinrent tous au rendez-vous chaudement empaquetés et emmitouflés, avec bonnets de fourrure enfoncés sur les oreilles, doubles et triples vestes, gants et mitaines de tricot et bonnes grosses bottines à clous et à fortes semelles. Seul, le petit Wolff se présenta grelottant sous ses habits de tous les jours et des dimanches, et n’ayant aux pieds que des chaussons de Strasbourg dans de lourds sabots. Ses méchants camarades, devant sa triste mine et sa dégaine de paysan, firent sur son compte mille risées ; mais l’orphelin était tellement occupé à souffler sur ses doigts et souffrait tant de ses engelures, qu’il n’y prit pas garde. – Et la bande de gamins, marchant deux par deux, magister en tête, se mit en route pour la paroisse.
Il faisait bon dans l’église, qui était toute resplendissante de cierges allumés ; et les écoliers, excités par la douce chaleur, profitèrent du tapage de l’orgue et des chants pour bavarder à demi-voix. Ils vantaient les réveillons qui les attendaient dans leurs familles. Le fils du bourgmestre avait vu, avant de partir, une oie monstrueuse, que des truffes tachetaient de points noirs comme un léopard. Chez le premier échevin, il y avait un petit sapin dans une caisse, aux branches duquel pendaient des oranges, des sucreries et des polichinelles. Et la cuisinière du tabellion avait attaché derrière son dos, avec une épingle, les deux brides de son bonnet, ce qu’elle ne faisait que dans ses jours d’inspiration, quand elle était sûre de réussir son fameux plat sucré.
Et puis, les écoliers parlaient aussi de ce que leur apporterait le petit Noël, de ce qu’il déposerait dans leurs souliers, que tous auraient soin, bien entendu, de laisser dans la cheminée avant d’aller se mettre au lit ; et dans les yeux de ces galopins, éveillés comme une poignée de souris, étincelait par avance la joie d’apercevoir, à leur réveil, le papier rose des sacs de pralines, les soldats de plomb rangés en bataillon dans leur boîte, les ménageries sentant le bois verni et les magnifiques pantins habillés de pourpre et de clinquant. Le petit Wolff, lui, savait bien, par expérience, que sa vieille avare de tante l’enverrait se coucher sans souper ; mais, naïvement, et certain d’avoir été, toute l’année, aussi sage et aussi laborieux que possible, il espérait que le petit Noël ne l’oublierait pas, et il comptait bien, tout à l’heure, placer sa paire de sabots dans les cendres du foyer.
La messe de minuit terminée, les fidèles s’en allèrent, impatients du réveillon, et la bande des écoliers, toujours deux par deux et suivant le pédagogue, sortit de l’église. Or, sous le porche, assis sur un banc de pierre surmonté d’une niche ogivale, un enfant était endormi, un enfant couvert d’une robe de laine blanche, et pieds nus, malgré la froidure. Ce n’était point un mendiant, car sa robe était propre et neuve, et, près de lui, sur le sol, on voyait, liés dans une serge, une équerre, une hache, une bisaiguë, et les autres outils de l’apprenti charpentier. Éclairé par la lueur des étoiles, son visage aux yeux clos avait une expression de douceur divine, et ses longs cheveux bouclés, d’un blond roux, semblaient allumer une auréole autour de son front. Mais ses pieds d’enfant, bleuis par le froid de cette nuit cruelle de décembre, faisaient mal à voir.
Les écoliers, si bien vêtus et chaussés pour l’hiver, passèrent indifférents devant l’enfant inconnu ; quelques-uns même, fils des plus gros notables de la ville, jetèrent sur ce vagabond un regard où se lisait tout le mépris des riches pour les pauvres, des gras pour les maigres. Mais le petit Wolff, sortant de l’église le dernier, s’arrêta tout ému devant le bel enfant qui dormait.
– « Hélas ! se dit l’orphelin, c’est affreux ! Ce pauvre petit va sans chaussures par un temps si rude... Mais, ce qui est encore pis, il n’a même pas, ce soir, un soulier ou un sabot à laisser devant lui, pendant son sommeil, afin que le petit Noël y dépose de quoi soulager sa misère ! » Et, emporté par son bon cœur, Wolff retira le sabot de son pied droit, le posa devant l’enfant endormi, et, comme il put, tantôt à cloche-pied, tantôt boitillant et mouillant son chausson dans la neige, il retourna chez sa tante.
– « Voyez le vaurien ! s’écria la vieille, pleine de fureur au retour du déchaussé. Qu’as-tu fait de ton sabot, petit misérable ? » Le petit Wolff ne savait pas mentir, et bien qu’il grelottât de terreur en voyant se hérisser les poils gris sur le nez de la mégère, il essaya, tout en balbutiant, de conter son aventure. Mais la vieille avare partit d’un effrayant éclat de rire.
– « Ah ! Monsieur se déchausse pour les mendiants ! Ah ! Monsieur dépareille sa paire de sabots pour un va-nu-pieds !... Voilà du nouveau, par exemple !... Eh bien, puisqu’il en est ainsi, je vais laisser dans la cheminée le sabot qui te reste, et le petit Noël y mettra cette nuit, je t’en réponds, de quoi te fouetter à ton réveil... Et tu passeras la journée de demain à l’eau et au pain sec... Et nous verrons bien si, la prochaine fois, tu donnes encore tes chaussures au premier vagabond venu ! » Et la méchante femme, après avoir donné au pauvre petit une paire de soufflets, le fit grimper dans la soupente où se trouvait son galetas. Désespéré, l’enfant se coucha dans l’obscurité et s’endormit bientôt sur son oreiller trempé de larmes.
Mais, le lendemain matin, quand la vieille, réveillée par le froid et secouée par son catarrhe, descendit dans sa salle basse, – ô merveille ! – elle vit la grande cheminée pleine de jouets étincelants, de sacs de bonbons magnifiques, de richesses de toutes sortes ; et, devant ce trésor, le sabot droit, que son neveu avait donné au petit vagabond, se trouvait à côté du sabot gauche, qu’elle avait mis là, cette nuit même, et où elle se disposait à planter une poignée de verges. Et, comme le petit Wolff, accouru aux cris de sa tante, s’extasiait ingénument devant les splendides présents de Noël, voilà que de grands rires éclatèrent au dehors. La femme et l’enfant sortirent pour savoir ce que cela signifiait, et virent toutes les commères réunies autour de la fontaine publique. Que se passait-il donc ? Oh ! Une chose bien plaisante et bien extraordinaire ! Les enfants de tous les richards de la ville, ceux que leurs parents voulaient surprendre par les plus beaux cadeaux, n’avaient trouvé que des verges dans leurs souliers.
Alors, l’orphelin et la vieille femme, songeant à toutes les richesses qui étaient dans leur cheminée, se sentirent pleins d’épouvante. Mais, tout à coup, on vit arriver M. le curé, la figure bouleversée. Au-dessus du banc placé près de la porte de l’église, à l’endroit même où, la veille, un enfant, vêtu d’une robe blanche et pieds nus, malgré le grand froid, avait posé sa tête ensommeillée, le prêtre venait de voir un cercle d’or, incrusté dans les vieilles pierres. Et tous se signèrent dévotement, comprenant que ce bel enfant endormi, qui avait auprès de lui des outils de charpentier, était Jésus de Nazareth en personne, redevenu pour une heure tel qu’il était quand il travaillait dans la maison de ses parents, et ils s’inclinèrent devant ce miracle que le bon Dieu avait voulu faire pour récompenser la confiance et la charité d’un enfant. »
24/12/2014 | Lien permanent
Billet de Noël
« Notre enfance que nous regardons luire vaguement si loin derrière nous – et tout ce qui nous en sépare appartient déjà à la nuit – cette nébuleuse de l’enfance, je la vois s’ordonner autour d’un point plus brillant, pareil à ces étoiles avivées de l’hiver : Noël, le temps enchanté… mais l’enchanteur, c’était ce petit garçon : de lui seul, il tirait son pouvoir d’enchantement. Si le génie est de secréter son propre univers, le poète de sept ans auquel je songe, quel génie il avait !
Des prétextes à son bonheur démesuré, je n’en trouve guère. La messe de minuit lui était interdite. Un enfant ne veille pas : telle était la loi inflexible. Le soulier dans la cheminée, quelques bougies roses et bleues autour d’une médiocre crèche, le soir du 24 décembre, chez ma grand-mère, et qui brûlaient, le temps de chanter : « Venez, divin Messie… », il n’en fallait pas plus pour que jaillisse une source de bonheur et de tendresse qui s’épandait sur toutes les créatures vivantes, hommes et bêtes, et sur les choses de mon humble vie. A l’heure où l’enfant tombe comme une pierre au fond du sommeil, le grondement soudain du bourdon de la cathédrale toute proche emplissait la chambre d’une voix sainte et terrible.
Mais non : si dévot que fût l’enfant, ce bonheur débordait le mystère de Noël et le traversait sans s’y mêler. La source au-dedans de moi avait commencé de sourdre bien avant que le bourdon eût bouleversé la nuit. Elle n’avait eu besoin ni de cloches ni de cantiques pour s’épandre hors de moi. Depuis bien des jours je dressais seul, en secret, le décor de ce monde enchanté. »
François Mauriac Mémoires intérieurs (1959)
25/12/2016 | Lien permanent | Commentaires (2)
Interlude de saison
« Quand j’habitais encore avec maman, j’attendais le père Noël toute l’année.
Je me disais « au cas où ça lui dirait de revenir rapport à ma liste qui s’allonge » et je posais mes chaussons près de la cheminée et le matin ils étaient toujours vides et mon cœur aussi. – Je t’ai déjà dit cent fois que le père Noël c’est pas pour rien qu’il s’appelle Noël, gueulait maman, et range-moi donc tes chaussons, y a pas de bonne ici à part moi.
J’ai jamais compris non plus comment il faisait pour descendre par la cheminée avec ses kilos en trop et sa grosse doudoune rouge et ses cadeaux sans se coincer et salir, ou même se brûler à cause du feu qui coûte moins cher que le chauffage et pourquoi il viendrait pas plutôt sonner à la porte, en été et en tee-shirt et baskets, comme ça il serait plus léger et il aurait beaucoup plus de cadeaux dans sa hotte.
En plus il vient la nuit quand je dors et je peux pas lui dire en face que ses cadeaux sont jamais sur ma liste et qu’il a dû se tromper avec un autre enfant avec ses oranges, ses bonbons et ses soldats de plomb, alors que j’ai juste demandé entre autres une voiture de course et un ours géant et un garage comme celui à Grégory. A croire qu’il est aussi sourd que maman quand elle regarde la télé et que je lui pose une question.
Une fois je me suis caché derrière le canapé pour lui dire ma façon de penser et j’ai essayé de garder les yeux ouverts mais le père Noël a dû m’envoyer une poudre magique et je me suis endormi et maman m’a réveillé « si le père Noël te voit une seule fois, il ne viendra plus jamais » et j’ai pas recommencé et j’étais quand même bien content de jouer avec mes soldats de plomb. »
Extrait du roman de Gilles Paris « Autobiographie d’une courgette »
24/12/2017 | Lien permanent | Commentaires (2)
Franzobel : A ce point de folie
 Franzobel (pseudonyme pour Franz Stefan Griebl), né en 1967 à Vöcklabruck, est un écrivain autrichien. Après avoir fait des études d'allemand et d'histoire et travaillé au Burgtheater de Vienne, en 1989 il se lance dans l’écriture. A ce point de folie est son tout nouveau roman.
Franzobel (pseudonyme pour Franz Stefan Griebl), né en 1967 à Vöcklabruck, est un écrivain autrichien. Après avoir fait des études d'allemand et d'histoire et travaillé au Burgtheater de Vienne, en 1989 il se lance dans l’écriture. A ce point de folie est son tout nouveau roman.
Le 17 juin 1816, La Méduse quitte Rochefort à destination de Saint-Louis au Sénégal, embarquant 400 passagers sans compter l’équipage. Au commandement, un capitaine dont l’incompétence avérée est à l’origine du naufrage de la frégate après quelques jours de mer. Comme les chaloupes sont en trop petit nombre, 147 voyageurs sont abandonnés sur un radeau. Seuls quinze d’entre eux en réchapperont au terme de treize journées d’enfer, jalonnées de meurtres, de corps dépecés et d’ultimes stratégies de survie. L’un des rescapés, le médecin de bord Jean-Baptiste Henri Savigny, fera le récit de ce périple tragique, que le monde entier voudra connaître jusque dans ses détails les plus atroces…
Comme l’indiquait le sous-titre du roman, « d’après l’histoire du naufrage de La Méduse » et ce court résumé, A ce point de folie nous entraine dans cette folle aventure dramatique. S’il s’agit bien d’un roman, tout y est vrai aussi, les noms et les faits, comme j’ai pu le vérifier par de rapides recherches.
Je ne vais pas m’attarder plus longtemps sur l’histoire, le résumé en dit l’essentiel et le reste vous le lirez. Sachez que c’est rondement mené d’une écriture très vivante et qu’on lit ce bouquin goulûment du début jusqu’à la fin. Les personnages sont particulièrement bien campés (en particulier les officiers bouffis de suffisance et d’incompétence), les dialogues sont fort bien troussés, c’est bien documenté sur la vie à bord en ces temps-là, le texte est imagé et l’écrivain a choisi de maintenir une certaine distance entre son texte et le lecteur soit en usant de phrases telles que « Quant à nous, qui avons pour l’instant bien assez visité les entrailles crasseuses du navire, nous devrions être impatients de savoir ce qui se passait sur le gaillard d’arrière, là où se tenait le capitaine… », à moins qu’il n’y glisse des références contemporaines comme ce, « Imaginons un genre de Lino Ventura jeune. »
L’humour est aussi du voyage, « … elles jouissaient de l’attention qu’on accordait à bord à toutes les créatures féminines (depuis la figure de proue jusqu’à la chèvre embarquée, en passant par la fille du gouverneur) » et les clins d’yeux aussi, « il levait la main en signe de refus. Je préférerais ne pas. » Tout cela pour vous dire, et je voudrais insister sur ce point : certes il s’agit d’un drame, de plus historiquement avéré, mais Franzobel a pris délibérément le parti d’en parler sans appuyer sur le côté morbide et atroce des faits, tout au contraire, le texte est léger, très souvent drôle même dans les pires situations. Que ceux qui seraient effrayés, a priori, par les cadavres et le cannibalisme qu’on sait trouver dans ce livre, n’aient peur, le ton général du récit vous fera digérer (sic !) le truc.
Voilà pour la forme. Pour le fond, la question centrale du cannibalisme est posée, « Il devait manger, mais l’effroi le paralysait. Il s’accrochait à des mots comme morale, civilisation, culture, tel un noyé s’agrippe à son tronc d’arbre. » Sauf que les mots sont bien beaux quand on disserte dans un fauteuil dans son salon… Avec de ci-de là, quelques résonnances avec l’actualité et ces migrants en Méditerranée…
Un bon roman et je le répète lourdement, beaucoup moins épouvantable que certains (comme l’éditeur ?) voudraient nous le faire croire…
« Il but du vin, lequel était beaucoup trop chaud, puis essuya les gouttelettes restées sur sa lèvre supérieure. Terminé ! Tous ses cauchemars étaient devenus réalités. Ensablés ! Ils allaient devoir rejoindre la côte en chaloupe. Et s’ils étaient pris dans une tempête ? S’il devait aller aux toilettes ? Et qui le poudrerais ? Sur la côte, ils seraient attendus par les Berbères et les cannibales. Epouvantable. A cet instant seulement, il comprit la portée de cette catastrophe. L’angoisse l’envahissait tout entier. »
 Franzobel A ce point de folie Flammarion – 516 pages – (A paraître le 22 août 2018)
Franzobel A ce point de folie Flammarion – 516 pages – (A paraître le 22 août 2018)
Traduit de l’allemand (Autriche) par Olivier Mannoni
« A l’inauguration du Salon de peinture et de sculpture de Paris, en 1819, il [Louis XVIII] dit à un jeune artiste qui, déployant une énergie surhumaine, avait fixé ces évènements sur une gigantesque toile : « M. Géricault, votre naufrage, là, ça n’est pas pour nous ! » Le gras souverain prit le temps d’esquisser un geste de dédain, avant de repartir d’un pas flegmatique entouré de sa suite… » [p.15]

20/08/2018 | Lien permanent | Commentaires (2)


