Rechercher : les grands cerfs
George Orwell : Sommes-nous ce que nous lisons ?
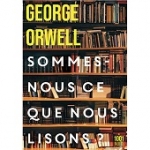 George Orwell, pseudonyme d’Eric Arthur Blair, né en 1903 au Bengale et mort en 1950 à Londres, est un écrivain, essayiste et journaliste britannique. Politiquement engagé, il prend part à la guerre civile espagnole en 1936 dans les rangs des milices trotskistes mais l’attitude des communistes espagnols finit par ébranler ses convictions politiques d’homme de gauche. Ecrivain, il est célèbre pour ses romans, La Ferme des animaux (1945) et surtout 1984 (1949).
George Orwell, pseudonyme d’Eric Arthur Blair, né en 1903 au Bengale et mort en 1950 à Londres, est un écrivain, essayiste et journaliste britannique. Politiquement engagé, il prend part à la guerre civile espagnole en 1936 dans les rangs des milices trotskistes mais l’attitude des communistes espagnols finit par ébranler ses convictions politiques d’homme de gauche. Ecrivain, il est célèbre pour ses romans, La Ferme des animaux (1945) et surtout 1984 (1949).
Sommes-nous ce que nous lisons ? vient de paraître dans une collection de poche, je dirais même de poche de chemise, tant le livre est petit et fin. L’ouvrage reprend quatre articles écrits pour la presse entre 1936 et 1946. Si je mets de côté le titre du livre qui ne me semble pas répondre exactement à son contenu, ce fascicule est génial à mes yeux car il dit tout haut, beaucoup de mes propres convictions concernant les livres et leurs critiques.
Souvenirs de librairie, comme son titre l’indique, permet à Orwell d’évoquer l’époque où il travaillait dans une bouquinerie et ses commentaires sur les clients, en particulier « le contingent de toqués » qui la fréquentait sont extrêmement drôles. Commentaires qui peuvent néanmoins parfois s’avérer erronés « Les grandes entreprises ne pourront jamais anéantir les petites librairies indépendantes comme elles l’ont fait des épiciers et des laitiers. » Ecrivain rime avec devin mais n’est pas synonyme !
Confessions d’un critique littéraire, où l’on prend conscience de la dureté du métier et des compromissions inévitables pour survivre, « un métier qui suppose, non seulement d’encenser des bouses (…) mais aussi d’inventer en permanence des réactions à des livres qui n’en provoquent pas l’ombre d’une. » Et celle-ci « La grande majorité des chroniques ne donnent des livres qu’un aperçu insuffisant ou trompeur. » Enfin, pour la bonne bouche une prémonition bien vue celle-là, Orwell « invente » les blogueurs : « La critique, notamment celle des romans, pourrait échoir à des amateurs ». En quatre pages le mec plie l’affaire ! Génial, j’ai dit.
Les bons mauvais livres, expression de Chesterton, est développée ici par Orwell à partir d’exemples précis comme La Case de l’oncle Tom ou la série des Sherlock Holmes.
Des livres ou des cigarettes, traite du coût de la lecture qu’on dit onéreux mais qu’Orwell dément par un calcul mathématique de ses dépenses.
Un bouquin minuscule, une lecture impérative. Point.
« Ainsi, rien ne changera tant que l’on continuera à juger que tous les livres méritent d’être chroniqués. Il est pratiquement impossible de traiter un grand nombres de livres sans tresser des lauriers immérités à l’écrasante majorité d’entre eux. C’est lorsqu’on commence à entretenir une relation professionnelle avec les livres que l’on découvre à quel point ils sont généralement mauvais. Dans plus de neuf cas sur dix, la seule critique objective consisterait à dire : « Ce livre est nul » ».
 George Orwell Sommes-nous ce que nous lisons ? Editions Mille et Une Nuits - 49 pages –
George Orwell Sommes-nous ce que nous lisons ? Editions Mille et Une Nuits - 49 pages –
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Charles Recoursé
19/05/2022 | Lien permanent | Commentaires (4)
Maurice Leblanc : La Femme aux deux sourires
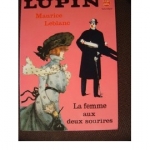 Marie Emile Maurice Leblanc est un romancier français (1864-1941). Auteur de nombreux romans policiers et d’aventures, il est le créateur du célèbre gentleman-cambrioleur Arsène Lupin. Relégué au rang de « Conan Doyle français », Maurice Leblanc est un écrivain populaire qui a souffert de ne pas avoir la reconnaissance de ses confrères mais a toujours suscité un solide noyau d'amateurs. La série Arsène Lupin compte 17 romans et 39 nouvelles, ainsi que 5 pièces de théâtre, tous écrits de 1905 à 1941. La Femme aux deux sourires date de 1933.
Marie Emile Maurice Leblanc est un romancier français (1864-1941). Auteur de nombreux romans policiers et d’aventures, il est le créateur du célèbre gentleman-cambrioleur Arsène Lupin. Relégué au rang de « Conan Doyle français », Maurice Leblanc est un écrivain populaire qui a souffert de ne pas avoir la reconnaissance de ses confrères mais a toujours suscité un solide noyau d'amateurs. La série Arsène Lupin compte 17 romans et 39 nouvelles, ainsi que 5 pièces de théâtre, tous écrits de 1905 à 1941. La Femme aux deux sourires date de 1933.
Elisabeth Hornain, chanteuse lyrique, est assassinée et ses bijoux volés lors d’une prestation improvisée dans le parc d’un château, personne n’a rien vu, la police ne comprend rien. Quinze ans plus tard, débute le roman. A Paris, l’inspecteur Gorgeret n’a pas enterré l’affaire mais pour l’heure il est sur la piste de Clara la Blonde, maîtresse du grand Paul, truand notoire. La belle jeune femme se rend chez le marquis Jean d’Erlemont, sur les quais de Seine, mais elle se trompe d’étage et c’est monsieur Raoul qui ouvre, quand la police déboule le Raoul trouve une combine pour planquer la mignonne. Ce sang-froid face à l’imprévu n’est pas vraiment étrange quand on comprend qu’il s’agit en fait, d’Arsène Lupin, lui-même très intéressé par les activités du marquis d’Erlemont…
Le reste de l’intrigue est tellement abracadabrant que je ne me risque pas à tenter de vouloir la résumer, avec Arsène Lupin le gentleman cambrioleur il en est toujours ainsi, et c’est pour moi, tout ce qui en fait le charme désuet.
Le roman mené à bon train nous conduit des bouges dans les caves de Montmartre aux cabarets huppés des Champs-Elysées, les personnages cachent leurs petits secrets sous des identités en double, Raoul est Lupin, le grand Paul est aussi le très chic Verthex et la belle Clara ressemble comme deux gouttes d’eau à une certaine Antonine, toutes deux convoitées par Raoul et grand Paul ! Le tout sous les yeux médusés du pauvre Gorgeret qui veut arrêter tout le monde, du Paul qui veut buter Raoul, lequel fait des pieds et des mains pour sauver Clara mal embarquée dans cette histoire.
Petite pause, le temps que je reprenne mon souffle.
Humour (« Elle dit qu’elle est la fille de Mme Thérèse, de Lisieux, et qu’elle apporte une lettre de sa mère »), sexy folies pour oies blanches (« Allait-elle le repousser comme dans le salon de Volnic ? L’accueillir ? Elle ne résista pas. » Le rythme est alerte, vif, les rebondissements plus spectaculaires les uns que les autres, au point que moi qui aime à tenter de deviner la fin des romans avant leur fin, j’en ai laissé tomber l’idée très vite, me laissant bousculer par cette rocambole…esque histoire.
Bref, je me suis bien amusé avec ce bouquin sans prétentions mais fort distrayant.
« - Le 3 juillet, à quatre heures, je vous apporterai la vérité sur le drame et sur toutes les énigmes qui le compliquent. Et je vous apporterai également l’héritage de votre grand-père maternel… ce qui permettra à mademoiselle, pour peu qu’elle en ait envie, et moyennant la simple restitution du chèque que j’ai signé tout à l’heure, de conserver et d’habiter ce château qui semble tellement lui plaire. – Alors… alors…, fit d’Erlemont, très ému, vous croyez vraiment réussir à ce point ? »
 Maurice Leblanc La Femme aux deux sourires Le Livre de Poche - 315 pages -
Maurice Leblanc La Femme aux deux sourires Le Livre de Poche - 315 pages -
24/11/2022 | Lien permanent | Commentaires (4)
Margaret Kennedy : Le Festin
 Margaret Kennedy (1896-1967) est une femme de lettres, romancière et scénariste britannique. Paru en 1951 sous le titre La Fête, le roman vient d’être réédité en poche sous son nouveau titre, Le Festin.
Margaret Kennedy (1896-1967) est une femme de lettres, romancière et scénariste britannique. Paru en 1951 sous le titre La Fête, le roman vient d’être réédité en poche sous son nouveau titre, Le Festin.
Cornouailles en 1947. Le révérend Seddon venu rendre une visite au père Bott, le trouve en pleine rédaction d’une oraison funèbre, un hôtel vient d’être emporté par l'éboulement de la falaise qui le surplombait. Les survivants choqués ont raconté au père Bott leurs derniers jours, corps du récit…
L’hôtel était tenu par les Siddal, couple ruiné avec trois grands garçons, ayant transformé leur grande demeure en hôtel. C’est elle qui gère la baraque, Dick le mari, personnage falot vit à l’écart dans un placard ! Le personnel se compose de l’intendante Dorothy Ellis, femme acariâtre qui déteste tout le monde, Fred le serveur et la charmante Nancibel Thomas la femme de chambre.
Les pensionnaires forment une troupe très hétéroclite : Lady Eirene et sir Henry Gifford, elle est en mauvaise santé et garde la chambre, ils ont quatre enfants adoptés ; les Cove, une veuve avec trois fillettes maltraitées ; le chanoine Wraxton, un caractère de chien, et sa fille Evangeline, timorée ; le couple Paley ; Anna Lechene, écrivaine, cynique, d’un certain âge et son chauffeur/amant Bruce, à sa botte par intérêt.
Le roman est découpé en sept chapitres, les sept derniers jours avant le drame. Un bouquin très agréable à lire avec un je ne sais quoi qui l’apparenterait presque à un polar avec son petit suspense : on sait que la falaise va s’écrouler, on apprendra que certains le savaient mais n’en ont pas tenu compte, on ne sait pas qui va mourir.
Les très nombreux personnages sont pour l’écrivaine une véritable foire aux caractères, méchanceté, rancune, tous ou presque sont assez épouvantables dans leur genre, les ragots circulent, les vilénies se révèlent, une statuette est volée, des liaisons amoureuses se créent, etc. Le summum de l’ignominie semble atteint quand les petites Cove manquent se noyer sous l’œil désintéressé de leur mère !
Petites filles qui souhaiteraient, unique moment réjouissant de leur courte vie, organiser un festin pour tout le monde dans l’hôtel. Mais elles n’ont pas d’argent, c’est la sortie de la guerre, les tickets de rationnement sont nécessaires. Quelques pensionnaires vont les aider dans leur entreprise, poussant les plus récalcitrant à participer, festin qui se tient sur la falaise, laquelle s’effondre.
Il se passe tant de choses dans ce roman qu’il est impossible d’en dire plus et malgré ce qui pourrait être un grand désordre (évènements multiples, personnages nombreux) le lecteur suit cette histoire avec beaucoup d’intérêt. L’intrigue par elle-même étant constellée de petits détails sur la situation sociale/politique de la Grande Bretagne à cette époque (« Ce n’est pas de l’argent que les gens veulent de nos jours. On n’en serait pas là sans ça. Tout ce qu’ils veulent, c’est travailler de moins en moins. ») qui sonne étonnement moderne.
Il paraît qu’on peut aussi y trouver la trace des sept pêchés capitaux (Gourmandise, colère, luxure, orgueil, envie, paresse, avarice) incarnés chez certains acteurs du livre, la comparaison religieuse pouvant être prolongée par les sept jours précédant le big-bang fatal, lui-même métaphore d’un monde qui disparaît, « Moi, je ne crois pas qu’aucune catégorie d’individus soit particulièrement responsable de ce monde qui s’effondre. S’il n’y avait pas quelque tare en chacun de nous, on pourrait s’arranger de n’importe quelle catégorie, si dangereuse fût-elle. »
Un bon roman.
« Elle n’aimait pas sa mère. Il ne venait à l’esprit d’aucune d’elles qu’elles auraient dû l’aimer. Mrs Cove n’avait jamais recherché leur affection. Mais elles ne la jugeaient pas, ni ne se révoltaient contre elle. Celle-ci dominait et gouvernait leur vie à la manière d’un climat hostile et elles acceptaient sa loi comme un mal inévitable, échappant à sa dureté par instinct plus que par raison. Car leur mère n’avait de contrôle que sur leur vie extérieure et matérielle ; elle n’avait pas de prise sur leur âme. »
 Margaret Kennedy Le Festin Folio - 565 pages –
Margaret Kennedy Le Festin Folio - 565 pages –
Traduction de l’anglais par Denise Van Moppès entièrement révisée
09/10/2023 | Lien permanent | Commentaires (6)
Philip Roth : Tromperie
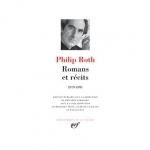 Philip Milton Roth (1933-2018) écrivain américain, auteur d'un recueil de nouvelles et de 26 romans est l’un des plus grands écrivains de son siècle. Tromperie est un roman datant de 1990.
Philip Milton Roth (1933-2018) écrivain américain, auteur d'un recueil de nouvelles et de 26 romans est l’un des plus grands écrivains de son siècle. Tromperie est un roman datant de 1990.
Dès les premières lignes le lecteur est pris de court par la forme narrative adoptée par Philip Roth, des dialogues, uniquement des dialogues. Nous entrons dans le roman comme si, nous asseyant à une table dans un café, nous surprenions la conversation entre un couple installé derrière nous, nous ne savons rien d’eux mais ils discutent de choses intimes.
Au fur et à mesure de notre avancée dans le texte nous constaterons qu’il se divise en quatorze scènes ; que l’homme se prénomme Philip, romancier américain installé temporairement à Londres, et qu’à chaque fois il discute avec des femmes diverses : sa maîtresse anglaise, des immigrées tchèques, une Polonaise, une étudiante américaine, une amie qui soigne un cancer, son épouse. Certaines ne passent que lors d’une scène, d’autres reviennent comme sa maîtresse avec laquelle nous constatons que les années défilent.
Ces discussions renvoient le lecteur habitué à Roth à plusieurs de ses romans, comme par exemple quand Philip interroge sa maîtresse anglaise « Pourquoi dans ce pays déteste-t-on autant Israël ? », la judéité étant l’un des thèmes abordés par le bouquin mais plus encore les liens entre les hommes et les femmes et leur façon d’aborder l’adultère, avant qu’il n’en vienne à l’une de ses grandes exaspérations quand sa femme lit à son insu son carnet de notes (c’est-à-dire le roman que nous achevons) et pique une crise de jalousie, confondant la fiction imaginée ( ?) par l’auteur et la réalité. Ce fameux cas de conscience soulevé par de nombreux récits trop proches de la vérité vécue.
En lisant le roman j’étais étonné que le titre soit écrit au singulier mais c’est parce qu’il faut l’entendre au sens général ou universel de la tromperie, tromperie en cas d’adultère, tromperie entre la fiction du livre et la réalité de la vie de l’auteur.
Tromperie ne fait pas partie des « grands romans » de l’auteur et ne sera pas conseillé à un lecteur qui souhaite découvrir l’écrivain, mais il est largement assez bon pour satisfaire les autres.
« Une des choses injustes au sujet de l’adultère, quand on compare l’amant à l’époux, c’est qu’on ne voit jamais l’amant dans aucune de ces affreuses et ennuyeuses situations, par exemple récriminant à propos des légumes, ou faisant brûler les toasts, ou oubliant de commander quelque chose, ou encore essayant d’exploiter quelqu’un ou se laissant exploiter. Tous ces trucs dont, je crois, les gens prennent grand soin de protéger leurs liaisons. Je généralise à partir d’une expérience minuscule, minuscule, quasiment nulle. Mais je crois que c’est ce qu’ils font. Car sinon, ce serait tellement exténuant. A moins d’aimer mener de pair deux jeux de conflits familiaux, et de pouvoir passer de l’un à l’autre. »
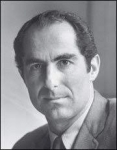 Philip Roth Tromperie Gallimard La Pléiade « Romans et récits 1979-1991 » – 120 pages –
Philip Roth Tromperie Gallimard La Pléiade « Romans et récits 1979-1991 » – 120 pages –
Traduction française par Maurice Rambaud
22/04/2022 | Lien permanent | Commentaires (2)
T.C. Boyle : Un Ciel si bleu
 T.C. Boyle (Tom Coraghessan Boyle) est un écrivain et romancier américain né en 1948 dans l’Etat de New York. Depuis 1978, il anime des ateliers d’écriture à l’Université de Californie du Sud et vit près de Santa Barbara, dans une maison dessinée par l’architecte Frank Lloyd Wright. Un Ciel si bleu, son nouveau roman, vient de paraître.
T.C. Boyle (Tom Coraghessan Boyle) est un écrivain et romancier américain né en 1948 dans l’Etat de New York. Depuis 1978, il anime des ateliers d’écriture à l’Université de Californie du Sud et vit près de Santa Barbara, dans une maison dessinée par l’architecte Frank Lloyd Wright. Un Ciel si bleu, son nouveau roman, vient de paraître.
Le roman se déroule entre la Floride et la Californie et court sur plusieurs années. Sur la côte Ouest, dans leur belle maison, Ottilie la mère de famille, élève des grillons destinés à remplacer la viande pour les repas sur les conseils de son fils Cooper, écologiste convaincu et étudiant en entomologie, tandis que Frank, le père, médecin, approche de la retraite. A l’autre bout du pays, en Floride, Cat leur fille, s’est installée avec Todd dans une maison en bord de plage ; lui, est ambassadeur pour les alcools Bacardi et mène grand train, elle, se rêve influenceuse sur internet !
Ainsi planté, c’est un peu comme un conte pour bobos sous le ciel bleu, verres de vin (car oui, ça picole beaucoup) et piscine… sauf que de nos jours, il n’y a plus de saisons ni même de climat. En Californie, c’est la fournaise, en Floride il pleut sans arrêt, les grandes marées submergent les routes et la mer gagne continuellement du terrain sur la plage et s’attaque aux maisons.
Conséquence, à l’Ouest du nouveau, un beau jour les insectes meurent tous et Cooper veut savoir pourquoi exactement, pas de pot avec ceux qui ne meurent pas, comme une tique qui va le piquer, l’infecter grave et obliger la médecine à l’amputer d’un bras. A l’Est ce n’est guère mieux avec les bestioles, Cat pour faire « mode » s’offre un python avec lequel elle parade sur les réseaux sociaux et dans les bars, le reptile autour du cou, le bestiau va grossir, s’échapper malencontreusement et provoquer un drame terrible. La pauvre Ottilie, faisant la navette entre Californie et Floride pour combler les manques.
Il se passe évidemment beaucoup d’autres choses dans ce roman dont vous comprenez que les effets du réchauffement climatique sont au cœur du sujet : pour les uns chaleur, sécheresse (« « Buvez beaucoup », dit-elle, ce qui équivalait désormais au « Bonne journée » de naguère. »), pluies, ouragans, crues et grandes marées pour les autres. Les gens s’adaptent comme ils peuvent, avec ce pragmatisme américain dans « cette société dingue qu’était l’Amérique contemporaine ».
Comme toujours chez l’écrivain, le texte est dense, très précis et détaillé, les évènements s’enchainent avec facilité et rythme. Boyle montre sans prendre parti. Le monde est mal barré ? Pourtant le roman s’achève sur une scène d’une grande beauté dont les papillons monarques font le décor… espoir ?
Excellent roman.
« Mais en fin de compte, sa mère promit de lui envoyer de l’argent, qu’à son tour, elle promit de rembourser. Elle était une ratée, toutes deux le savaient, une paumée qui avait perdu un enfant et son mari, qui travaillait à mi-temps comme serveuse, un boulot tellement indigne d’elle ; tous les jours, elle perdait des neurones à la pelle et s’accrochait à la maison comme si cela pouvait la racheter de toutes les forces liguées contre elle, à commencer par la montée des eaux et les termites qui avaient migré depuis la lointaine Asie pour saper le peu qui restait. »
 T.C. Boyle Un Ciel si bleu Grasset - 520 pages -
T.C. Boyle Un Ciel si bleu Grasset - 520 pages -
Traduction de l’anglais (Etats-Unis) par Bernard Turle
04/04/2024 | Lien permanent | Commentaires (6)
Bruce Chatwin : Le chant des pistes
 On ne présente plus Bruce Chatwin le fameux écrivain voyageur et de grande culture trop tôt disparu. Tous ses livres sont un pur régal pour ceux qui aiment les voyages, les rencontres et l’aventure, le tout baignant dans des références culturelles nombreuses et enrichissantes.
On ne présente plus Bruce Chatwin le fameux écrivain voyageur et de grande culture trop tôt disparu. Tous ses livres sont un pur régal pour ceux qui aiment les voyages, les rencontres et l’aventure, le tout baignant dans des références culturelles nombreuses et enrichissantes.
Avec Le chant des pistes nous parcourons l’Australie, non pas un pays mais un continent où la trace des premiers hommes interroge l’écrivain sur nos origines. Quant au titre du livre il fait référence à l’enquête menée sur le terrain pour comprendre la théorie des aborigènes qui veut que « lors de sa traversée du pays, chaque ancêtre avait laissé dans son sillage une suite de mots et de notes de musique et comment ces pistes de rêve formaient dans tout le pays des « voies » de communications entre les tribus les plus éloignées. Un chant était à la fois une carte et u topo-guide. Pour peu que vous connaissiez le chant, vous pouviez toujours vous repérer sur le terrain. »
Expert en arts, Bruce Chatwin ne manque pas de s’intéresser aux peintures rupestres et aux tableaux peints par les artistes locaux qui sous un abord naïf recèlent des pans de l’histoire de l’humanité. Un grand livre de voyage mais surtout une ode à l’humanité et une passerelle entre les cultures des quatre coins du monde, dont les similitudes identifiables ne peuvent que prouver nos origines communes.
« Les psychiatres, les politiciens, les tyrans nous assurent depuis toujours que la vie vagabonde est un comportement aberrant, une névrose, une forme d’expression des frustrations sexuelles, une maladie qui, dans l’intérêt de la civilisation, doit être combattue. Les propagandistes nazis affirmaient que les Tsiganes et les Juifs –peuples possédant le voyage dans leurs gènes- n’avaient pas leur place dans un Reich stable. Cependant à l’Est, on conserve toujours ce concept, jadis universel, selon lequel le voyage rétablit l’harmonie originelle qui existait entre l’homme et l’univers. »
 Bruce Chatwin Le chant des pistes Le Livre de Poche
Bruce Chatwin Le chant des pistes Le Livre de Poche
10/10/2012 | Lien permanent
Joan Didion : L’Amérique
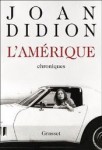 Joan Didion née en 1934 à Sacramento n’était pas très connue en France jusqu’à ces dernières années malgré son talent reconnu aux Etats-Unis, mais ce livre va certainement la faire sortir de son anonymat chez nous.
Joan Didion née en 1934 à Sacramento n’était pas très connue en France jusqu’à ces dernières années malgré son talent reconnu aux Etats-Unis, mais ce livre va certainement la faire sortir de son anonymat chez nous.
Il ne s’agit pas d’un roman, d’ailleurs le sous-titre imprimé sur la couverture est « chroniques » et dans ce genre littéraire, Joan Didion est un maître. A travers une dizaine de textes écrits entre 1960 et 1980, un recueil de reportages, elle nous raconte son Amérique. Car si nous plongeons avec délice dans le San Francisco hippie de 1967 ou si nous rencontrons John Wayne, c’est par le prisme de l’œil de Joan Didion, une Joan Didion flirtant avec ses problèmes psychologiques « Je me fais l’effet d’une somnambule, sensible uniquement à l’étoffe dont sont faits les mauvais rêves ». Les portraits, les réflexions sur l’époque et les lieux qu’elle fréquente sont empreints de cynisme mais néanmoins d’une cruelle lucidité. Les Doors, le groupe de rock, les Black Panthers, la « famille » Manson qui massacre Sharon Tate la femme de Roman Polanski, le meurtre d’une joggeuse dans Central Park à New York, autant de reportages et de regards sur une Amérique qui est en pleine mutation.
Un beau livre, très réaliste, écrit à la première personne, par une écrivaine jamais dupe des évènements qu’elle observe avec acuité, sachant prendre immédiatement le recul nécessaire à l’analyse. J’ai maintenant très envie d’explorer rapidement sa bibliographie.
« Rien de très grave ne pouvait arriver dans le rêve, rien qu’un homme ne pût affronter. Et pourtant. La voilà qui arriva, la rumeur, et au bout d’un moment les grands titres. « J’ai eu la peau du Grand C », annonça John Wayne, à la manière de John Wayne, traitant ces cellules renégates comme n’importe quel autre renégat, et pourtant nous sentions tous que l’issue de cet affrontement-là était pour une fois imprévisible, que c’était le seul et unique duel que Wayne risquait de perdre. »
 Joan Didion L’Amérique (Chroniques) chez Grasset
Joan Didion L’Amérique (Chroniques) chez Grasset
12/10/2012 | Lien permanent
Conte de Noël
 François Édouard Joachim Coppée (1842 – 1908), est un poète, dramaturge et romancier français. Coppée fut le poète populaire et sentimental de Paris et de ses faubourgs, des tableaux de rue intimistes du monde des humbles. Poète du souvenir d'une première rencontre amoureuse, de la nostalgie d'une autre existence ou de la beauté du crépuscule, il rencontra un grand succès populaire.
François Édouard Joachim Coppée (1842 – 1908), est un poète, dramaturge et romancier français. Coppée fut le poète populaire et sentimental de Paris et de ses faubourgs, des tableaux de rue intimistes du monde des humbles. Poète du souvenir d'une première rencontre amoureuse, de la nostalgie d'une autre existence ou de la beauté du crépuscule, il rencontra un grand succès populaire.
C’est à lui que j’ai confié le soin, cette année, de nous fournir notre conte de Noël : Les sabots du petit Wolff.
« Il était une fois, – il y a si longtemps que tout le monde a oublié la date, – dans une ville du nord de l’Europe, – dont le nom est si difficile à prononcer que personne ne s’en souvient, – il était une fois un petit garçon de sept ans, nommé Wolff, orphelin de père et de mère, et resté à la charge d’une vieille tante, personne dure et avaricieuse, qui n’embrassait son neveu qu’au Jour de l’An et qui poussait un grand soupir de regret chaque fois qu’elle lui servait une écuellée de soupe.
Mais le pauvre petit était d’un si bon naturel, qu’il aimait tout de même la vieille femme, bien qu’elle lui fit grand peur et qu’il ne pût regarder sans trembler la grosse verrue, ornée de quatre poils gris, qu’elle avait au bout du nez. Comme la tante de Wolff était connue de toute la ville pour avoir pignon sur rue et de l’or plein un vieux bas de laine, elle n’avait pas osé envoyer son neveu à l’école des pauvres ; mais elle avait tellement chicané, pour obtenir un rabais, avec le magister chez qui le petit Wolff allait en classe, que ce mauvais pédant, vexé d’avoir un élève si mal vêtu et payant si mal, lui infligeait très souvent, et sans justice aucune, l’écriteau dans le dos et le bonnet d’âne, et excitait même contre lui ses camarades, tous fils de bourgeois cossus, qui faisaient de l’orphelin leur souffre-douleur. Le pauvre mignon était donc malheureux comme les pierres du chemin et se cachait dans tous les coins pour pleurer, quand arrivèrent les fêtes de Noël.
La veille du grand jour, le maître d’école devait conduire tous ses élèves à la messe de minuit et les ramener chez leurs parents. Or, comme l’hiver était très rigoureux, cette année-là, et comme, depuis plusieurs jours, il était tombé une grande quantité de neige, les écoliers vinrent tous au rendez-vous chaudement empaquetés et emmitouflés, avec bonnets de fourrure enfoncés sur les oreilles, doubles et triples vestes, gants et mitaines de tricot et bonnes grosses bottines à clous et à fortes semelles. Seul, le petit Wolff se présenta grelottant sous ses habits de tous les jours et des dimanches, et n’ayant aux pieds que des chaussons de Strasbourg dans de lourds sabots. Ses méchants camarades, devant sa triste mine et sa dégaine de paysan, firent sur son compte mille risées ; mais l’orphelin était tellement occupé à souffler sur ses doigts et souffrait tant de ses engelures, qu’il n’y prit pas garde. – Et la bande de gamins, marchant deux par deux, magister en tête, se mit en route pour la paroisse.
Il faisait bon dans l’église, qui était toute resplendissante de cierges allumés ; et les écoliers, excités par la douce chaleur, profitèrent du tapage de l’orgue et des chants pour bavarder à demi-voix. Ils vantaient les réveillons qui les attendaient dans leurs familles. Le fils du bourgmestre avait vu, avant de partir, une oie monstrueuse, que des truffes tachetaient de points noirs comme un léopard. Chez le premier échevin, il y avait un petit sapin dans une caisse, aux branches duquel pendaient des oranges, des sucreries et des polichinelles. Et la cuisinière du tabellion avait attaché derrière son dos, avec une épingle, les deux brides de son bonnet, ce qu’elle ne faisait que dans ses jours d’inspiration, quand elle était sûre de réussir son fameux plat sucré.
Et puis, les écoliers parlaient aussi de ce que leur apporterait le petit Noël, de ce qu’il déposerait dans leurs souliers, que tous auraient soin, bien entendu, de laisser dans la cheminée avant d’aller se mettre au lit ; et dans les yeux de ces galopins, éveillés comme une poignée de souris, étincelait par avance la joie d’apercevoir, à leur réveil, le papier rose des sacs de pralines, les soldats de plomb rangés en bataillon dans leur boîte, les ménageries sentant le bois verni et les magnifiques pantins habillés de pourpre et de clinquant. Le petit Wolff, lui, savait bien, par expérience, que sa vieille avare de tante l’enverrait se coucher sans souper ; mais, naïvement, et certain d’avoir été, toute l’année, aussi sage et aussi laborieux que possible, il espérait que le petit Noël ne l’oublierait pas, et il comptait bien, tout à l’heure, placer sa paire de sabots dans les cendres du foyer.
La messe de minuit terminée, les fidèles s’en allèrent, impatients du réveillon, et la bande des écoliers, toujours deux par deux et suivant le pédagogue, sortit de l’église. Or, sous le porche, assis sur un banc de pierre surmonté d’une niche ogivale, un enfant était endormi, un enfant couvert d’une robe de laine blanche, et pieds nus, malgré la froidure. Ce n’était point un mendiant, car sa robe était propre et neuve, et, près de lui, sur le sol, on voyait, liés dans une serge, une équerre, une hache, une bisaiguë, et les autres outils de l’apprenti charpentier. Éclairé par la lueur des étoiles, son visage aux yeux clos avait une expression de douceur divine, et ses longs cheveux bouclés, d’un blond roux, semblaient allumer une auréole autour de son front. Mais ses pieds d’enfant, bleuis par le froid de cette nuit cruelle de décembre, faisaient mal à voir.
Les écoliers, si bien vêtus et chaussés pour l’hiver, passèrent indifférents devant l’enfant inconnu ; quelques-uns même, fils des plus gros notables de la ville, jetèrent sur ce vagabond un regard où se lisait tout le mépris des riches pour les pauvres, des gras pour les maigres. Mais le petit Wolff, sortant de l’église le dernier, s’arrêta tout ému devant le bel enfant qui dormait.
– « Hélas ! se dit l’orphelin, c’est affreux ! Ce pauvre petit va sans chaussures par un temps si rude... Mais, ce qui est encore pis, il n’a même pas, ce soir, un soulier ou un sabot à laisser devant lui, pendant son sommeil, afin que le petit Noël y dépose de quoi soulager sa misère ! » Et, emporté par son bon cœur, Wolff retira le sabot de son pied droit, le posa devant l’enfant endormi, et, comme il put, tantôt à cloche-pied, tantôt boitillant et mouillant son chausson dans la neige, il retourna chez sa tante.
– « Voyez le vaurien ! s’écria la vieille, pleine de fureur au retour du déchaussé. Qu’as-tu fait de ton sabot, petit misérable ? » Le petit Wolff ne savait pas mentir, et bien qu’il grelottât de terreur en voyant se hérisser les poils gris sur le nez de la mégère, il essaya, tout en balbutiant, de conter son aventure. Mais la vieille avare partit d’un effrayant éclat de rire.
– « Ah ! Monsieur se déchausse pour les mendiants ! Ah ! Monsieur dépareille sa paire de sabots pour un va-nu-pieds !... Voilà du nouveau, par exemple !... Eh bien, puisqu’il en est ainsi, je vais laisser dans la cheminée le sabot qui te reste, et le petit Noël y mettra cette nuit, je t’en réponds, de quoi te fouetter à ton réveil... Et tu passeras la journée de demain à l’eau et au pain sec... Et nous verrons bien si, la prochaine fois, tu donnes encore tes chaussures au premier vagabond venu ! » Et la méchante femme, après avoir donné au pauvre petit une paire de soufflets, le fit grimper dans la soupente où se trouvait son galetas. Désespéré, l’enfant se coucha dans l’obscurité et s’endormit bientôt sur son oreiller trempé de larmes.
Mais, le lendemain matin, quand la vieille, réveillée par le froid et secouée par son catarrhe, descendit dans sa salle basse, – ô merveille ! – elle vit la grande cheminée pleine de jouets étincelants, de sacs de bonbons magnifiques, de richesses de toutes sortes ; et, devant ce trésor, le sabot droit, que son neveu avait donné au petit vagabond, se trouvait à côté du sabot gauche, qu’elle avait mis là, cette nuit même, et où elle se disposait à planter une poignée de verges. Et, comme le petit Wolff, accouru aux cris de sa tante, s’extasiait ingénument devant les splendides présents de Noël, voilà que de grands rires éclatèrent au dehors. La femme et l’enfant sortirent pour savoir ce que cela signifiait, et virent toutes les commères réunies autour de la fontaine publique. Que se passait-il donc ? Oh ! Une chose bien plaisante et bien extraordinaire ! Les enfants de tous les richards de la ville, ceux que leurs parents voulaient surprendre par les plus beaux cadeaux, n’avaient trouvé que des verges dans leurs souliers.
Alors, l’orphelin et la vieille femme, songeant à toutes les richesses qui étaient dans leur cheminée, se sentirent pleins d’épouvante. Mais, tout à coup, on vit arriver M. le curé, la figure bouleversée. Au-dessus du banc placé près de la porte de l’église, à l’endroit même où, la veille, un enfant, vêtu d’une robe blanche et pieds nus, malgré le grand froid, avait posé sa tête ensommeillée, le prêtre venait de voir un cercle d’or, incrusté dans les vieilles pierres. Et tous se signèrent dévotement, comprenant que ce bel enfant endormi, qui avait auprès de lui des outils de charpentier, était Jésus de Nazareth en personne, redevenu pour une heure tel qu’il était quand il travaillait dans la maison de ses parents, et ils s’inclinèrent devant ce miracle que le bon Dieu avait voulu faire pour récompenser la confiance et la charité d’un enfant. »
24/12/2014 | Lien permanent
Tournons la page
Quand j’étais enfant et qu’il était question des années 2000, il s’agissait toujours de projections relevant de la science-fiction, c’est-à-dire de l’inimaginable.
Et puis ce matin, nous sommes en 2023 ! L’incroyable n’est plus qu’une vieille histoire, un souvenir ancien. De jeunes adultes autour de moi n’ont connu que ce siècle. Comment tout cela a-t-il pu advenir ? N’ai-je donc tant vécu que pour cet étonnement ? Me serais-je endormi durant le film ? Hibernatus, Hibernatus ! Pourtant, quand je rembobine le fil de mes souvenirs, tout s’enchaine logiquement, certes des détails m’échappent mais ce trou ne créé pas de malaise ; j’en ai vu des trucs incroyables alors mais tellement banals aujourd’hui : l’arrivée de la télévision dans nos foyers, le premier homme dans l’espace puis l’alunissage ce « grand pas pour l’humanité », le mur de Berlin qui s’effondre et bien plus tard les tours de New York. Le futur et hier se mêlent dans mon esprit, ce grand écart temporel rend désormais crédible à mes yeux ce qu’on nous prédit pour la fin de ce siècle.
Dans l’immédiat, mettons de côté le passé sans l’oublier, ignorons le futur temporairement, ne pensons qu’à aujourd’hui : nous sommes le 1er janvier 2023 et je vous souhaite à tous une très bonne année ! Une page se tourne, une autre s’ouvre, une vieille habitude bien connue pour nous autres lecteurs…
PS : pour des raisons médicales, mais bégnines, il est possible que je sois moins actif sur ce blog durant ce mois mais ce ne sera que passager et pour ne pas laisser le site abandonné, j'ai programmé plusieurs billets par avance...
01/01/2023 | Lien permanent | Commentaires (4)
Julian Barnes : Rien à craindre
 L’écrivain anglais Julian Barnes est né à Leicester en 1946. Après des études de langues et de littérature à l'Université d'Oxford, il travaille comme linguiste pour l'Oxford English Dictionary. Il entreprend une carrière de journaliste avant d’entamer une carrière d’écrivain. Il écrit aussi des romans policiers sous le pseudonyme de « Dan Kavanagh ». Julian Barnes est le seul écrivain étranger à avoir été primé à la fois par le Médicis (en 1986 pour Le perroquet de Flaubert) et le Femina (en 1992 pour Love, etc.).
L’écrivain anglais Julian Barnes est né à Leicester en 1946. Après des études de langues et de littérature à l'Université d'Oxford, il travaille comme linguiste pour l'Oxford English Dictionary. Il entreprend une carrière de journaliste avant d’entamer une carrière d’écrivain. Il écrit aussi des romans policiers sous le pseudonyme de « Dan Kavanagh ». Julian Barnes est le seul écrivain étranger à avoir été primé à la fois par le Médicis (en 1986 pour Le perroquet de Flaubert) et le Femina (en 1992 pour Love, etc.).
Rien à craindre est un hybride entre l’essai et les Mémoires, sous la forme d’un roman dont le sujet central est Dieu etla mort. Dès la première phrase du livre, le ton est donné « Je ne crois pas en Dieu, mais il me manque ».
La soixantaine passée, Julian Barnes commence à envisager la mort, du moins il lui accorde une réflexion plus profonde que lorsqu’il était plus jeune. Evoquer la mort, c’est aussi évoquer Dieu, « les gens ne croient à la religion que parce qu’ils ont peur de la mort ». Selon que l’on est croyant ou pas, l’au-delà n’aura pas le même goût, et même selon les religions il ne se présentera pas de la même façon. Bien différente encore sera l’idée de mort si on ne croit pas, athée ou agnostique verront la fin comme le point ultime dela vie. Maisa-t-on peur de la mort, ou peur de mourir ? Presque tout le monde craint l’une ou l’autre mais pas les deux « c’est comme s’il n’y avait pas assez de place dans l’esprit pour les deux ».
Quand on pense à la mort, le premier réflexe c’est de se rappeler de nos défunts, amis, proches et bien entendu parents. Julian Barnes se souvient de son père et de sa mère, leurs rapports, leurs travers, mais la mémoire est-elle fiable ? Quand il compare ses souvenirs avec ceux de son frère, un célèbre philosophe, les différences d’interprétation ou de mémorisation sont évidentes.
Pour l’aider dans sa tâche et cerner le « problème » de la mort, Julian Barnes fait appel aux écrivains qu’il connaît si bien. Montaigne, Jules Renard, Stendhal, Somerset Maugham, Flaubert bien sûr, Daudet évidemment, d’autres encore viennent nous donner leur version de ce qu’est la mort.
Arrivés à ce point vous devez penser que ce bouquin doit être particulièrement pénible à lire, pour ne pas dire mortel ! Pour être franc, moi-même j’ai eu du mal à entrer dans l’ouvrage, je le trouvais bavard et obligatoirement vain, puisque quoi qu’on dise ou pense de la mort, chacun à sa vérité et personne ne peut vous démentir, pour la bonne raison que nul n’en est revenu pour clore définitivement ce débat qui existe depuis une éternité. Mais Julian Barnes sait y faire, le livre est bien construit, le propos intelligent et étayé des écrits d’illustres écrivains et l’Anglais comme nombre de ses compatriotes, manie l’humour avec subtilité. J’ai d’ailleurs trouvé une certaine ressemblance entre certains passages de ce livre avec celui de son compatriote David Lodge, La Vie en sourdine , et coïncidence, ces deux bouquins sont parus la même année en 2008.
En conclusion, un livre que j’ai eu du mal à entamer mais qui au fil des pages a su fixer mon intérêt grâce à un sujet grave traité avec légèreté et intelligence.
« Mon grand-père avait coutume de se mettre de la brillantine dans les cheveux, et la têtière de son fauteuil Parker Knoll - à haut dossier et joues pleines contre lesquelles il pouvait somnoler - n'était pas seulement décorative. Ses cheveux avaient blanchi plus tôt que ceux de grand-mère; il avait une moustache militaire coupée court, une pipe à tuyau métallique et une blague à tabac qui distendait la poche de son cardigan. Il portait aussi un gros appareil acoustique: un autre aspect du monde adulte - ou plutôt, d'une phase lointaine de la vie adulte - dont mon frère et moi aimions nous moquer. «Pardon?» me criait-il ou lui criais-je satiriquement en mettant une main en coupe à l'oreille. Nous guettions le moment très prisé où l'estomac de grand-maman gronderait assez fort pour que grand-papa perçoive le bruit malgré sa surdité et demande: «Téléphone, Ma?» Après un grognement embarrassé de celle-ci, ils retournaient à la lecture de leurs journaux. Grand-père, dans son fauteuil masculin, son Sonotone sifflant parfois et sa pipe faisant un petit bruit de liquide aspiré quand il tirait dessus, hochait la tête en lisant le Daily Express, qui décrivait un monde où la vérité et la justice étaient constamment mises en péril par la Menace communiste. Dans son fauteuil plus moelleux et féminin - dans le coin rouge -, grand-mère émettait des tss-tss de désapprobation en lisant son Daily Worker, qui décrivait un monde où la vérité et la justice, dans leurs versions actualisées, étaient constamment mises en péril par le Capitalisme et l'Impérialisme. »
 Julian Barnes Rien à craindre Folio
Julian Barnes Rien à craindre Folio
09/10/2012 | Lien permanent


