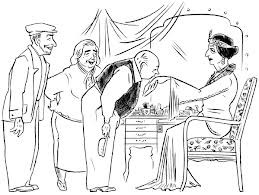Rechercher : les grands cerfs
William T. Vollmann : Le Grand Partout
 William T. Vollmann, né en 1959 à Los Angeles en Californie, est un écrivain, journaliste et essayiste américain, connu pour ses romans fleuves s'appuyant sur de vastes enquêtes. Son œuvre, qui mêle fictions et essais, est marquée par son goût pour l'histoire et son obsession pour le thème de la prostitution. Il vit actuellement à Sacramento.
William T. Vollmann, né en 1959 à Los Angeles en Californie, est un écrivain, journaliste et essayiste américain, connu pour ses romans fleuves s'appuyant sur de vastes enquêtes. Son œuvre, qui mêle fictions et essais, est marquée par son goût pour l'histoire et son obsession pour le thème de la prostitution. Il vit actuellement à Sacramento.
Le Grand Partout (2011) qui vient d’être réédité en poche, est un récit à portée sociologique sur le monde des hobos, ces vagabonds du rail dont nous ont régalés des écrivains comme Jack Kerouac ou Jack London, par exemple, mais ici, ce n’est pas romancé.
William T. Vollmann et son ami Steve Jones, ont sillonné les Etats-Unis dans tous les sens, dans des trains de marchandises, non par nécessité ou par économie, mais pour le plaisir, uniquement pour le plaisir et y retrouver le goût de la liberté. Qu’un train parte vers le sud ou vers le nord, qu’importe, du moment qu’un train partait quelque part, ce quelque part ou Grand Partout, le Shangri-la des hobos. Car l’écrivain est triste, il ne reconnait plus son pays, « je contemple cette Amérique toujours moins américaine qui est la mienne, et j’enrage. » Le conformisme, les mesures de sécurité renforcées dans tous les domaines, tout cela l’exaspère et pour combattre ce système, il ne lui resterait que « la resquille », ces trains de marchandise dans lesquels on monte en douce, pour aller ailleurs.
Certes, dans ces wagons on crève de chaud ou on grelotte, on doit se planquer pour ne pas être débusquer par les « bourrins », les agents du train, qui n’hésitent pas à vous tabasser ou vous obligent à sauter dans le vide quand le convoi roule… Mais ce sont aussi des rencontres avec d’improbables collègues, moins fortunés et qui en ont sacrément bavé durant toute leur vie. Vollmann les interroge avec une grande empathie, comprend leurs motivations, apprend de leurs expériences et leurs récits sont parfois très durs car dans le passé, les bourrins pouvaient être particulièrement ignobles. Des hommes toujours, car les rares femmes qui se mêlent à ces voyageurs, souffrent plus encore (« C’est le drame de Vénus : tout le monde veut d’elle, et notre déesse est donc devenue une proie »).
Le récit est émaillé d’extraits de textes, s’avérant des conseillers éclairés, de Kerouac, London, Hemingway, Thoreau etc. Une approche de ce monde fermé, assez intellectuelle et politique, exaltant les vertus de la liberté, une notion qui se perdrait pour l’auteur (« la non-liberté qui envahit l’Amérique »). Hobo vs Bourrin, Liberté vs Contraintes, à ces problématiques Vollmann s’interroge, où cours-je ? Dans quel Etat j’erre ? Peut-être n’existe-t-il pas « de Dernier Beau Coin du Pays ? », que seul le « je me tire » soit la réponse… ?
Un très bon livre, fort bien écrit avec des passages d’un grand lyrisme, encore meilleur quand je vous dirai qu’il contient aussi un gros cahier de photos faites par l’écrivain, pour voir les « gueules » d’Ira, Badger et autres figures singulières de ces voyages extraordinaires.
« Ma critique de la société américaine reste fondamentalement incohérente. Aurais-je vraiment préféré vivre à l’époque de mon grand-père, quand les Pinkertons cognaient sur la tête des Wobblies ? Ou à l’époque de mon père, quand Joe McCarthy pouvait briser n’importe qui en l’accusant d’être un rouge ? Tout ce que je sais, c’est que même si je suis plus libre que beaucoup de gens, je veux l’être davantage. Quelquefois je m’étonne franchement de cette aspiration à une existence meilleure. Qu’est-ce qu’il me faut ? »
 William T. Vollmann Le Grand Partout Babel – 235 pages –
William T. Vollmann Le Grand Partout Babel – 235 pages –
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Clément Baude
01/03/2021 | Lien permanent | Commentaires (7)
Yirmi Pinkus : Le Grand Cabaret du professeur Fabrikant
 Né à Tel Aviv en 1966, Yirmi Pinkus est un auteur de comics, caricaturiste et illustrateur réputé. Le Grand Cabaret du professeur Fabrikant, son premier roman, vient tout juste de paraître.
Né à Tel Aviv en 1966, Yirmi Pinkus est un auteur de comics, caricaturiste et illustrateur réputé. Le Grand Cabaret du professeur Fabrikant, son premier roman, vient tout juste de paraître.
Quand le professeur Markus Fabrikant, tout juste sorti diplômé (encore que rien ne soit prouvé) de l’université de Bucarest en 1878, décide de fonder un théâtre, il le fait dans un but très précis, « Je veux fonder une institution qui aura une grande valeur pédagogique et dont le but sera de porter les lumières de la civilisation à travers tout l’Empire. Il s’agit de présenter à un public juif les extraordinaires richesses de la connaissance et de la culture universelles. » Pas moins ! Ses comédiennes, il les a recrutées enfants, orphelines ou abandonnées et cette troupe à l’enseigne du Grand Cabaret, il va la mener de bourgades en patelins perdus, entre Roumanie et Pologne jusqu’à son décès en 1937. L’aventure ne s’arrêtera pas là puisque son neveu Herman héritera de la direction artistique du théâtre ambulant.
Yirmi Pinkus nous entraîne dans les cinquante années d’errance de cette troupe, devenue de fait une petite famille avec ses joies et ses peines mais aussi ses mesquineries et sa cupidité. Des sentiments très humains finalement, pour ce microcosme qui avance innocemment « Je n’ai pas peur de Hitler, malgré ce qu’il raconte sur les Juifs », trop accaparé par sa propre subsistance, vers ce que nous savons de l’Histoire à venir. L’itinérance s’achevant par un incendie, métaphore facile annonçant le monstrueux brasier qui embrasera l’Europe tout entière, à commencer par le peuple Juif.
Le roman est riche en personnages, on suit l’évolution des actrices débutant gamines et toujours sur les planches cinquante ans après ; le théâtre doit affronter mille problèmes ou situations en tous genres mais je le confesse, globalement j’ai trouvé tout cela bien long (450 pages) et j’ai eu beaucoup de mal à m’intéresser à ces péripéties. Pourtant c’est bien écrit, le ton est léger même si l’issue est dramatique, on devrait se passionner pour cette histoire chahutée, le début et la fin du roman sont très bien, alors ? Le seul argument qui me vienne à l’esprit, c’est fade ! Ca manque de souffle. Comme un plat appétissant dans votre assiette, dont vous vous régalez par avance, mais qui hélas vous le constatez, n’a pas été salé correctement durant la cuisson. Un roman loin d’être mauvais, mais ça reste une question de goût…
« La situation empire… Il est temps de se rendre à l’évidence. (…) Ni la situation politique, ni la situation de la troupe ne jouent en notre faveur, il est plus que temps de l’accepter ! Les mesures discriminatoires se font chaque jour plus nombreuses, et si les nazis envahissent la Pologne – éventualité qu’il faut prendre en compte – vous pouvez être sûr qu’ils feront disparaître le théâtre yiddish. Où vendrez-vous vos billets ? En Roumanie ? Vous voyez bien ce qui arrive en Bessarabie, ça va se propager chez nous, j’en suis sûr. Passer la frontière et entrer en Russie est presque impossible, mais à supposer que vous y arriviez – qui traînerez-vous là-bas ? Six actrices de plus de soixante-dix ans, dont une diabétique et une folle. »
 Yirmi Pinkus Le Grand Cabaret du professeur Fabrikant Grasset
Yirmi Pinkus Le Grand Cabaret du professeur Fabrikant Grasset
Traduit de l’hébreu par Laurence Sendrowicz
Le texte est agrémenté de quelques délicieuses vignettes dessinées par Yirmi Pinkus dont celle-ci :
02/12/2013 | Lien permanent
Cormac McCarthy : Le Grand Passage
 Attention littérature avec un L majuscule. Dès les premières pages du livre on sent qu’on entre en littérature et non dans un simple roman. Indépendamment du thème ou de l’intrigue, la puissance de l’écriture, le souffle puissant derrière des mots simples ne trompent pas. Il ne s’agit pas d’une vulgaire piquette, mais d’un crû charpenté et gouleyant, dont les arômes puissants restent longtemps en bouche, un régal, un chef-d’œuvre. J’ai découvert Cormac McCarthy récemment (voir ma chronique de son dernier roman La Route) et je suis bien décidé à rattraper le temps perdu car lire un grand écrivain accroît le plaisir de la lecture en élargissant le champ de la conscience. Paru en 1994 Le Grand Passage se déroule dans les années 1920 entre l’Arizona et le Mexique. Un adolescent de seize ans, Billy, après avoir pris au piège une louve, décide de la relâcher dans son territoire natal, le Mexique, tel est souvent dans les chroniques, le résumé de ce roman. Nous sommes loin de la réalité et de l’ampleur du livre dans lequel l’anecdote de la louve ne représente que le tiers à peine du roman. Il y aura aussi, le retour au ranch familial où le drame prendra son envol avec les parents décédés et les chevaux volés, le frère cadet Boyd seul rescapé et leur quête à la recherche des voleurs Mexicains. Passage de l’adolescence à l’état d’adulte, la violence et la souffrance, émois et amour suggérés, la solitude et la faim, les traditions de partage entre les errants, ce fabuleux livre condense tous les thèmes essentiels de la vie et donc de la mort. A lire absolument.
Attention littérature avec un L majuscule. Dès les premières pages du livre on sent qu’on entre en littérature et non dans un simple roman. Indépendamment du thème ou de l’intrigue, la puissance de l’écriture, le souffle puissant derrière des mots simples ne trompent pas. Il ne s’agit pas d’une vulgaire piquette, mais d’un crû charpenté et gouleyant, dont les arômes puissants restent longtemps en bouche, un régal, un chef-d’œuvre. J’ai découvert Cormac McCarthy récemment (voir ma chronique de son dernier roman La Route) et je suis bien décidé à rattraper le temps perdu car lire un grand écrivain accroît le plaisir de la lecture en élargissant le champ de la conscience. Paru en 1994 Le Grand Passage se déroule dans les années 1920 entre l’Arizona et le Mexique. Un adolescent de seize ans, Billy, après avoir pris au piège une louve, décide de la relâcher dans son territoire natal, le Mexique, tel est souvent dans les chroniques, le résumé de ce roman. Nous sommes loin de la réalité et de l’ampleur du livre dans lequel l’anecdote de la louve ne représente que le tiers à peine du roman. Il y aura aussi, le retour au ranch familial où le drame prendra son envol avec les parents décédés et les chevaux volés, le frère cadet Boyd seul rescapé et leur quête à la recherche des voleurs Mexicains. Passage de l’adolescence à l’état d’adulte, la violence et la souffrance, émois et amour suggérés, la solitude et la faim, les traditions de partage entre les errants, ce fabuleux livre condense tous les thèmes essentiels de la vie et donc de la mort. A lire absolument.
« Il dit qu’à son avis il était imprudent de croire que les morts n’ont pas le pouvoir d’agir en ce monde, car leur pouvoir est grand et c’est sur ceux qui s’en doutent le moins qu’ils ont le plus d’influence. Il dit : ce que les hommes ne comprennent pas c’est que ce que les morts ont quitté n’est pas le monde lui-même mais seulement l’image du monde dans le cœur des hommes. Il dit qu’on ne peut pas quitter le monde car le monde sous toutes ses formes est éternel de même que toutes les choses qui y sont contenues. »
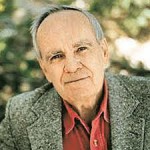 Cormac McCarthy Le Grand Passage Points
Cormac McCarthy Le Grand Passage Points
15/10/2012 | Lien permanent
Ian McGuire : Dans les eaux du Grand Nord
 Ian McGuire, né en 1964, a grandi près de Hull en Angleterre, et étudié dans les universités de Manchester et de Virginie. Il a cofondé le Centre pour la Nouvelle Ecriture à l’université de Manchester et enseigne actuellement l’écriture créative à l’université de Nord Texas. Second roman mais premier traduit chez nous, Dans les eaux du Grand Nord, vient tout juste de paraitre.
Ian McGuire, né en 1964, a grandi près de Hull en Angleterre, et étudié dans les universités de Manchester et de Virginie. Il a cofondé le Centre pour la Nouvelle Ecriture à l’université de Manchester et enseigne actuellement l’écriture créative à l’université de Nord Texas. Second roman mais premier traduit chez nous, Dans les eaux du Grand Nord, vient tout juste de paraitre.
1860 en Angleterre. Sumner, ex-médecin militaire revenu des Indes, embarque à bord du Volunteer, un baleinier en partance pour le Grand Nord. A bord, Brownlee le capitaine, Baxter son second, Cavendish le premier lieutenant et Henry Drax l’un des harponneurs, sont les principaux personnages du roman. Quand Sumner constate qu’un des mousses du navire a été sauvagement agressé sexuellement mais refuse de livrer le nom du coupable, le médecin avec l’aide du capitaine vont mener leur enquête. Enquête qui tourne vite à la recherche d’un meurtrier quand le cadavre du mousse est retrouvé dans les cales…
Ce n’est là que le tout début du récit car il apparait vite que nous sommes en présence d’un roman d’aventures, un peu à l’ancienne et mêlant différents genres de fictions attrayantes : le polar, les romans de voyageurs/explorateurs et même pourquoi pas, l’aspect western dans le finale.
Le bouquin se lit d’une traite, le lecteur est emporté par le rythme enlevé et les mésaventures subies et endurées par Sumner le héros de cette histoire. Je ne vais pas vous en révéler les rebondissements mais disons que tout l’équipage du navire va devoir l’abandonner et tenter de survivre sur la banquise du Groenland, qu’il y aura beaucoup de morts, que le justicier et sa proie (ou l’inverse selon les épisodes) vont se jouer de la mort jusqu’au chapitre final et là…
Ian McGuire s’est bien documenté sur l’époque, la marine d’alors et la chasse à la baleine et aux phoques, rien de nouveau pour les familiers de ces récits : scènes sanglantes et gourdins gluants. Le texte est ponctué de quelques scènes mémorables mais déjà lues ailleurs : opération chirurgicale avec un simple couteau ou bien, vie sauvée en se planquant à l’intérieur du cadavre éventré d’un ours. A noter néanmoins une très belle séquence avec Punnie l’Esquimaude. Les deux acteurs vedettes de ce drame marin sont croqués psychologiquement plutôt sommairement, Sumner est hanté par son passé dans les colonies, Drax ne vit que dans l’instant présent et reste sourd aux remords.
Pour conclure, disons que je suis assez partagé : oui, j’ai lu un bouquin bien enlevé et gentiment prenant mais il lui manque la puissance des grands récits qui font réfléchir le lecteur sur la nature humaine. Je n’ai donc pas vu dans ces eaux l’avenir de la littérature mais tout est encore jouable…
« Il observe une des femmes qui fait chauffer sur la lampe une casserole en métal pleine de sang de phoque. Quand le sang fume, elle la retire de la flamme et la fait circuler. Chacun boit, puis fait passer. Ce n’est ni un rite ni un rituel, comprend Sumner, c’est simplement leur façon de s’alimenter. Quand la casserole lui parvient, il la refuse ; comme ils insistent, il la prend, renifle, puis la tend à son voisin de droite. Ils lui proposent un morceau de foie cru, qu’il refuse également. Il se rend compte qu’il les offense, il remarque les lueurs de tristesse et de confusion dans leurs yeux, et se demande s’il serait plus simple, préférable, de leur faire plaisir. Quand la casserole revient à lui, il accepte et boit. »
 Ian McGuire Dans les eaux du Grand Nord 10-18 - 304 pages –
Ian McGuire Dans les eaux du Grand Nord 10-18 - 304 pages –
Traduit de l’anglais par Laurent Bury
20/06/2017 | Lien permanent
Alexandra David-Néel : Le Grand Art
 Louise Eugénie Alexandrine Marie David, plus connue sous le nom d’Alexandra David-Néel née en 1868 à Saint-Mandé, morte en 1969 à Digne-les-Bains, est une orientaliste, chanteuse d'opéra et féministe, journaliste et anarchiste, écrivaine et exploratrice, franc-maçonne et bouddhiste de nationalités française et belge. Elle fut, en 1924, la première femme d'origine européenne à séjourner à Lhassa au Tibet, exploit qui contribua fortement à sa renommée, en plus de ses qualités personnelles et de son érudition.
Louise Eugénie Alexandrine Marie David, plus connue sous le nom d’Alexandra David-Néel née en 1868 à Saint-Mandé, morte en 1969 à Digne-les-Bains, est une orientaliste, chanteuse d'opéra et féministe, journaliste et anarchiste, écrivaine et exploratrice, franc-maçonne et bouddhiste de nationalités française et belge. Elle fut, en 1924, la première femme d'origine européenne à séjourner à Lhassa au Tibet, exploit qui contribua fortement à sa renommée, en plus de ses qualités personnelles et de son érudition.
Je connaissais Alexandra David-Néel depuis longtemps par ses récits de voyages et expériences bouddhiques, puis récemment grâce à sa biographie écrite par Laure-Dominique Agniel j’ai appris qu’elle avait débuté dans la vie comme chanteuse d’opéra. Et voici que paraît aujourd’hui, Le Grand Art, un roman jusqu’ici inédit de notre voyageuse écrit en 1902, inspiré de ses connaissances pratiques du monde du spectacle.
Cécile, la narratrice, chanteuse d’opéra se retrouve dans un grand embarras quand le directeur de la troupe d’artistes laisse tout le monde en plan, parti avec la caisse. Recueillie par un marchand de bestiaux dans la région de Besançon, elle va en voir de toutes les couleurs dans un monde d’hommes plus intéressé par son plumage que par son ramage, avant finalement d’obtenir la consécration et l’argent…
Le livre mélange deux genres, le roman et le journal où Cécile note ses souvenirs. Nous allons donc la suivre dans ses tribulations que nous résumerons ainsi : comment pratiquer son art lyrique, grâce à son talent et son travail, sans devoir en passer par la couche de ses employeurs ? Disons-le tout de suite, ce n’est pas possible. Alors pour survivre dans cette jungle, il faudra à Cécile un peu de chance et beaucoup d’intelligence, accepter certains compromis pour obtenir des gains plus grands.
Excellent roman, fort bien écrit d’une plume très moderne (parfois bien coquine aussi) et mené à un bon rythme, outre son intrigue il offre des informations de première main sur le monde du théâtre de cette époque : les artiste courant le cacheton, les humiliations des auditions, le pouvoir exorbitant des directeurs de théâtre ou de ceux sensés vous aider à obtenir des rôles. Il y aura les tournées en France ou à l’étranger, Cécile en passera par le désespoir, acceptant l’inacceptable, croira connaitre enfin l’amour avant les déceptions. Mais in fine, par la ruse, un savant jeu de chat et de souris avec un riche banquier pas dupe, elle obtiendra la sécurité financière et la célébrité à l’Opéra de Paris.
Si le livre date de plus d’un siècle, il conserve une modernité inattendue par le féminisme combatif (#BalanceTon Porc n’est pas loin) de son auteur et son amour de la liberté. Je savais qu’Alexandra David-Néel avait plus d’une corde à son talent, nous lui ajouterons maintenant celui de romancière.
« L’actrice ne peut se contenter, sous peine de perdre de sa valeur cotée, de se faire entretenir matériellement. Il lui faut soigner sa réclame. Pour cela, elle doit s’attirer les bonnes grâces d’une foule de gens : directeurs, régisseurs, auteurs, journalistes – une multitude se renouvelant sans cesse, avec laquelle on n’a jamais fini. Ah dame ! il faut être douée de patience et d’une constitution permettant d’affronter la fatigue !... J’imagine que les moins bêtes de ces individus comprennent que c’est leur pouvoir qui les fait rechercher : mais la fatuité idiote de la plupart d’entre eux doit certainement leur faire croire à un succès mâle désiré pour lui-même. »
 Alexandra David-Néel Le Grand Art Le Tripode – 380 pages – Avec cahier photos –
Alexandra David-Néel Le Grand Art Le Tripode – 380 pages – Avec cahier photos –
05/11/2018 | Lien permanent
Le grand dilemme des livres à conserver ou à donner
Dans un billet précédent j’ai longuement pleuré sur l’obligation par manque de place de faire du nettoyage dans ma bibliothèque. Un millier d’ouvrages devaient déguerpir pour laisser les autres, tout aussi nombreux, respirer un peu.
Il fallait donc faire des choix douloureux, celui-ci je le garde, celui-là je m’en sépare. Avant de me lancer dans ce tri, tout me semblait simple, tous les grands classiques de la littérature mondiale garderaient leur place au chaud chez moi : Alexandre Dumas, Jules Verne, Balzac, pour ne citer que quelques-uns des nôtres pas avare de production, on leur ajoutera les Russes, Dostoïevski, Gogol, Tourgueniev par exemple, des Américains aussi comme tous mes Philip Roth, Jim Harrison… et des Japonais comme Mishima, Tanizaki et autres du même calibre. Bien sûr il y a d’autres nations et pleins d’autres écrivains, donc une palanquée de bouquins à conserver, indubitablement.
Jusque là tout était sous contrôle. C’est après que ça a commencé à déraper, sans aucune logique objective et sans qu’aujourd’hui que les dés ont été jetés, j’en comprenne mes choix. Je n’ai pas de regrets, mais je n’ai rien compris à ce qui s’est passé.
Je ne vais retenir qu’un seul exemple, le plus caractéristique peut-être. J’ai donné tous mes polars de Ed McBain mais j’ai conservé farouchement ( !) mes trois Roger L. Simon (Le Canard laqué, Le Grand soir, Cul-sec) dans leur édition originale et colorée des années 70 chez Alta éditions.
Et là, j’ai compris. En théorie – le pays où la vie est facile – je devais conserver les bons romans des bons écrivains, et inversement me débarrasser des mauvais livres ou des bouquins quelconques. J’avais oublié un critère, le facteur X : un livre, ce n’est pas que le plaisir qu’on en retire à sa lecture, ce sont aussi tous les évènements extérieurs, à priori sans rapport, qui nous ont fait aimer ces livres. Entrent alors en jeu, les souvenirs qui s’y rattachent. Pourquoi avais-je acheté ce livre ? Qui me l’avait conseillé ? A quel intérêt d’alors me liait-il ? Des évènements intimes dont on ne mesure pas l’importance au moment où on lit ces ouvrages mais quand cinquante ans plus tard on les ravive, je vous garantis que la qualité intrinsèque du bouquin a beaucoup moins de poids dans votre choix de conservation ou de séparation !
J’ai désormais l’esprit tranquille, je sais que ceux qui sont partis devaient partir et que ceux qui sont restés le sont pour de bonnes raisons : soit grâce à leur qualité littéraire, soit par la trace intime toute personnelle qui me relie à eux. Le groupe s’est rétréci, ne reste que la famille, l’essentiel.
30/10/2021 | Lien permanent | Commentaires (10)
Jean-Philippe Blondel : La Grande escapade
 Jean-Philippe Blondel, né à Troyes en 1964, est un écrivain français. Tout en enseignant l'anglais dans un lycée près de Troyes depuis les années 1990, il mène en parallèle une carrière d'écrivain, en littérature générale comme en jeunesse. Son œuvre est conséquente et La Grande escapade, roman de 2019 vient d’être réédité en poche.
Jean-Philippe Blondel, né à Troyes en 1964, est un écrivain français. Tout en enseignant l'anglais dans un lycée près de Troyes depuis les années 1990, il mène en parallèle une carrière d'écrivain, en littérature générale comme en jeunesse. Son œuvre est conséquente et La Grande escapade, roman de 2019 vient d’être réédité en poche.
Une petite ville de province au milieu des années 1970. Plusieurs familles d’instituteurs, de la maternelle au CM2, habitent des logements de fonction dans l’école Denis-Diderot. Les gamins, les parents, hommes et femmes, un microcosme représentatif d’une époque en plein chamboulement…
Encore un excellent roman de Jean-Philippe Blondel, écrivain que je connais peu mais qui m’enchante à chaque fois que j’ouvre un de ses ouvrages. La grande qualité de cet auteur – à mes yeux – c’est de nous parler de choses sérieuses sur un ton très amusant. Ici, il est principalement question de la place de la femme dans la société à cette époque charnière de notre histoire.
La situation de départ, un vivarium (l’école) où des personnages des deux sexes et leur progéniture vont réagir à l’air du temps sous l’œil acéré de l’écrivain. Les enseignants sont socialistes comme il se doit, prônant des idées libérales à l’extérieur mais beaucoup moins chez eux ; leurs épouses sont les femmes typiques d’alors, soumises à leur père et maintenant à leur mari, elles s’occupent des tâches ménagères et des gamins. Mais le vent du changement s’est infiltré entre les murs de l’établissement scolaire et ces épouses modèles qui gardaient cachés leurs espoirs et envies vont commencer à s’émanciper.
La culture pop envahit les vies, les anglicismes agacent, la musique moderne que fredonnent les gamins ou la radio exaspère certains, les carcans se desserrent, la mixité fait son entrée dans les classes des écoles. Les gamins font des bêtises de gamins, des épouses se mettent à regarder les collègues de leur maris avec des idées leur mettant le rose aux joues, d’autres s’en indignent. L’une d’elles, rêvant secrètement depuis toujours d’être styliste se voit proposer un poste qui chamboulera sa vie familiale si elle l’accepte.
Et les hommes ? Ils assistent impuissants à cette évolution généralisée. Maladroits, coincés dans leur formatage hérité des générations précédentes, pas complètement réfractaires aux nouvelles idées mais incapables de les accepter immédiatement, ils paraissent un peu minables face à ces femmes en passe de s’émanciper, dans ce monde en pleine mutation. Et parmi les gosses, le petit Philippe Goubert pourrait fort bien être un avatar de Jean-Philippe Blondel puisqu’il déclare « Philippe Goubert ne perd pas une miette des récits. Il devine qu’un jour, il faudra les retranscrire. »
Le fond est donc sérieux, la forme elle, est très amusante, même parfois carrément loufoque (la longue scène épique où la femme de service espagnole hurle à poil à travers les couloirs !), ou bien encore tendre et émouvante lors de l’escapade foirée à Paris entre deux amants potentiels. Un très bon roman.
« Ces trois femmes, qui glissent maintenant le long du mur de briques pour rejoindre l’entrée de l’école maternelle au premier étage de laquelle se situe le logement de fonction des Goubert, n’hésitent pas à se déclarer féministes alors même qu’elles passent le plus clair de leur temps à obéir aux diktats imposés par leurs conjoints. Ceux-ci se prononcent en faveur du travail féminin (on n’est pas au Moyen Âge et puis on ne crache pas sur un salaire supplémentaire) mais froncent le sourcil devant les velléités d’indépendance de leurs épouses. Lorsque Marie-Dominique Ferrant a émis l’idée de partir quelques jours à Lille retrouver sa meilleure amie d’enfance, son mari a poussé les hauts cris, avant d céder finalement devant la menace d’une grève totale et générale de la cuisine. »
 Jean-Philippe Blondel La Grande escapade Folio – 236 pages
Jean-Philippe Blondel La Grande escapade Folio – 236 pages
22/03/2021 | Lien permanent | Commentaires (2)
Valentin Musso : L’Homme du Grand Hôtel
 Valentin Musso, né en 1977 à Antibes, est un écrivain français, auteur de romans policiers. Sa mère était directrice de la bibliothèque municipale d'Antibes, ce qui a renforcé son goût pour la lecture et son frère Guillaume est aussi écrivain. Agrégé de lettres, il enseigne la littérature et le latin dans les Alpes-Maritimes. Il est actuellement professeur au Centre International de Valbonne.
Valentin Musso, né en 1977 à Antibes, est un écrivain français, auteur de romans policiers. Sa mère était directrice de la bibliothèque municipale d'Antibes, ce qui a renforcé son goût pour la lecture et son frère Guillaume est aussi écrivain. Agrégé de lettres, il enseigne la littérature et le latin dans les Alpes-Maritimes. Il est actuellement professeur au Centre International de Valbonne.
Dixième roman de l’écrivain, L’Homme du Grand Hôtel vient de paraître et je vais vous expliquer pourquoi vous devez le fuir dare-dare !
Cape Cod sur la côte Est des Etats-Unis. Randall Hamilton, célèbre écrivain de romans à succès, se réveille dans la chambre d’un palace donnant sur l’océan. Tout semblerait merveilleux s’il comprenait ce qu’il fait ici, comment il y est venu et plus encore, s’il savait qui il est exactement ! De son côté, à Boston, le jeune Andy Marzano tente vainement d’être écrivain et de se faire publier, jusqu’à ce qu’il utilise des éléments de la vie personnelle de sa petite amie pour écrire un roman. Mauvaise idée !
Je n’ai jamais lu Guillaume, une prévention instinctive sans motivation concrète, alors pourquoi aller me fourvoyer avec son frangin ? Je ne sais pas, mais c’est tout moi.
L’écriture est d’une banalité inquiétante et bien que ce soit son dixième roman, on croit lire le premier livre d’un écrivain sans avenir, le genre de truc où le héros s’endort sur cette phrase « En quelques instants, les ténèbres le recouvrirent. » L’intrigue est proche du degré zéro et le dénouement cloue le lecteur au mur des lamentations rageuses devant tant de nullité.
Non seulement le roman est mauvais mais bouffi de vanités : l’auteur cite, comme des emplâtres collés à la va-vite dans son texte, de nombreux écrivains célèbres pour faire cultivé et se gargarise et nous saoule définitivement par une postface où il croit bon nous expliquer comment lui est venue l’idée de son roman de gare. J’en ai trop bavé, alors j’arrose tout le monde, il faut croire que l’éditeur ne sait pas quoi faire de son argent quand on voit le budget marketing dépensé dans la presse pour vendre ce bouquin, à moins que ce soit ce qu’il a de mieux en rayon actuellement ? Quelle misère.
Seigneur, qu’avons-nous faits pauvres lecteurs pour subir ça ?
« Randall s’approcha du grand miroir éclairé par des néons. Face à lui, un homme qui devait avoir une soixantaine d’années : le cheveu coupé court, une légère barbe grisonnante, des yeux bleus éteints, le bas du visage un peu trop affaissé. Bien sûr, il le reconnaissait. C’était lui, ou plutôt une version négligée, plus avachie que celle qu’il avait en tête. Comme si en une nuit il avait pris dix ans. IL passa une main angoissée sur sa figure. « Quand est-ce que je vais me réveiller pour de bon ? Quand est-ce que ce cauchemar va prendre fin ? »
 Valentin Musso L’Homme du Grand Hôtel Seuil - 365 pages -
Valentin Musso L’Homme du Grand Hôtel Seuil - 365 pages -
13/06/2022 | Lien permanent | Commentaires (6)
Ken Kesey : Et quelquefois j’ai comme une grande idée
 Ken Kesey (1935-2001), né Kenneth Elton Kesey, est un écrivain américain. Il a écrit Vol au-dessus d'un nid de coucou (1962) même si le film de Milos Forman en 1975 avec Jack Nicholson a certainement eu plus de retentissement. À côté de son activité d'écrivain, Ken Kesey, avec son groupe communautaire les Merry Pranksters, est aussi l'un des inspirateurs les plus importants du mouvement psychédélique des années 1960. Son second roman, Et quelquefois j’ai comme une grande idée, paru en 1963 vient seulement d’être traduit en français.
Ken Kesey (1935-2001), né Kenneth Elton Kesey, est un écrivain américain. Il a écrit Vol au-dessus d'un nid de coucou (1962) même si le film de Milos Forman en 1975 avec Jack Nicholson a certainement eu plus de retentissement. À côté de son activité d'écrivain, Ken Kesey, avec son groupe communautaire les Merry Pranksters, est aussi l'un des inspirateurs les plus importants du mouvement psychédélique des années 1960. Son second roman, Et quelquefois j’ai comme une grande idée, paru en 1963 vient seulement d’être traduit en français.
L’histoire se déroule dans une petite ville fictive de l’Oregon, bâtie le long d’une rivière et suit l’évolution d’une famille de bûcherons, les Stamper. Après une baisse du besoin de main-d’œuvre dans la région causée par l’arrivée des tronçonneuses, les travailleurs syndiqués de la ville entament une grève pour réclamer le maintien de leur salaire malgré moins d’heures de travail. De leur côté les Stamper qui possèdent et gèrent une entreprise non syndiquée, décident de secrètement continuer le travail et de fournir à la scierie tout le bois qu’elle aurait normalement dû recevoir de la ville si la grève n’avait pas été entamée.
Les principaux acteurs du drame qui va se jouer ici sont Henry Stamper, le patriarche à grande gueule, Hank le fils et Viv sa femme ainsi que Lee, demi-frère cadet revenu de New York où il faisait ses études, officiellement à la demande de Hank qui a besoin d’une aide temporaire pour gérer l’entreprise mais qui compte sur cette occasion pour se venger de lui car « il était à bien des égards l’archétype du genre d’homme que je considérais comme le plus dangereux pour mon monde à moi, et cela justifiait déjà amplement que je cherche à le détruire. »
Que les choses soient tout de suite claires pour un éventuel futur lecteur, c’est un très bon roman mais s’y attaquer, ou se le colleter plutôt, sera un exercice aussi physique qu’intellectuel. Le bouquin fait huit cent pages et pèse un âne mort ! Peu de chapitres et quasiment pas de paragraphes, le texte est d’une densité asphyxiante qu’on ne rencontre que rarement. Les digressions sont nombreuses, on passe d’un personnage à un autre sans crier gare, l’un peu se nommer Joe, Joe Ben ou encore Joby selon les passages mais ce sera le même, des bribes de pensées des acteurs sont incluses dans le texte en italiques, un bout de dialogue de l’un répond à une situation décalée passée, mais tout se tient ! Il y a des scènes rêvées ou remémorées et l’écriture de Kesey ne lambine pas en chemin, ça pulse, ça speed, d’ailleurs parfois on croit y deviner des traces d’amphétamines. La construction du roman donne le tournis, on hésite entre abandon peu glorieux et admiration totale. Le lecteur se retrouve dans la position inconfortable de ces bûcherons héros du roman, conduisant les grumes le long du cours du fleuve, quand le train de troncs file et que vous devez garder l’équilibre au risque d’y laisser votre peau.
J’avoue avoir été déconcerté souvent, perdu quelquefois mais aussi sous le charme de séquences éblouissantes (la rencontre entre Hank et Viv ; Hank au chevet de son cousin Joe, coincé et condamné sous une grume). Ce n’est pas un roman, c’est un bouquin monstrueux aux tentacules innombrables. Le trop est l’ennemi du bien, dit un dicton populaire, ici nous sommes à l’extrême limite et vous passerez d’un sentiment à l’autre au fil de votre lecture. J’ai lu des critiques évoquant Steinbeck ou Faulkner, il y a effectivement du premier le roman prolétarien et l’exploitation d’une certaine misère, et du second l’expiation, mais je crois plus simplement qu’il y a un style Ken Kesey et qu’il se suffit à lui-même.
Je ne sais pas à quel public est destiné cet ouvrage car il faudra d’abord avoir le courage de s’y atteler et ensuite la force et l’endurance pour aller jusqu’au bout de sa lecture. Mais sachez que ceux qui en seront venus à bout en sortiront grandis. Alors, qui veut s’engager sur la rivière sans retour ?
« Ainsi conférais-je avec la lune tandis qu’octobre touchait à sa fin. Trois semaines après avoir quitté New York, ma valise remplie de certitudes. Trois semaines après avoir infiltré le château Stamper, de vagues projets de vengeance mijotant au fond de ma tête, trois semaines de supplices physiques et de volonté veule, et pourtant ma vengeance ne faisait encore que mijoter. A peine, d’ailleurs. En fait, elle avait considérablement tiédi. Pour dire les choses franchement, elle était presque congelée dans un coin de ma mémoire : dans les trois semaines qui avaient suivi mon vœu de faire tomber Hank de son piédestal, mes intentions s’étaient refroidies et mon cœur réchauffé, toute une famille de mites avait élu domicile dans ma valise et mangé mes pantalons en même temps que mes certitudes. »
 Ken Kesey Et quelquefois j’ai comme une grande idée Monsieur Toussaint Louverture
Ken Kesey Et quelquefois j’ai comme une grande idée Monsieur Toussaint Louverture
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Antoine Cazé
28/12/2013 | Lien permanent | Commentaires (4)
Henri Queffélec : Les grandes heures de l’océan

Né en 1910 et décédé en 1992 son roman le plus célèbre parmi les plus de 80 livresécrits, est Un recteur de l’île de Sein. Il est aussi responsable du scénario tiré de son roman pour le film réalisé par Jean Delannoy Dieu a besoin des hommes (1950). Par ailleurs il est aussi le père de l’écrivain Yann Queffélec (Goncourt 1985 avec Noces Barbares).
Avec Les grandes heures de l’océan il ne s’agit pas d’un roman, mais d’un recueil de textes datant de 1968 qui in fine dressent un éloge de la mer et des hommes quila fréquentent. Le périmètre reste néanmoins circonscrit à la France, surtout à la Bretagne et sa ville chérie Saint-Malo. On croise Pierre Loti, les baleines du golfe de Gascogne et les thons, des naufrages, les pêcheurs et leurs bateaux, vagues et algues.
Un délicieux voyage où le vent sent l’iode et résonne du rugissement des mers et des océans, écrit dans un style un peu daté aujourd’hui, car riche en belles phrases et tournures quasi musicales, une littérature qui tend à disparaître, une bonne raison pour s’y replonger.
« Les plus belles formes et couleurs de rouleaux s’abattant sur une plage, je les ai vues à Losmarc’h, dans des lendemains de tempête, au début et au milieu de la haute mer. Nulle part en France les vagues ne peuvent illustrer avec la même force la pureté animale et magique du mot glauque. Ces violents ne recherchaient pas la perfection symétrique d’une muraille, ils se dressaient comme des lambeaux arrachés avec de plus en plus de rudesse à la chair de l’océan, ils se tordaient et se crispaient sous l’effort avec des vibrations de lèvres et sur un dernier haussement vif ils s’écroulaient, vitraux énormes, dans le fracas de la destruction d’une cité. »
 Henri Queffélec Les grandes heures de l’océan Librairie Académique Perrin
Henri Queffélec Les grandes heures de l’océan Librairie Académique Perrin
16/10/2012 | Lien permanent