Rechercher : les grands cerfs
Elvira Navarro : La Ville heureuse
 Elvira Navarro, née en Espagne en 1978, a passé son enfance entre Valence et Cordoue et elle vit désormais à Madrid où elle a obtenu son diplôme de Lettres. Son premier livre est paru en 2007, La ville en hiver, chaleureusement accueilli par la critique et récompensé par le prix Fnac du Jeune Talent. Elle a été choisie par la revue Granta parmi les 22 meilleurs auteurs de langue espagnole de la jeune génération. En 2009 elle publie La ville heureuse qui vient tout juste d’être traduit chez nous.
Elvira Navarro, née en Espagne en 1978, a passé son enfance entre Valence et Cordoue et elle vit désormais à Madrid où elle a obtenu son diplôme de Lettres. Son premier livre est paru en 2007, La ville en hiver, chaleureusement accueilli par la critique et récompensé par le prix Fnac du Jeune Talent. Elle a été choisie par la revue Granta parmi les 22 meilleurs auteurs de langue espagnole de la jeune génération. En 2009 elle publie La ville heureuse qui vient tout juste d’être traduit chez nous.
Un gamin arrive de Chine pour rejoindre sa famille émigrée en Espagne depuis trois ans, où elle tient un modeste petit commerce de restauration. Sara, une fillette, cherche à entrer en contact avec un vagabond qui l’effraie et la fascine tout autant.
Etrange roman que cet ouvrage d’Elvira Navarro, constitué de deux parties complètement distinctes l’une de l’autre, comme deux novellas accolées par un lien ténu, le jeune chinois et la fillette vivent dans le même quartier et ont été copains de jeux à une époque. Même la forme accentue cette dichotomie puisque l’écriture diffère entre les deux parties. La première recèle des phrases curieusement construites ou la présence de mots ne semblant pas toujours adéquats (traduction ?), tandis que la seconde est rédigée d’une écriture beaucoup plus évidente et banale. La première est racontée par une voix extérieure, la seconde par la jeune Sara. Mais point commun à ces deux formes narratives, une langue à la musique peu attractive.
Tout est froid dans ce roman. Les décors sont abstraits, les noms de lieux sont identifiés par une lettre initiale, rien n’est chinois, rien n’est espagnol, la mondialisation aseptisée. Comme l’écriture n’incite pas à l’empathie pour les deux gamins, on a du mal à s’intéresser au texte. Un point de vue d’écrivain trop cérébral, intellectuel dans le sens négatif du terme.
Que veut nous dire Elvira Navarro avec ce roman peu évident. J’avouerai ne pas trop savoir et j’assume mon ignorance crasse. Certes, il y est question de difficultés à communiquer, comme entre le garçon et sa mère, « ils étaient allés trop loin dans l’incompréhension mutuelle » constate-t-il. Ou bien entre Sara et ses parents, « Ils ne savent pas non plus comment aborder le sujet avec moi », et aussi entre la fillette et le vagabond « et en réalité nous n’arrivons jamais à un toi et moi, mais seulement à son univers et mon univers. » Un thème bien connu et qui n’a rien de novateur ici.
Pourtant d’autres aspects, bien qu’esquissés, ouvrent une porte de réflexion plus intéressante, comme le rôle de la langue du pays d’accueil et son importance pour un immigré qui tout en l’acquérant constate « une subtile variation dans son identité ». A moins que ce ne soit le passage de l’enfance au stade du jeune adulte, faisant dire par son amie à Sara, « Tu deviens sérieuse » et « venant de sa bouche l’accusation est grave. »
Un roman qui m’a laissé de glace, à l’image de son titre relevant de l’humour froid et pince-sans-rire.
« Désormais, son père ne signifiait plus grand-chose pour sa mère, et pour son grand-père, tout comme le pensait sa mère, il ne signifiait rien de plus que son désir de l’anéantir. D’un autre côté, si sa mère et son grand-père avaient appris un peu plus l’espagnol, ne serait-il pas renfermé ? La liberté de son père ne dépendait-elle pas du fait que ni sa mère ni le grand-père ne le comprenaient pas ? Sa mère communiquait avec son père avec de brèves phrases informatives : « La facture du gaz est arrivée », « Il faut aller racheter des fûts de bière », « La charnière de la porte droite du buffet s’est dévissée ». Son grand-père ne communiquait jamais directement avec son père, mais à travers eux. « Dis à ton père, disait-il à Chi-Huei devant son père, qu’il vérifie l’inventaire de la réserve ».
 Elvira Navarro La Ville heureuse Editions Orbis Tertius - 217 pages –
Elvira Navarro La Ville heureuse Editions Orbis Tertius - 217 pages –
Traduit de l’espagnol par Alice Ingold
11/07/2014 | Lien permanent | Commentaires (2)
David Foenkinos : Les Souvenirs
 David Foenkinos, écrivain français est né en 1974 à Paris. Il étudie les lettres à la Sorbonne, tout en se formant au jazz, ce qui l'amène au métier de professeur de guitare. Son premier roman est publié en 2002 chez Gallimard. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs écrivains de la nouvelle génération. Son nouveau roman, Les Souvenirs, vient tout juste de paraître.
David Foenkinos, écrivain français est né en 1974 à Paris. Il étudie les lettres à la Sorbonne, tout en se formant au jazz, ce qui l'amène au métier de professeur de guitare. Son premier roman est publié en 2002 chez Gallimard. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs écrivains de la nouvelle génération. Son nouveau roman, Les Souvenirs, vient tout juste de paraître.
Le roman débute par un regret, alors qu’il assiste son grand-père durant ses derniers instants, Patrick le narrateur constate « je voulais lui dire que je l’aimais, mais je n’y suis pas parvenu ». Le personnage central du livre a du mal à communiquer et il n’est pas le seul, les autres personnages du roman se parlent peu ou avec difficultés, n’ayant rien à se dire ou n’osant pas s’exprimer, ses parents les premiers. Dans ce contexte on ne s’étonne pas que Patrick soit un solitaire et un sentimental sans petite amie, un timide qui se verrait bien écrivain. Dans l’immédiat et pour gagner sa vie, il tient l’accueil de nuit dans un hôtel, en profitant pour noter des idées pour son futur premier roman qui peine à s’écrire.
Après le décès du grand-père paternel, il y aura la mise en maison de retraite de la grand-mère, laquelle fera une fugue ; ses parents qui prennent leur retraite et sa mère qui semble donner des signes de folie, la rencontre avec sa future femme et le divorce de ses parents, puis l’inverse à savoir son divorce et le retour de sa mère au foyer conjugal. Comme on le voit on ne s’ennuie pas, résumé ainsi ça peut paraître abracadabrant, et ça l’est un peu car David Foenkinos ne manque pas d’humour, mais tout s’enchaîne harmonieusement avec beaucoup de talent.
Le roman est ponctué de remarques sur un peu tout, comme ces pages critiques sur les pavillons de banlieue « Je les trouve sinistres. J’aime les maisons de campagnes ou les appartements ; j’aime qu’on choisisse son camp. » Et les jolies formules déroutantes ne manquent pas, « je suis heureux quand je contemple une femme suisse ou un paysage mauve » ou encore « Finalement le dernier enfant que j’avais côtoyé, ça devait être moi.»
Au fur et à mesure qu’on s’insinue dans le livre, chaque personnage raconte un souvenir qui vient enrichir le récit et le nourrir d’instants de vie. Le récit n’est pas le seul à se nourrir des souvenirs, les humains y trouvent aussi matière à se construire, c’est ce que découvrira Patrick devenu un homme, enfin prêt à écrire son fameux roman.
L’écriture de David Foenkinos est délicate, faite de sérénité, et le tout sonne terriblement juste, la moindre remarque donne l’impression d’avoir été vécue. Le ton évolue entre passages émouvants et moments drôles, sans excès dans l’un comme dans l’autre. Le roman pourrait être autobiographique – on ne le sait pas – mais qu’il le soit ou non, cela n’a pas grande importance, ce qui est évident c’est que ce bouquin est un très bon livre et l’auteur un jeune homme plein de talent.
« Assis sur une chaise à côté de lui, j'avais l'impression que le temps ne passait pas. Les minutes prétentieuses se prenaient pour des heures. C'était lent à mourir. Mon téléphone a alors affiché un nouveau message. Je suis resté en suspens, plongé dans une fausse hésitation, car au fond de moi j'étais heureux de ce message, heureux d'être extirpé de la torpeur, ne serait-ce qu'une seconde, même pour la plus superficielle des raisons. Je ne sais plus vraiment quelle était la teneur du message, mais je me rappelle avoir répondu aussitôt. Ainsi, et pour toujours, ces quelques secondes insignifiantes parasitent la mémoire de cette scène si importante. Je m'en veux terriblement de ces dix mots envoyés à cette personne qui n'est rien pour moi. J'accompagnais mon grand-père vers la mort, et je cherchais partout des moyens de ne pas être là. Peu importe ce que je pourrai raconter de ma douleur, la vérité est la suivante : la routine m'avait asséché. Est-ce qu'on s'habitue aux souffrances ? Il y a de quoi souffrir réellement, et répondre à un message en même temps. »
 David Foenkinos Les Souvenirs Gallimard
David Foenkinos Les Souvenirs Gallimard
13/10/2012 | Lien permanent | Commentaires (1)
Don DeLillo : Les noms
 L’écrivain américain Don DeLillo nous a habitué depuis longtemps à ses gros livres touffus qui mêlent les époques et brassent les idées. Se plonger dans l’un de ses pavés s’est s’immerger dans sa vision du monde, sous forme de métaphores où s’enchevêtrent aujourd’hui et hier pour mieux nous parler de demain.
L’écrivain américain Don DeLillo nous a habitué depuis longtemps à ses gros livres touffus qui mêlent les époques et brassent les idées. Se plonger dans l’un de ses pavés s’est s’immerger dans sa vision du monde, sous forme de métaphores où s’enchevêtrent aujourd’hui et hier pour mieux nous parler de demain.
Avec ce roman, Les noms, paru en 1982 aux Etats-Unis mais traduit en 1990 pour la France, l’auteur nous livre sa version de la place de l’Amérique dans le monde. « L’Amérique est le mythe vivant du monde ». Le monde vu par l’Amérique, l’Amérique vue par le monde à travers cinq cents pages d’un roman politique et méandreux, complexe à appréhender.
Le livre se déroule autour de la Méditerranée et au Moyen-Orient comme dans les romans d’espionnage, car la zone est riche en Histoire, conflits larvés ou actifs, peuples divers, nomades ou sédentarisés. Régions des débuts et peut-être de la fin pour l’Homme, terres des langues ancestrales et millénaires. Des employés Américains de grandes multinationales naviguent entre ces différents pays, rédigeant des rapports et des analyses sur la situation géopolitique pour anticiper les évènements qui pourraient perturber les cours des matières premières et énergétiques. A Beyrouth ou Athènes, ils ont leurs habitudes, leurs points de chute. L’un d’eux va se laisser entraîner dans une enquête suite à un meurtre rituel qui va le mettre sur la piste d’une secte qui a le culte des mots. Le nom de votre ennemi est inscrit sur une poterie, on brise la poterie, plus de nom donc plus d’existence. « Voilà ce que nous apportons au temple, non pas des prières ou des incantations ou des béliers sacrifiés. Notre offrande est le langage ».
Un livre dense, pas facile à lire. Difficile de suivre les protagonistes, la chronologie des évènements et les idées. Néanmoins un roman fascinant pour ceux qui acceptent de se laisser entraîner par le rythme des mots, quitte à perdre pied durant plus phrases avant de refaire surface à la page suivante. Personnellement je n’ai que moyennement adhéré à la narration et ce n’est pas mon bouquin de Don DeLillo que je préfère, mais il faudrait le relire au moins une fois de plus pour donner un avis sensé.
« Le monde es tellement grand. On nous répète sans cesse qu’il rapetisse. Mais ce n’est pas vrai. Tout ce que nous apprenons à son sujet le rend plus grand. Tout ce que nous faisons pour compliquer les choses le rend plus grand. Ce n’est qu’une vaste complication. Un vaste embrouillamini. Elle se mit à rire. Les communications modernes ne rétrécissent pas le monde, elles l’agrandissent. Les avions rapides l’agrandissent. Ils nous donnent davantage, ils relient plus de choses entre elles. Le monde ne rétrécit pas du tout. Ceux qui prétendent qu’il rétrécit n’ont jamais volé sur Air Zaïre dans un orage tropical. Je ne savais pas ce qu’elle entendait par là, mais cela avait l’air drôle. Cela lui parut drôle aussi. Elle était forcée de parler par-dessus son fou rire. Rien d’étonnant à ce que les gens retournent à l’école pour apprendre s’étirer et se courber. Le monde est si grand et si compliqué que nous n’avons plus confiance en nous-mêmes pour comprendre quoi que ce soit. Rien d’étonnant à ce que les gens lisent des livres qui leur disent comment courir, marcher, s’asseoir. Nous essayons de rester au courant du monde, de sa taille, de ses complications.

12/10/2012 | Lien permanent
James Salter : Et rien d’autre
 James Salter, né en 1925 à New York sous le véritable nom de James A. Horowitz, est écrivain et scénariste. Son premier livre basé sur son expérience de pilote de chasse durant la guerre de Corée, The Hunters paru en 1956, a été adapté au cinéma avec Robert Mitchum en 1958. Et rien d’autre, son tout nouveau roman, vient de paraître.
James Salter, né en 1925 à New York sous le véritable nom de James A. Horowitz, est écrivain et scénariste. Son premier livre basé sur son expérience de pilote de chasse durant la guerre de Corée, The Hunters paru en 1956, a été adapté au cinéma avec Robert Mitchum en 1958. Et rien d’autre, son tout nouveau roman, vient de paraître.
Philip Bowman, jeune homme issu d’une famille modeste aux parents séparés, rentre aux Etats-Unis après avoir connu les combats du Pacifique au cours de la Seconde guerre mondiale. Il rêve d’être journaliste mais ne dénichera qu’une place dans le monde de l’édition littéraire à New York - ce qui nous vaut quelques digressions intéressantes -, où finalement il fera son trou. Sa situation professionnelle assurée, il tentera d’acquérir une maison pour y bâtir un foyer durable avec celle qui doit être le grand amour de sa vie. Cette quête du bonheur conjugal est au cœur de ce roman.
Il y a des livres comme des bouteilles de vin, à peine entamés on sait qu’ils seront bons. Et celui-ci, croyez m’en, est un sacrément bon cru. Nous allons suivre Philip Bowman, de sa jeunesse aux armées jusqu’à ce qu’on appelle l’âge mûr, à travers une chronologie à peine notifiée par l’écrivain si ce n’est deux ou trois fois, par un indice abrupt comme celui-ci qui vient clore un chapitre : «Quelque chose de terrible venait de se produire. Le Président avait été assassiné à Dallas. » Ténu mais extrêmement précis.
Après des débuts dans la vie assez réservés avec les femmes, Bowman va se rattraper et certaines auront une grande place dans sa vie, au point qu’il pensera avoir trouvé celle qu’il cherche en vain. Il y aura Vivian, la première et qu’il épousera, puis après son divorce il aura des espoirs avec Enid rencontrée à Londres, ou bien Christine qui le larguera et lui piquera sa maison, et bien plus tard, Ann, une collaboratrice sur son lieu de travail qui semblera boucler une boucle de recherches au loin, alors que sous ses yeux l’attendait son Graal. Mais le lecteur restera sur une interrogation car le roman s’achève en laissant la porte ouverte à toutes les possibilités. Les dernières pages touchant au sublime, mêlant les souvenirs d’une vie passée, l’évocation de la mort qui viendra obligatoirement un jour pas si lointain et un projet à court terme, comme un feu d’artifice final pour Philip Bowman.
Le roman a un charme fou, dû à l’écriture somptueuse de James Salter. Je me suis délecté à le lire, profitant de chaque page et m’attristant d’en voir venir la fin. Les personnages secondaires entrent et sortent, magistralement décrits, au point que parfois on s’imagine les voir jouer un rôle plus important alors qu’ils ne font que passer. Même les scènes de sexe – car il y en a – belles et crues parfois, sont splendides, je le note tant c’est rare, mais une preuve de plus du grand talent de l’écrivain.
Les critiques sont unanimes sur les qualités de ce bouquin et je ne peux que me joindre à ce concert de louanges. Roman des rêves non exaucés sans pour autant en faire une vie ratée, un très grand roman… et rien d’autre.
« Ils éditaient de grands livres, aimait à répéter Baum, mais seulement par nécessité. Pas question de refuser un best-seller par principe. L’idée, disait-il, était de payer peu et de vendre par brassées. Au mur de son bureau était accrochée une lettre encadrée d’un collègue et ami, éditeur expérimenté, à qui on avait demandé de lire un manuscrit. (…) Rien ne nous est épargné, sauf peut-être le plus obscène. Ce livre ne vaut rien. « On en a vendu deux cent mille exemplaires, se vanta Baum, et il est en cours d’adaptation au cinéma. Le plus gros succès qu’on ait jamais eu. J’ai fait encadrer cette lettre pour ne pas oublier la leçon. » »
 James Salter Et rien d’autre Editions de l’Olivier – 365 pages –
James Salter Et rien d’autre Editions de l’Olivier – 365 pages –
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Marc Amfreville
26/10/2014 | Lien permanent | Commentaires (4)
Raymond Chandler : Un tueur sous la pluie
 Raymond Chandler (1888–1959) est un écrivain américain, auteur de romans policiers. Après le divorce de ses parents (1895), Chandler déménage en Grande-Bretagne avec sa mère, d'origine irlandaise et il est naturalisé citoyen britannique en 1907. A son retour de la Première Guerre mondiale, Chandler s’installe à Los Angeles et écrit son premier roman en 1939, Le Grand sommeil, mettant en scène le fameux détective Philip Marlowe. Il travaillera également pour Hollywood comme scénariste. Outre des nouvelles, Chandler a écrit sept romans auquel on rajoutera Marlowe emménage, la publication posthume d’un inachevé.
Raymond Chandler (1888–1959) est un écrivain américain, auteur de romans policiers. Après le divorce de ses parents (1895), Chandler déménage en Grande-Bretagne avec sa mère, d'origine irlandaise et il est naturalisé citoyen britannique en 1907. A son retour de la Première Guerre mondiale, Chandler s’installe à Los Angeles et écrit son premier roman en 1939, Le Grand sommeil, mettant en scène le fameux détective Philip Marlowe. Il travaillera également pour Hollywood comme scénariste. Outre des nouvelles, Chandler a écrit sept romans auquel on rajoutera Marlowe emménage, la publication posthume d’un inachevé.
La présente réédition – récente et dans une nouvelle traduction - d’Un tueur sous la pluie, est un recueil de trois nouvelles : Un tueur sous la pluie (Killer In The Rain - 1935), Bay City Blues (Bay City Blues - 1938) et Déniche la fille (Try The Girl - 1937). Comme souvent chez l’écrivain, ses nouvelles étaient ensuite développées ou intégrées dans de futurs romans ; ici ces trois textes le seront respectivement dans Le Grand sommeil (The Big Sleep), La Dame du lac (The Lady In The Lake) et Adieu, ma jolie (Farewell, My Lovely).
Je vous rappelle brièvement les intrigues de ces nouvelles :
Un tueur sous la pluie : Un homme veut retrouver sa fille qui fricote avec un trafiquant de livres pornos et photos de nus et fait appel à un détective privé (dont le nom n’est jamais cité !). Bay City Blues : Un médecin marron dealer de morphine, du chantage, un flic pourri, des cadavres et une version noire de Cendrillon, avec un détective nommé Johnny Delmas. Déniche la fille : Ici le détective s’appelle Carmady et tente de retrouver Beulah, la copine de Steve Skalla, un mastard de 2,14m et 115kg.
Je ne vais pas trop m’étendre sur ce bouquin car j’imagine que vous l’avez tous lu et que je ne peux dire mieux que tout ce qui en a déjà été dit. Des histoires avec des mecs, des vrais, des pépées girondes et retorses et des détectives (tous des alias de Philip Marlowe, le seul et unique) faciles au coup de poing mais avec un grand cœur. Quant à l’écriture, elle coule fine et précise avec cette pointe d’ironie qui lui donne toute sa saveur (« - Il y a quelque chose qui sent mauvais dans votre histoire, non ? – C’est votre moustache qui brûle, répondis-je. » [Déniche la fille].
Qui n’a jamais lu Raymond Chandler n’a jamais lu de polars ! La seule excuse que vous puissiez avancer pour vous défendre, c’est d’être encore très jeune… auquel cas, je vous conseillerai amicalement de vous dépêcher de rattraper ce retard. Pour ma part Raymond Chandler, lu lorsque j’étais à peine plus qu’un gamin, est associé dans mon esprit au Noir & Blanc qui va si bien aux films avec Humphrey Bogart diffusés à la télévision, formant un tout cohérent de grande qualité et la genèse d’un genre littéraire qui fera des émules.
« Steiner était chaussé de pantoufles chinoises avec d’épaisses semelles de feutre. Il portait un pantalon de pyjama en satin noir dont la veste s’ornait de broderies chinoises. Tout le devant était inondé de sang. Son œil de verre brillait d’un éclat fixe et c’était bien ce qui était en lui le plus vivant. A première vue, aucune des trois balles tirées ne l’avait manqué. L’ampoule flash correspondait, bien sûr, à l’éclair que j’avais vu filtrer par les fenêtres de la maison et auquel la fille nue et droguée avait réagi en poussant ce drôle de cri. » [Un tueur sous la pluie]
 Raymond Chandler Un tueur sous la pluie Folio - 305 pages –
Raymond Chandler Un tueur sous la pluie Folio - 305 pages –
Traduction de l’américain par Henri Robillot révisée par Cyril Laumonier
25/09/2016 | Lien permanent | Commentaires (2)
Taylor Brown : Les Dieux de Howl Mountain
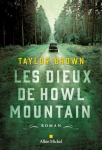 Taylor Brown est né en 1982 en Géorgie, dans le sud des Etats-Unis, puis il a vécu à Buenos Aires et San Francisco avant de s’installer en Caroline du Nord. Les Dieux de Howl Mountain, son troisième roman, vient de paraître.
Taylor Brown est né en 1982 en Géorgie, dans le sud des Etats-Unis, puis il a vécu à Buenos Aires et San Francisco avant de s’installer en Caroline du Nord. Les Dieux de Howl Mountain, son troisième roman, vient de paraître.
En 1952, un bled de montagne en Caroline du Nord. Rory Docherty est revenu de la guerre en Corée avec une prothèse pour remplacer sa jambe, il habite avec sa grand-mère maternelle, Ma, depuis que son père a été assassiné et sa mère traumatisée à la rendre muette, puis placée en hôpital psychiatrique. Son job, livrer aux bars louches et clandés du secteur, le bourbon distillé par Eustace. Cette vie assez étriquée s’illumine quand il tombe amoureux de Christine, fille du pasteur de l’Eglise de la Lumière Nouvelle. Mais le bonheur est une chose fragile quand d’un côté le shérif et un agent fédéral cherchent à le pincer avec sa cargaison de gnole, et qu’un jeune chef de bande, Cooley Muldoon, lui en veut à mort après s’être fait humilier.
Inscrivez immédiatement ce roman dans vos priorités car il est excellent !
Dans ce bouquin, comme dans le cochon, tout est bon. Prenons l’intrigue, que dis-je, les intrigues, car elles sont nombreuses : guerre de monopole pour alcool clandestin (Eustace), rancune personnelle (Cooley), amour (Christine), secret familial et vengeance (qui est responsable de ce qui est arrivé aux parents de Rory ?) Un seul de ces sujets suffisait à faire un livre, Taylor Brown les amalgame avec talent pour en tirer un roman dense et puissant.
Tous les personnages sont attachants ou mémorables, qu’ils soient bons ou méchants. Outre Rory, jeune gars abîmé physiquement, hanté par les horreurs de la Corée et sa quête de vérité sur le sort de ses parents, devant affronter les forces de l’ordre (pas vraiment irréprochables non plus) tout en tentant maladroitement de conquérir le cœur de sa bien- aimée aux yeux verts, l’autre grand acteur du roman c’est indiscutablement Ma. Guérisseuse ou sorcière, elle mitonne remèdes et poisons avec les plantes, fume la pipe et n’a peur de rien ayant tout vécu : jadis elle s’est prostituée pour nourrir sa fille, aujourd’hui elle est épisodiquement la maîtresse d’Eustace, l’imposant chauve et barbu grand manitou des alambics du coin. Je vous laisse découvrir les seconds rôles, comme le pasteur qui ne l’a pas toujours été…
Il y a déjà là matière à se réjouir, une sacrément bonne histoire, pleine et grasse à s’en lécher les doigts. Nous y ajouterons une écriture ou un style, tout à fait remarquable, concourant à assurer le liant entre tous les éléments narratifs. Taylor Brown prend son temps pour distiller son jus, même dans les scènes sensées être rapides (poursuites ou course automobile). Là aussi l’écrivain fait dans le gras ou l’épais tout en restant léger néanmoins (tout le contraire de ceux qui ont opté pour l’épure, le texte squelettique, l’os ultime), les descriptions abondent et quelque en soit le sujet Taylor Brown semble en connaitre un rayon (les plantes, la mécanique etc.) capable de nous faire vivre dans ces lieux et cette époque comme si nous y étions. Les bonnes répliques abondent (« - Tu as quand même passé une bonne soirée ? demanda-t-il. – J’en ai connu des meilleures. – Avec Eustace ? – Non, avec un épi de maïs. »). Bref, on se régale.
Beau, émouvant, triste, inquiétant, révoltant… le lecteur passe par une large palette de sentiments et quand il referme le livre, convaincu de sa très grande qualité, il s’interroge très excité : n’est-ce que feu de paille ou la naissance d’un futur grand écrivain ?
« Chaque jour de sa vie, jusqu’à ce que l’hôpital psychiatrique la lui prenne, sa fille avait eu de quoi manger, qu’importent les péchés que ça lui coûtait. Ensuite, elle avait pris soin de Rory. C’était pour le protéger qu’elle avait suspendu des bouteilles dans l’arbre. Quand il était parti en Corée, elle n’avait jamais cessé de prier. Pas le dieu des églises, mais le sien propre. Celui qui siégeait pas loin, peut-être plus haut dans la montagne. Car c’était là une demeure idéale pour un dieu, bien plus qu’un bâtiment ou un livre. Ici, on la comprenait. Elle était rusée, bien sûr, mais pas hypocrite. Toute sa vie, elle s’était battue comme une bête. Le Christ ensanglanté, cloué nu et hurlant sur la croix – les os fendus par le fer de la lance, le corps fouetté jusqu’à la chair -, était un dur au mal. Pour sûr, il avait du cran, un cœur de fauve. Comme elle. Tout le reste, elle n’en avait rien à faire. »
 Taylor Brown Les Dieux de Howl Mountain Albin Michel – 371 pages – (A paraître le 2 mai)
Taylor Brown Les Dieux de Howl Mountain Albin Michel – 371 pages – (A paraître le 2 mai)
Traduit de l’américain par Laurent Boscq
29/04/2019 | Lien permanent
Justine Bo : Eve Melville, Cantique
 Justine Bo, Justine Bourdais de son vrai nom, née à Cherbourg en 1989, est une réalisatrice et romancière. Justine Bo fait une année de Prépa littéraire, puis entre à Sciences Po Paris en 2008. Elle séjourne dans les territoires palestiniens à l'été 2010, comme bénévole dans une école de musique de Ramallah, puis fait un stage à l'ambassade de France à Damas en Syrie en septembre 2010 pour sa troisième année du collège universitaire de Sciences Po. Elle y reste un an, alors qu'en mars 2011 le « Printemps arabe » atteint la Syrie. Elle tire de cette expérience son premier roman Fils de Sham (2013). En 2014, elle s'installe à New York pour étudier le cinéma. En parallèle, elle travaille pour un magazine en ligne et réalise des documentaires. Son nouveau roman Eve Melville, Cantique vient de paraître.
Justine Bo, Justine Bourdais de son vrai nom, née à Cherbourg en 1989, est une réalisatrice et romancière. Justine Bo fait une année de Prépa littéraire, puis entre à Sciences Po Paris en 2008. Elle séjourne dans les territoires palestiniens à l'été 2010, comme bénévole dans une école de musique de Ramallah, puis fait un stage à l'ambassade de France à Damas en Syrie en septembre 2010 pour sa troisième année du collège universitaire de Sciences Po. Elle y reste un an, alors qu'en mars 2011 le « Printemps arabe » atteint la Syrie. Elle tire de cette expérience son premier roman Fils de Sham (2013). En 2014, elle s'installe à New York pour étudier le cinéma. En parallèle, elle travaille pour un magazine en ligne et réalise des documentaires. Son nouveau roman Eve Melville, Cantique vient de paraître.
Nous sommes en 1845, Solomon, enfant Noir déjà esclave dans une plantation de Géorgie, s’enfuit et remonte vers le Nord, parcours qui l’amène à Brooklyn en 1861 où après plusieurs années il obtiendra des papiers à son nom, Melville. Devenu un homme libre, il exerce mille et un métiers avant de finir policier et quand vient l’heure de la retraite, il s’achète une maison « une maison qui n’en fait pas trop, qui ne se pavane pas, sans bow-window aguichant la rue » avant de repartir mourir en Géorgie. Dans cette maison de Brooklyn se succèderont son fils Moses et son petit-fils Samuel.
Nous sommes maintenant en 2016 et Eve Melville, arrière-petite-fille de Solomon, infirmière dans la police, découvre que sa maison a été repeinte en noir durant la nuit ! Un coup bas des promoteurs qui rachètent les maisons du coin mais butent sur Eve qui refuse de céder l’héritage familial durement acquis. Dès lors, un long combat s’engage entre elle et eux, une résistance qui la conduit à la folie… ?
Enfin de la très grande littérature ! Ce n’est pas tous les jours qu’on peut lire un tel livre.
Un roman plutôt court mais qui n’empêche pas Justine Bo de nous faire revivre plus d’un siècle d’histoire des Etats-Unis, la douloureuse époque de l’esclavage, la guerre du Vietnam, l’attentat contre les Twin Towers, le Sida, les drogues, l’élection de Trump… Tout cela en toile de fond.
Le cœur du roman reste néanmoins cette maison au 629 Halsey Street. Un lieu de mémoire pour Eve, et les souvenirs de revenir en masse, une demeure acquise au prix du sang et de la sueur, transmise de génération en génération. Le combat qu’elle entame contre les promoteurs prend des allures de va-tout, pour des raisons personnelles familiales mais plus largement comme une résistance désespérée contre un certain capitalisme envahissant détruisant son passé, sa raison d’être. Magnifique.
Pourtant le meilleur est encore ailleurs : ce style ! Le texte est une succession de petits paragraphes sans lettre majuscule à leur entame car l’écrivaine n’utilise que très peu les points de ponctuation sans que le lecteur s’essouffle pour autant à la lire. Les tournures de phrases ne manquent pas de grâce et d’originalité (« Ses plumes comme dans un rêve se soulevaient légères, prises dans un air qui de terrestre n’avait plus rien. »). L’emploi de l’anaphore (« Comment Eve Melville est devenue folle, il faut que je vous le dise ») scande la dernière partie du récit comme une prière, une incantation, un cantique.
Du très grand art pour un roman que vous devez absolument lire car ne ressemblant à aucun autre.
« ici tous les humains sont les bienvenus, tous les humains sont nos amis, tous nous vivons ensemble ainsi que toujours nous avons vécu, nous sommes un tout et nous sommes heureux, nous sommes une communauté, un pays, un Etat, qui toujours fut grand et toujours le sera, Make America great again disent-ils, faites que l’Amérique redevienne grande, des idioties, je vous le dis, jamais nous n’avons cessé d’être grands, c’est vous qui nous rêvez petits »
 Justine Bo Eve Melville, Cantique Grasset - 211 pages -
Justine Bo Eve Melville, Cantique Grasset - 211 pages -
11/03/2024 | Lien permanent | Commentaires (4)
Louis Pergaud : La guerre des boutons
J’avais le bouquin sous le coude depuis plusieurs mois, acheté trois sous dans une brocante, en repoussant la lecture toujours à demain car La guerre des boutons est tellement connue que tout le monde s’imagine l’avoir déjà lue – ce qui n’est certainement pas la réalité, je suis prêt à le parier.
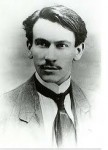 L’auteur Louis Pergaud né dans le Doubs (1882-1915) est instituteur comme son père avant de devenir romancier et exceller dans le domaine animalier. Il périra durantla Grande Guerre, sans que son corps soit jamais retrouvé.
L’auteur Louis Pergaud né dans le Doubs (1882-1915) est instituteur comme son père avant de devenir romancier et exceller dans le domaine animalier. Il périra durantla Grande Guerre, sans que son corps soit jamais retrouvé.
Son roman le plus célèbre, La guerre des boutons dont le sous-titre est Roman de ma douzième année date de 1912. Les gamins de deux petits villages voisins, Longeverne et Velrans, regroupés en bandes, s’affrontent depuis plusieurs générations suite à un différent cadastral quasi oublié depuis mais qui perdure dans les esprits. A la sortie de l’école, les gosses filent dans la campagne et s’affrontent verbalement, à coups de cailloux tirés de leurs lance-pierres, d’épées en bois ou de coups de poings si le combat rapproché s’impose. Petit à petit cette guerre va s’intensifier, les leaders organisent leurs troupes comme à l’armée chacun petits et grands ayant son rôle bien déterminé et le but des combats devient plus dur, désormais quand on fait un prisonnier on lui coupe les boutons de ses vêtements, on récupère ses lacets ou passants de ceinture et on le malmène férocement avant de le renvoyer vers ses copains qui jurent de le venger. Quand le gamin aux vêtements dévastés rentre chez lui, nous sommes dans le monde de la paysannerie pauvre qui se tue à la tâche, les parents n’ont pas de punition assez dure pour châtier le malheureux déjà déshonoré.
Louis Pergaud réussit là un roman magistral qui nous plonge dans la France rurale de la fin du XIXème siècle, la salle de classe et le maître, les élèves grands et petits, les conciliabules près des cabinets dans la cour, les leçons pas apprises avec le copain qui souffle, le tableau noir et les retenues, la vie aux champs et àla ferme. Maisc’est aussi l’occasion de dresser une esquisse dela III République, le conflit entre l’Eglise et la République, chaque village s’identifiant à l’un et l’autre camp « car on était calotin à Velrans et rouge à Longeverne », d’évoquer par allusions l’esprit de revanche après la Guerre de 1870. Ces grandes lignes sociopolitiques en toile de fond sont complétées par de savoureux détails sur la vie de ces pauvres petites bourgades à l’époque, et pour ajouter à la crédibilité de ces tranches de vie, les dialogues sont émaillés de termes issus du patois de Franche-Comté ou des fautes grammaticales des garnements bien souvent cancres car « on conçoit qu’il eût été impossible, pour un tel sujet, de s’en tenir au seul vocabulaire de Racine » écrit Pergaud dans sa préface.
Dire que je me suis régalé à cette lecture serait encore loin de la vérité, un très grand roman qui dépasse le pauvre résumé que je viens d’en faire. Ce n’est pas un livre d’histoires d’enfants pour des gamins - « ce livre qui, malgré son titre, ne s’adresse ni aux petits enfants, ni aux jeunes pucelles » - ici les enfants ne sont pas considérés comme des mioches par l’auteur, il les décrit comme il les connaît et en tant qu’instituteur on peut lui faire crédit. Je n’avais encore jamais lu ce livre, ma seule approche en était la version cinématographique de Yves Robert (1961) avec Jacques Dufilho, Jean Richard et Michel Galabru dont je n’ai d’ailleurs qu’un très lointain souvenir car je n’ai du le voir qu’une seul fois, et les noms des garnements Tigibus et Grandgibus. Il était temps de combler cette lacune.
« - Couille molle ! … Des couilles, on sait bien ce que c’est, pardine, puisque tout le monde en a, même le Miraut de Lisée, et qu’elles ressemblent à des marrons sans bogue, mais couille molle ! … couille molle !... – Sûrement que ça veut dire qu’on est des pas grand-chose, coupa Tigibus, puisque hier soir, en rigolant avec Narcisse, not’ meunier, je l’ai appelé couille molle comme ça, pour voir, et mon père, que j’avais pas vu, et qui passait justement, sans rien me dire, m’a foutu aussitôt une bonne paire de claques. Alors… L’argument était péremptoire et chacun le sentit. – Alors, bon Dieu ! Il n’y a pas à rebeuiller plus longtemps, il n’y a qu’à se venger, na ! conclut Lebrac… - C’est t-y vot’idée, vous autres ? – Foutez le camp de là, hein, les chie-au-lit, fit Boulot aux petits qui s’approchaient pour écouter ! Ils approuvèrent le grand Lebrac à l’inanimité, comme on disait. »
Mon exemplaire de cette Guerre des boutons date de 1947 aux Editions Littéraires de France avec des illustrations en noir et blancs ou en couleurs de Ralph Soupault un célèbre dessinateur de cette époque mais une personne peu fréquentable et condamné en 1945 pour « intelligence avec l’ennemi ».
16/10/2012 | Lien permanent
Voyages dans un fauteuil
Nous n’emprunterons pas l’avion ou le train, nous n’aurons même pas besoin de chausser nos rangers et encore moins de nous charger d’un quelconque sac à dos ou d’une valise étiquetée à notre nom. Le voyage sera encore plus beau peut-être, puisqu’il est de ceux qu’on fait confortablement lové dans un coin de son canapé, un livre à la main et la théière fumante sur la table basse. L’expédition par procuration ou les joies sans les peines, l’action sans l’effort. « Le plaisir qu’on trouve à voyager dans sa chambre est à l’abri de la jalousie inquiète des hommes ; il est indépendant de la fortune » (1)
J’ai fait le tour du monde. Avec Paul Théroux (2), grâce au chemin de fer qui permet de parcourir de longues distances tout en profitant du paysage et en côtoyant les autochtones, je connais la Chine, du désert de Gobi aux confins du Tibet, de la Grande Muraille à Ürümqi dans l’extrême ouest. La région m’est aussi familière par les récits plus anciens d’Ella Maillart (3) qui en 1935 quitte Pékin en direction du Sin-Kiang à dos de mulet ou de chameau pour une épopée que nul film ne pourra jamais égaler dans mon imagination. Concevoir un tel voyage quand on est une femme, à cette époque, dans une région troublée politiquement, voilà un beau défi mais quand il est relevé magistralement comme ici, chapeau bas ! L’Asie centrale me fascine assez pour que j’emboîte les pas d’Armin Vambery (4) déguisé en derviche errant qui gagnera Téhéran puis, à pied ou à dos d’âne, les régions interdites du Turkestan et les cités légendaires de Samarkand ou Boukhara et L’Afghanistan. Ces quelques exemples de voyageurs intrépides ne sauraient égaler le Père Huc (5) (Il n’y a pas de jeu de mots !) qui entreprit en 1841 un périple de cinq années à travers Mongolie et Chine, en chariot ou jonque. Il fut le premier Français à atteindre Lhassa, adoptant costume, langue et règles de vie des régions traversées.
Une première pause s’impose, et une gorgée de thé me permet de reprendre mes récits de voyages. Après l’Asie j’ai aussi fait l’Afrique bien évidemment. J’ai cherché les sources du Nil avec Burton et Speke (6). Là, on pense à Zanzibar, aux caravanes d’esclaves et trafiquants, aux grands lacs africains, à la chaleur accablante, aux souffrances que ces hommes vont endurer. Par contre, pour le célèbre « Docteur Livingstone, je présume ? » c’est Henry Stanley (7) qui s’y colle. Là encore, ce sont guides indigènes, crocodiles, miasmes et pachas locaux. L’Afrique c’est aussi le désert et son grand diseur reste Théodore Monod (8). Quand l’aventure rencontre la poésie, la sagesse en découle. Au milieu de l’erg, seul, vous n’êtes rien qu’un minuscule grain de sable, un maillon du Grand Dessein ; l’accablement du « je ne suis que cela » et la puissance du « mais je suis un Homme » envahissent votre esprit et l’expérience mystique vous plonge dans la béatitude. On peut aussi voyager et rigoler, c’est le cas avec O’Hanlon (9) qui part à la recherche d’un dinosaure au Congo. Après avoir échappé à l’étreinte amoureuse d’un gorille le voici sur l’Impfondo un vieux rafiot qui remonte le fleuve Congo.
Ne laissons pas refroidir le thé dans nos tasses, j’allume une lampe basse qui donne une chaude clarté à la pièce et je me replonge dans mes bouquins chéris. L’Océanie offre elle aussi de belles images à mon imagination galopante. Bien sûr il y a Thor Heyerdahl (10) et son expédition de 1947 sur un radeau entre le Pérou et la Polynésie qui devait démontrer que les Incas auraient pu franchir les 6900 kilomètres séparant les deux continents. Ce qui nous amène à l’Ile de Pâques (11) et aux théories les plus folles pour expliquer la présence de ses monolithes dressés comme des sentinelles géantes … A cet instant vous pouvez vous laisser aller à toutes les spéculations, plus elles seront farfelues, plus votre imaginaire en sortira gratifié. Posons notre livre, fermons les yeux et supposons que…
Et l’Amérique, tu connais ? La vraie découverte, vous la ferez avec Mark Twain (12) qui nous narre sa vie de conducteur de bateau à roue sur le Mississipi ou Audubon (13) le célèbre dessinateur des Oiseaux d’Amérique qui s’embarque dans la remontée du Missouri aussi loin que possible sur un bateau de trappeurs, à travers les territoires indiens jusqu’à la Yellow River et même les Rocheuses pour dessiner toutes les espèces d’oiseaux qu’il croisera sur sa route. Cette expédition de 1843 sera aussi sa dernière et son journal prend des airs de testament. Il n’y a pas une Amérique, mais des Amériques. La preuve avec Samuel Hearne (14) qui s’était lancé dans une traversée de la toundra canadienne entre 1769 et 1772, ce qui nous vaut un remarquable récit d’amitié avec son guide indien Matonabbee et d’aventures de vie et de mort. Pour ceux qui sont intéressés par les indiens il est indispensable de consulter le fabuleux Pieds nus sur la terre sacrée (15) illustré de photos de chefs comme Sitting Bull, Geronimo ou la Princesse Angeline dues à l’illustre Edward S. Curtis. Des photos en noir et blanc sublimes, accompagnées de textes émouvants sur les grandes nations indiennes (Sioux, Apache, Ojibway, Choctaw etc.…) décimées par les colons. Un must absolu. Tout au sud de nos Amériques, il y a la Patagonie et son chantre le plus célèbre est certainement Bruce Chatwin (16). Je vous résume le pitch, un jour le jeune Bruce quitte tout pour partir découvrir ce bout du monde à cause d’un fragment de peau de brontosaure exposé dans une vitrine chez sa grand-mère.
Tout au nord, le Groenland est une terre fertile en aventures et si Monod était le pape des déserts de sable chaud, Malaurie (17) est celui des déserts de glace. Le Français a vécu avec les Inuits, mangeant avec eux l’hiver ces oiseaux d’été qui ont pourri sous les pierres, écouté leurs récits mythologiques, pêché et chassé, conduit le traîneau à chiens dans le blizzard par un froid cruel pour devenir un véritable Esquimau, une nouvelle légende.
Certainement vous sentez-vous un peu las. Tous ces pays, que dis-je, ces continents survolés aussi vite, une petite fatigue vous guette. Tenez bon, nous approchons du port, déjà les mouettes au-dessus du navire signalent que la terre est proche.
L’Europe nous la découvrirons avec Leigh Fermor (18) qui décide en 1933 de traverser à pied le vieux continent, de la Hollande à Constantinople. Une double aventure, celle d’un jeune homme en devenir et une Europe qui va bientôt connaître la guerre. Les Anglais sont de grands voyageurs et nous en terminerons avec leur île. Tout d’abord avec Stevenson (19), celui de L’Ile au Trésor ou de Docteur Jekyll et Mister Hyde, qui par des notes de voyage et des récits ou des souvenirs d’enfance, nous parle de son pays, le Ross de Mull, Magus Muir, les Pentland Hills ou Edimbourg. Ultime virée avec celui avec lequel tout a commencé, Paul Théroux (20) qui nous entraîne dans un tour de la Grande-Bretagne en train, à pied, bus ou stop de trois mois. Les ports, les mines fermées, les bagarres entre skins et mods, la vie en somme.
Mon thé est froid, je referme mon bouquin et je contiens un léger bâillement. Il est tard et la nuit tombe, il est temps que je me couche, promesse d’autres voyages plus merveilleux encore peut-être.
Bibliographie :
1- Xavier de Maistre « Voyage autour de ma chambre » Editions Nilsson
2- Paul Théroux « La Chine à petite vapeur » Grasset
3- Ella Maillart « Oasis interdites » Petite Bibliothèque Payot
4- Armin Vambery « Voyage d’un faux derviche en Asie centrale 1862-1864 » Phébus
5- Père Huc : « Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie et le Thibet » suivi de « L’Empire chinois » chez Omnibus
6- Burton et Speke : « Aux sources du Nil » Petite Bibliothèque Payot
7- Henry M. Stanley : « Comment j’ai retrouvé Livingstone » chez Babel
8- Théodore Monod : « Méharées » chez Babel
9- Redmond O’Hanlon : « O’Hanlon au Congo » chez Flammarion
10- Thor Heyerdahl : « L’expédition du Kon-Tiki » au Livre de Poche
11- Francis Mazière : « Fantastique Ile de Pâques » au Livre de Poche
12- Mark Twain : « La vie sur le Mississipi » deux tomes chez Payot
13- John James Audubon : « Journal du Missouri » Petite Bibliothèque Payot
14- Samuel Hearne : « Le piéton du Grand Nord » Petite Bibliothèque Payot
15- « Pieds nus sur la terre sacrée » textes de TC McLuhan photos de Edward S. Curtis chez Denoël (1974)
16- Bruce Chatwin : « En Patagonie » Les Cahiers Rouges chez Grasset
17- Jean Malaurie : « Les derniers rois de Thulé » chez Pocket
18- Patrick Leigh Fermor : « Le temps des offrandes » et « Entre fleuve et forêt » chez Payot
19- Robert Louis Stevenson : « A travers l’Ecosse » aux Editions Complexe
20- Paul Théroux : « Voyage excentrique et ferroviaire autour du Royaume-Uni » Les Cahiers Rouges Grasset
09/12/2023 | Lien permanent | Commentaires (6)
Dan O’Brien : Rites d’automne
 Ecrit en 1988 le bouquin de Dan O’Brien était paru en France en 1991 époque où je l’avais lu pour la première fois dans la collection 10x18, il vient de ressortir chez Au Diable Vauvert dans une très belle édition, simple mais élégante.
Ecrit en 1988 le bouquin de Dan O’Brien était paru en France en 1991 époque où je l’avais lu pour la première fois dans la collection 10x18, il vient de ressortir chez Au Diable Vauvert dans une très belle édition, simple mais élégante.
L’écrivain est aussi cow-boy et éleveur de bisons, tout en enseignant littérature et écologie, à ce titre il est un spécialiste du Grand Ouest américain. Son livre est dédié à la réintroduction du faucon pèlerin en Amérique du Nord ; en 1965 il ne restait que vingt couples recensés sur le territoire américain et en 1976 ils étaient trois couples dans les Rocheuses. Ce livre n’est pas un roman mais le récit de longs mois d’apprentissage pendant lesquels O’Brien va éduquer une femelle faucon, Dolly, née en captivité, à chasser et vivre seule sa vie d’oiseau de proie. Cette éducation va se poursuivre tout au long d’un périple qui suit les migrations, descendant du Nord des Etats-Unis au golfe du Mexique, où le fauconnier a prévu de lâcher l’oiseau définitivement.
Le livre est un manuel de fauconnerie, une ode à la nature, l’histoire d’une amitié entre l’oiseau et l’écrivain. On y parle de chasse, de chiens, énormément d’oiseaux – un pur régal pour ceux qui aiment ces animaux -, d’amitiés, de solitude choisie, de grands espaces, de liberté et d’Indiens. Mais attention, Dan O’Brien n’est pas un doux rêveur un peu gnangnan qui entretiendrait des liens d’amitié avec ses bêtes comme dans Trente Millions d’Amis, il sait que chaque espèce doit tuer pour manger et que le prédateur de l’une est la victime de l’autre, il sait que les animaux sont faits pour vivre libres.
Un bouquin magnifique, devenu un classique de la littérature écologique pour ne pas dire littérature tout court et dont Jim Harrison un autre grand a dit « De cette œuvre se dégage une dignité à couper le souffle ». A lire absolument.
« Le pèlerin règne sur l’imagination humaine car il est source d’inspiration. Sa beauté est raffinée. Les adultes ont le dos couvert de plumes d’un noir bleuté – chacun possédant un dégradé différent – et le poitrail large d’un blanc saumoné tacheté de noir. J’ai observé Dolly dans son plumage immature sombre, ses pattes d’un jaune virant au bleu, ses longs doigts fins, ses ongles d’ébène. A cet instant, elle a levé une patte pour se gratter le menton avec autant de délicatesse qu’une femme se frotterait le nez à une soirée mondaine. La patte toujours en l’air, elle a tiré délicatement sur la petite sonnette attachée à son tarse. Elle s’est tournée vers moi et ses yeux noirs m’ont transpercé. Si les yeux sont le miroir de l’âme, celle du pèlerin est profonde et majestueuse. »
 Dan O’Brien Rites d’automne Diable Vauvert
Dan O’Brien Rites d’automne Diable Vauvert
15/10/2012 | Lien permanent | Commentaires (1)


