Rechercher : les grands cerfs
Thomas Bernhard : Un Enfant
 Né en 1931 à Heerlen aux Pays-Bas, Thomas Bernhard est le fils d'un cultivateur autrichien. Il fait ses études secondaires à Salzbourg et suit des cours de violon et de chant, puis de musicologie. Son premier recueil de poèmes paraît en 1957, suivi deux ans plus tard d'un livret de ballet. Il écrit des pièces dont plusieurs sont jouées dans de nombreux pays et en France à partir de 1960. Thomas Bernhard a obtenu en 1970 le prix Georg Büchner, la plus importante récompense littéraire d'Allemagne occidentale. Il est mort en 1989 à Gmunden (Autriche). Un Enfant, paru en 1982, vient d’être réédité.
Né en 1931 à Heerlen aux Pays-Bas, Thomas Bernhard est le fils d'un cultivateur autrichien. Il fait ses études secondaires à Salzbourg et suit des cours de violon et de chant, puis de musicologie. Son premier recueil de poèmes paraît en 1957, suivi deux ans plus tard d'un livret de ballet. Il écrit des pièces dont plusieurs sont jouées dans de nombreux pays et en France à partir de 1960. Thomas Bernhard a obtenu en 1970 le prix Georg Büchner, la plus importante récompense littéraire d'Allemagne occidentale. Il est mort en 1989 à Gmunden (Autriche). Un Enfant, paru en 1982, vient d’être réédité.
Récit autobiographique, Un Enfant, retrace l’enfance de l’écrivain quand il avait une dizaine d’années et vient compléter et achever le cycle formé par L'Origine (1975), La Cave (1976), Le Souffle (1978), Le Froid (1981).
Thomas Bernhard nait discrètement aux Pays-Bas d’une mère célibataire qui ne reviendra à Vienne qu’en 1932 pour le confier d'abord à ses grands-parents. L’enfant passe ses premières années dans la campagne près de Salzbourg. L'influence de son grand-père, l'écrivain Johannes Freumbichler, le marquera toute sa vie. Sa mère se marie en 1936 et deux ans plus tard, ils partent vivre en Bavière, mais ce dépaysement ne lui convient pas et ses résultats scolaires deviennent catastrophiques, il vit alors l'école comme un enfer. Ses grands-parents s'installent dans la région en 1939. En 1942, il fait un séjour dans un centre d'éducation national-socialiste pour enfants en Thuringe, où il est maltraité et humilié. Il est placé dans un internat nazi à Salzbourg en 1943, avant de revenir en Bavière, en 1944, à cause des bombardements alliés.
Un bouquin assez court mais écrit sans chapitres, ni paragraphes, ni sauts de lignes, un bloc compact – une caractéristique du style de l’écrivain - qui enfile avec brio, techniquement parlant, les nombreux évènements qui marquent cette tranche de vie racontée sans que la chronologie soit toujours respectée. Quant à l’écriture, si elle est parfaitement maîtrisée, elle s’autorise de très longues phrases parfois assez tarabiscotées, « Egalement à l’écrivain qu’on appelait un écrivain célèbre, qui vivait à Henndorf, nous allâmes rendre visite. »
Le texte ne s’adresse qu’aux fans de l’écrivain, comme souvent (toujours ?) quand il s’agit d’autobiographie. Ceux-ci, ayant une connaissance de l’œuvre de l’auteur, ne seront pas surpris de constater qu’on ne se marre pas beaucoup à le lire, ce n’est pas le genre de la maison ! C’est pourquoi je n’hésite pas à vous signaler ce mince trait d’humour, quasiment une pépite inespérée, « Au petit matin il apparut que j’avais confondu la porte de l’armoire à linge avec la porte des cabinets, les deux ayant été installées presque de façon semblable. » A la décharge de Thomas Bernhard il faut convenir qu’il n’a pas eu une vie facile non plus, entre une mère qui lui voue un amour/haine ponctué de coups de nerf de bœuf quand il fait des âneries (et il s’y entend), les vexations subies parce qu’il vient d’une famille pauvre ou parce qu’il pisse au lit, son jeune âge ne l’empêche pas de penser au suicide. Seules éclaircies, la compagnie du grand-père écrivain et anarchiste et les quelques succès en course à pied qui lui vaudront des honneurs ponctuels. On ne s’étonnera donc pas, plus tard, de trouver dans ses romans et textes, les traces de sa répugnance pour le monde, « l’abominable odeur d’un monde stupide où l’impuissance et la bassesse sont au pouvoir » et son pessimisme rampant.
Un bouquin que nous réserverons à un public très ciblé et concerné, j’en conviens.
« Mon grand-père avait passé en revue devant moi toutes les possibilités de faire s’effondrer le pont. Avec un explosif on peut tout anéantir, à condition qu’on le veuille. En théorie, chaque jour j’anéantis tout, comprends-tu ? disait-il. En théorie il était possible tous les jours et à tout instant désiré d’anéantir tout, de faire s’effondrer, d’effacer de la terre. Cette pensée, il la trouvait grandiose entre toutes. Moi-même je m’appropriai cette pensée et ma vie durant, je joue avec elle. Je tue quand je veux, je fais s’effondrer quand je veux, j’anéantis quand je veux. Mais la théorie est seulement de la théorie, disait mon grand-père, après quoi il allumait sa pipe. »
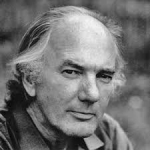 Thomas Bernhard Un Enfant Gallimard L’Imaginaire – 151 pages –
Thomas Bernhard Un Enfant Gallimard L’Imaginaire – 151 pages –
Traduit de l’allemand par Albert Kohn
02/05/2016 | Lien permanent | Commentaires (2)
Henri Bosco : L’Ane Culotte
 Le romancier Henri Bosco est né à Avignon (1888) et mort à Nice (1976). Chantre du Luberon, humaniste, Bosco aime cette montagne magique pour la simple et unique raison que « les hommes depuis la nuit des temps y ont vécu et souffert ». Ses romans constituent une évocation sensible de la vie provençale où son imagination débordante participe au pouvoir envoûtant de son écriture.
Le romancier Henri Bosco est né à Avignon (1888) et mort à Nice (1976). Chantre du Luberon, humaniste, Bosco aime cette montagne magique pour la simple et unique raison que « les hommes depuis la nuit des temps y ont vécu et souffert ». Ses romans constituent une évocation sensible de la vie provençale où son imagination débordante participe au pouvoir envoûtant de son écriture.
Une fois encore je dois faire mon mea culpa, j’avais toujours pensé que L’Ane Culotte (écrit en 1937) était un roman pour la jeunesse (en raison de son titre) et comme c’était l’un des plus connu de Bosco, j’avais ignoré cet écrivain. Pauvre de moi ! Autant dire que j’ai du pain sur la planche pour rattraper mon retard, au vu de l’œuvre considérable de ce très grand écrivain, couronné du Renaudot pour Le Mas Théotime (1945) entre autres distinctions.
Dans un petit village de Provence, un enfant, Constantin Gloriot, est fasciné par un âne étrange, l'âne Culotte, nommé ainsi parce qu'il porte des pantalons, « À vrai dire, ces pantalons ne recouvraient que ses deux pattes antérieures ». Un jour, Constantin désobéit et suit l'âne jusqu'à sa destination dans la montagne, au cœur d'un domaine secret Belles-Tuiles, où les animaux sauvages vivent sans crainte auprès d'un vieil homme mystérieux, Mr Cyprien.
On ne sait pas grand-chose de cet homme au village où il ne descend jamais, préférant y envoyer son âne pour qu’il en ramène quelques provisions. Seul le curé, l’abbé Chichambre, semble en savoir un peu sur la vie passée de cet étrange paroissien. Inexorablement attiré par ces lieux étranges, Constantin, gamin d’une dizaine d’années, va être entraîné dans une aventure dépassant son entendement.
Mr Cyprien, à l’aide de pouvoirs secrets, a recréé un petit Paradis terrestre autour de son mas. Les plantes et les arbres poussent à foison, les animaux y vivent en harmonie, la paix règne sur ce bout de montagne isolée. Le secret Mr Cyprien, très âgé, a repéré le jeune Constantin au cœur pur, il envisage de lui transmettre ses pouvoirs afin qu’il continue son œuvre. Mais ce nouveau Paradis n’échappera pas à la malédiction du premier, poussé contre son gré par une gamine du village, Constantin y dérobe une branche d’amandier…
J’aurais pu évoquer, grand-mère Saturnine qui régente la maisonnée, La Péguinotte domestique ronchon mais au grand cœur, Anselme le berger, Hyacinthe la petite souillon au rôle mystérieux, les gitans qui campent à proximité du village, tous ces personnages attachants qui peuplent le roman, mais je préfère vous en laisser la découverte.
Je sors de la lecture de ce très beau livre, estomaqué, tant je suis tombé sous le charme de cet écrivain. Tout y est magnifique, la description de la région nous restitue merveilleusement les sensations éprouvées quand on y a séjourné, le chaud soleil, les odeurs de la terre et des plantes, le bruit du vent dans les arbres, le chant des oiseaux. Sur cette terre de lumière, Henri Bosco réussit néanmoins à construire un roman de l’ombre, très vite le mystère plane puis l’étrange nous prend et ne nous lâchera plus. L’écriture est dense, le roman pas si long, on ne peut l’abandonner, on écarquille les yeux à suivre cette aventure merveilleuse qui mêle l’innocence de l’enfance, la sagesse des anciens, le mythe du paradis perdu et les diableries comme on les craint dans les provinces.
A propos de l’oeuvre de Henri Bosco, Raymond Dumay écrivait « Elle ne doit rien à l’école dite américaine qui fait d’un reportage un roman, mais elle nous rappelle l’existence de cette source cachée : l’âme ».
« Noir-Asile, malgré son air de solitude, m’attirait, tant par le secret de son site caché derrière d’énormes buissons de genêts d’or, que par je ne sais quel charme encore humain. Resté seul dans le grand jardin, je ne tardai pas à sentir l’attrait de cette cabane de chiens qui, pendant si longtemps, avait abrité les mystérieux conciliabules d’Hyacinthe avec elle-même. Après l’étrange, l’inoubliable Belles-Tuiles, c’était pour moi l’un des plus graves habitats de l’enfance. J’y revenais plus souvent, et je m’y attardais des heures entières, sans pourtant y entrer. Mais, adossé à ses parois de planches, assis dans l’herbe sèche qui sentait le feu de l’été, j’y reprenais peu à peu avec la terre tiède ce contact de plaisir et d’angoisse dont le souvenir, depuis lors, n’a cessé de troubler ma vie. Car j’aime la terre. »

09/10/2012 | Lien permanent
Ernest Hemingway : Le Vieil homme et la mer
 Ernest Miller Hemingway (1899-1961) est un écrivain, journaliste et correspondant de guerre américain. Il a écrit la plupart de ses œuvres entre le milieu des années 1920 et le milieu des années 1950, et sa carrière a culminé en 1954 lorsqu'il a remporté le prix Nobel de littérature, attribué « pour le style puissant et nouveau par lequel il maîtrise l'art de la narration moderne, comme vient de le prouver Le Vieil Homme et la Mer ». Hemingway est l'un des représentants les plus typiques de ce que l'on a appelé, aux États-Unis, la « génération perdue » dont les principaux écrivains de cette génération sont, outre Hemingway, Ezra Pound, T.S. Eliot et Gertrude Stein. Son roman, Le Vieil homme et la mer, est paru en 1952 et lui vaudra aussi le prix Pulitzer.
Ernest Miller Hemingway (1899-1961) est un écrivain, journaliste et correspondant de guerre américain. Il a écrit la plupart de ses œuvres entre le milieu des années 1920 et le milieu des années 1950, et sa carrière a culminé en 1954 lorsqu'il a remporté le prix Nobel de littérature, attribué « pour le style puissant et nouveau par lequel il maîtrise l'art de la narration moderne, comme vient de le prouver Le Vieil Homme et la Mer ». Hemingway est l'un des représentants les plus typiques de ce que l'on a appelé, aux États-Unis, la « génération perdue » dont les principaux écrivains de cette génération sont, outre Hemingway, Ezra Pound, T.S. Eliot et Gertrude Stein. Son roman, Le Vieil homme et la mer, est paru en 1952 et lui vaudra aussi le prix Pulitzer.
A Cuba, non loin de La Havane, Santiago est un vieux pêcheur, veuf et pauvre, qui n’a rien ramené dans ses filets depuis quatre-vingt-quatre jours. Un gamin qui l’appelle grand-père, l’accompagnait dans ses sorties en mer jusqu’à aujourd’hui, jusqu’à ce que ses parents le place chez un autre pêcheur jugé plus capable et lui permettant de rapporter quelques poissons au logis familial.
Le gosse est désolé, « C’est papa qui m’a fait partir. Je suis pas assez grand. Faut que j’obéisse, tu comprends », car il a beaucoup d’affection pour le vieil homme qui lui apprend la pêche.
Quand Santiago part à nouveau en mer, il se sent seul et vieux, et cette partie de pêche il le devine sera son grand coup ou bien sa fin. Un énorme espadon se prend à sa ligne, « Certains pesaient jusqu’à cinq cents kilos. (…) et le voilà accroché à la plus grosse pièce qu’il ait jamais trouvée. » Ragaillardi par cet heureux coup du sort, Santiago imagine le bénéfice qu’il va tirer de cette prise et la consolation morale de se savoir toujours le bon pêcheur que tous reconnaitront.
S’engage alors un combat héroïque, une de ces histoires de pêche au gros grandiose, comme on aime les conter dans les tavernes de tous les ports du monde. L’homme seul, arc-bouté au fond de son canot, tenant ses lignes, et le poisson gigantesque qui entraîne le tout vers le large. On ne peut s’éviter de penser au Moby Dick d’Herman Melville bien évidemment. Le vieux va en baver, car l’espadon va résister plusieurs jours, mais épuisé par ses efforts et attiré vers le bateau par le pêcheur, le poisson sera harponné et tué.
Le vieil homme semble récompensé de son acharnement et l’on espère que l’aventure est terminée pour lui, mais la vie n’est pas un long fleuve tranquille. « Une heure plus tard, le premier requin attaqua. » Dès lors, une course poursuite va s’engager entre l’homme riche de son gros butin filant vers la terre et les pillards à ailerons toutes dents dehors. « Le vieux compris que tout était fini. »
Si le bouquin venait de paraître, je tairais la fin, mais ce classique de la littérature est connu de tous et a fait l’objet d’un très beau film réalisé en 1958 par John Sturges avec Spencer Tracy dans le rôle du pêcheur.
J’ai dit classique et c’est vrai qu’il s’agit d’un livre immense. Plutôt mince en pagination, mais tellement riche en symboles et paraboles, la victoire dans la défaite, un thème cher à Hemingway. Si Santiago échoue complètement dans sa pêche, ne rapportant au port que la tête et l’arrête dorsale de l’espadon, ne pouvant donc rien en vendre sur le marché, en tant qu’homme il sort vainqueur de cette épreuve, par son colossal effort face à l’adversité, « Un homme, ça peut être détruit, mais pas vaincu. » Ne jamais s’avouer défait, la grande leçon de ce livre.
Il faudrait aussi s’attarder sur le style, des mots simples au service de thèmes grandioses comme la dignité, le respect, la nature toute puissante etc. Cette excellente idée de l’écrivain, faire soliloquer le pêcheur seul en mer pour rendre plus vivant le récit dans ce genre de huis-clos au milieu de l’océan. Suivre l’évolution des pensées du vieil homme, d’abord il capture un poisson qui n’est sensé qu’être un revenu pour lui et de quoi nourrir de nombreux pauvres gens, avant de témoigner d’un grand respect pour cette bête et son combat qui la met à égalité avec l’homme, au point d’en conclure « Y a personne qui mérite de le manger, digne et courageux comme il est, ce poisson-là. »
Jacques-Fernand Cahen dans La Littérature américaine, résume ainsi le roman, « cette fable si savamment composée, si parfaitement écrite, si riche en profonds symboles et d’une si passionnante lecture qu’elle enthousiasme aussi bien les enfants que les esprits les plus blasés. »
On ne saurait mieux dire et si vous ne deviez emporter qu’un seul livre sur une île déserte, c’est bien celui-là !
« Un ouragan, cela se flaire de loin. Si l’on est en mer, on peut observer les signes dans le ciel plusieurs jours à l’avance. « Les gens de la terre ne comprennent rien au ciel, pensait le vieux ; ils le regardent pas comme il faut. Sans compter que les nuages ça n’a pas la même forme vus de la terre ferme. En tout cas, y a pas d’ouragan en route pour le quart d’heure. »
 Ernest Hemingway Le Vieil homme et la mer Folio
Ernest Hemingway Le Vieil homme et la mer Folio
13/11/2012 | Lien permanent
Jean-Paul Dubois : La Succession
 Jean-Paul Dubois, né en 1950 à Toulouse, est un écrivain français. Il a suivi des études de sociologie avant d’être journaliste au service des sports de Sud Ouest, au Matin de Paris, puis grand reporter au Nouvel Observateur. Jean-Paul Dubois a publié une quinzaine de romans, un essai, deux recueils de nouvelles et deux recueils d'articles. La Succession son tout nouveau roman vient de paraître.
Jean-Paul Dubois, né en 1950 à Toulouse, est un écrivain français. Il a suivi des études de sociologie avant d’être journaliste au service des sports de Sud Ouest, au Matin de Paris, puis grand reporter au Nouvel Observateur. Jean-Paul Dubois a publié une quinzaine de romans, un essai, deux recueils de nouvelles et deux recueils d'articles. La Succession son tout nouveau roman vient de paraître.
Paul Katrakilis, le narrateur, vit à Miami depuis plusieurs années, depuis qu’il a rompu tout lien avec son père, médecin à Toulouse, dernier membre de sa famille. Il s’est fait une place dans le monde des joueurs professionnels de pelote basque, sa passion et son métier, après avoir abandonné la médecine, cause de son désaccord avec son géniteur. Il vit en Floride une sorte de bonheur, qu’on devine très vite fragile.
Ah ! Ces familles ! Que n’en disent pas les écrivains ! Il faut aussi admettre que chez les Katrakilis, c’est un peu spécial outre le fait que le petit Paul semblait être la cinquième roue du carrosse. Tout le monde vivait dans la grande demeure de Toulouse, le grand-père, le père et la mère de Paul, et le frère de la mère. Le grand-père, Spyridon Katrakilis, un ancien médecin de Staline, se serait enfui d'URSS avec dans ses bagages une lamelle du cerveau du petit père des peuples, ce qui nous vaut un savoureux chapitre sur l’autopsie de Staline ! Il y a aussi l'oncle Jules, et la mère, Anna, qui ont vécu comme mari et femme dans la maison familiale, heu… ? Quant à Adrian Katrakilis, le père, Paul vient d’apprendre son décès et il doit rentrer en France pour s’occuper de la succession. Notons aussi que toutes ces personnes sont décédées par suicide ! Une malédiction familiale ?
Au moins, la couverture du livre ne trompe pas sur son contenu : le titre dit bien de quoi il est question et la photo fait la part belle au jeu de pelote basque. Si vous n’êtes pas familiers de ce sport et de ces « types aux mains d’osier » vous allez pouvoir combler cette lacune, rien ne vous sera caché (épargné ?) de sa pratique à Miami, des people ou des vulgaires qui parient sur les matches, des grandes grèves historiques qui opposèrent les joueurs aux organisateurs… Mais après tout, on n’en sait jamais assez. Je m’attarde sur cet angle du roman, car c’est une composante de l’écriture de Jean-Paul Dubois, il digresse (beaucoup ?), on s’étonne souvent de voir la large place donnée à certains évènements apparemment mineurs au détriment d’autres plus forts en émotions ou développements qui pousseraient à la réflexion ; et pourtant, ces sensations de lecture en cours aboutissent, in fine, à donner du corps (et du cœur) à l’ouvrage. Jean-Paul est de ce bois d’écrivains qui par petites touches discrètes vous tissent des décors crédibles et des personnages ordinaires cachant des aspects peu ordinaires.
Paul aura donc une triste vie, ponctuée de petits moments de bonheur : son copain de pelote à Miami, un chien sauvé des eaux, une Norvégienne beaucoup plus âgée que lui ; par ailleurs, sa découverte dans les papiers de son père, de deux carnets Moleskine, lui fera reconsidérer ce père qu’il avait toujours vu comme « un bloc massif d’indifférence ». Il reprendra même durant plusieurs années, l’activité de médecin en rouvrant le cabinet du père. Mais tout roman a une fin et chez les Katrakilis elle est connue d’avance.
Un joli roman, sans esbroufe dans l’écriture ou les sujets abordés. Il y est beaucoup question de mort, de celle que l’on se choisit, de celle que certains peuvent donner à d’autres pour les soulager de leur souffrance extrême. Jean-Paul Dubois est un élégant, dans l’écriture comme dans les sentiments qui se dégagent de son ouvrage doux amère, ce que les habitués de l’auteur ne seront pas étonnés de retrouver ici.
« Enfant, je grandis donc devant Spyridon qui marinait devant sa tranche de cervelet, un père court vêtu vivant comme un célibataire, et une mère quasiment mariée à son propre frère qui aimait dormir contre sa sœur et devant les litanies de la télévision. Je ne savais pas ce que je faisais parmi ces gens-là et visiblement, eux non plus. (…) Le plus étrange, c’est que la mort traversa à plusieurs reprises notre maison et les survivants s’en aperçurent à peine, la regardant passer comme une vague femme de ménage. »
 Jean Paul Dubois La Succession Editions de l’Olivier – 234 pages –
Jean Paul Dubois La Succession Editions de l’Olivier – 234 pages –
« Sur l’enveloppe je reconnus aussitôt la graphie de mon père. A l’intérieur, deux photos. Sur la première, son cabriolet Triumph Vitesse MK2 de 1969 vu de côté. Sur la seconde, un cliché très net en plan rapproché de son compteur kilométrique, en fait des miles, où l’on lisait « 77777 ». Rien d’autre. Pas le moindre mot. » (p.22)

29/08/2016 | Lien permanent | Commentaires (2)
Howard Fast : La Dernière frontière
 Howard Fast (1914-2003) est un romancier et scénariste américain. Il a également signé des romans policiers sous le pseudonyme de E.V. Cunningham. Howard Fast s'intéresse très tôt à la pensée de Karl Marx et devient membre d'une association d'écrivains proche du Parti communiste américain. Un voyage dans le Sud des Etats-Unis lui permet de constater la grande pauvreté résultant de la Grande Dépression et lui confirme le bien-fondé de son engagement politique. En 1974, Howard Fast s'installe en Californie où il collabore avec le milieu de la télévision par l'écriture de scénarios et vivra de sa plume jusqu'à sa mort en 2003. Passionné par l'histoire américaine, il utilisera ce matériau dans de nombreux romans dont La Dernière Frontière qui sera publié en 1941.
Howard Fast (1914-2003) est un romancier et scénariste américain. Il a également signé des romans policiers sous le pseudonyme de E.V. Cunningham. Howard Fast s'intéresse très tôt à la pensée de Karl Marx et devient membre d'une association d'écrivains proche du Parti communiste américain. Un voyage dans le Sud des Etats-Unis lui permet de constater la grande pauvreté résultant de la Grande Dépression et lui confirme le bien-fondé de son engagement politique. En 1974, Howard Fast s'installe en Californie où il collabore avec le milieu de la télévision par l'écriture de scénarios et vivra de sa plume jusqu'à sa mort en 2003. Passionné par l'histoire américaine, il utilisera ce matériau dans de nombreux romans dont La Dernière Frontière qui sera publié en 1941.
1878. Les Cheyennes sont chassés des Grandes Plaines et parqués en Territoire indien, aujourd’hui l'Oklahoma. Sur ces terres hostiles où règnent poussière et chaleur torride, les Cheyennes assistent à l'extinction programmée de leur peuple. Jusqu'à ce que trois cents d'entre eux, hommes, femmes, enfants, menés par leur vieux chef Little Wolf, décident de s'enfuir pour retrouver leur terre sacrée des Black Hills dans le Wyoming. Un périple fou, de près de mille-six-cents kilomètres durant plusieurs mois, de l’Oklahoma en passant par le Kansas et le Nebraska, du soleil de plomb aux températures polaires, avec à leurs trousses douze-milles hommes de l’armée et de la milice civile…
Roman, mais récit tiré d’une histoire bien réelle, issue de sources avérées, ce bouquin - ce très grand livre - est depuis bien longtemps devenu un classique de la « question Indienne » : L'arrivée des Européens en Amérique du Nord à partir du XVIème siècle provoqua d'importantes conséquences sur les Amérindiens. Leur nombre s'effondra à cause des maladies, des guerres et des mauvais traitements, leur mode de vie et leur culture subirent des mutations. Avec l'avancée de la Frontière (la ligne marquant la zone limite de l'implantation des populations d'origine européenne dans le contexte de la conquête de l'Ouest, c’est l'un des concepts historiques majeurs des Etats-Unis) et la colonisation des Blancs américains, ils perdirent la majorité de leur territoire, furent contraints d'intégrer des réserves. J’ai lu beaucoup de livres, romans ou non, sur le sort dramatique des peuples Amérindiens, celui-ci est l’un des meilleurs d’autant qu’il bénéficie, par rapport à d’autres, de son antériorité, un temps où il n’était pas de bon ton de la ramener sur ce sujet.
Que dire à ceux qui ne l’ont pas encore lu pour qu’ils s’y précipitent ? Sur la forme, on peut parler de western : une poignée d’Indiens quitte sa réserve sans autorisation, déclarant clairement qu’ils préfèrent retourner sur la terre de leurs ancêtres à leurs risques et périls, plutôt que crever en silence, de chaleur et de faim, ici en Oklahoma. L’armée envoie quelques hommes pour les rattraper, n’y arrive pas, gonfle ses effectifs, toujours en vain. Escarmouches, morts, climat épouvantable, squelettes ambulants, la tribu persévère dans sa remontée vers le Nord et la troupe des armées n’y peut rien. La force ridiculisée par la ruse opiniâtre de ceux qui n’ont rien à perdre, ceux qui sont déjà quasi morts.
Howard Fast ne laisse guère de place à la sentimentalité, l’extraordinaire puissance de sa prose simple suffit pour terrasser le lecteur. On sent que l’écrivain s’attache à raconter les faits, la vérité crue et insoutenable. Les dialogues sont la seule part romancée de l’affaire. Mêmes les tourments psychologiques des hommes en bleu semblent justes et réels. Tous les officiers ne réagissent pas de la même façon face à la situation, pour certains « un bon Indien est un Indien mort », pour d’autres la cruauté de la poursuite les trouble : d’un côté leur uniforme leur dicte de faire respecter la loi et les règlements mais de l’autre, ils ont bien conscience que les Indiens agissent pour une juste cause…
On a parlé de la forme, quant au fond, il y est question de liberté ou d’esclavage, de mourir libre ou de vivre sous le joug et dans quelles conditions atroces. Et plus largement, d’aborder ce débat intemporel, le sort réservé aux minorités, « pourquoi un groupe minoritaire dans notre République ne peut-il légalement occuper le pays qu’il a habité pendant des siècles ? »
Un roman qui prend aux tripes et laisse le lecteur k.o. les larmes aux yeux, je n’ai pas honte de l’avouer.
« Le vieux chef laissa lentement retomber ses mains. Son visage couleur de terre se creusa d’un sourire mi de pitié, mi de regret. Nu jusqu’à la ceinture, sans armes, il se présentait à cheval devant l’impartial jugement de l’Histoire. Il appartenait au passé, à un passé mort qui ne revivrait jamais plus, et il le savait. Deux siècles de guerres cruelles et sanguinaires entre Peaux-Rouges et Blancs atteignaient, semblait-il, leur point culminant dans ce face-à-face des deux antagonistes : le capitaine Murray, vêtu de la poussiéreuse tenue bleue, et le vieux chef cheyenne, à demi nu. Pourtant Murray n’éprouvait rien d’autre qu’une sombre colère – colère qui englobait sa propre personne, Little Wolf, ses hommes et toutes les forces qui l’avaient conduit pendant ces deux jours de poursuite folle. »
 Howard Fast La Dernière frontière Gallmeister Totem – 269 pages-
Howard Fast La Dernière frontière Gallmeister Totem – 269 pages-
Traduit de l’américain par Catherine de Palaminy
On trouve une photo du chef Little Wolf en page 52 du magnifique ouvrage Pieds nus sur la terre sacrée de T.C. McLuan (textes) et Edward S. Curtis (photos) paru chez Denoël (1974). Un autre livre incontournable sur ce sujet.
Et pour information : « Little Wolf deviendra plus tard un scout pour l'armée américaine sous le général Nelson Miles. Il est impliqué dans une discussion mouvementée sur une de ses filles, qui aboutit à la mort de Starving Elk. Prétendument, Little Wolf était intoxiqué quand il le tua au Poste de Commerce d'Eugenie Lamphere le 12 décembre 1880. Little Wolf entame alors un exil volontaire à la suite de ce déshonneur. Il finit sa vie à la réserve des Cheyennes du Nord où il meurt en 1904. George Bird Grinnell, un ami proche et ethnographe qui a documenté la vie de Little Wolf, a dit de lui qu'il était « le plus grand Indien qu'il ait jamais connu » ».
06/04/2020 | Lien permanent | Commentaires (4)
Jules Verne : Paris au XXe siècle
 Jules Verne (Jules-Gabriel Verne de son nom exact), né en 1828 à Nantes et mort en 1905 à Amiens, est un écrivain français dont les livres sont, pour la plus grande partie, constituée de romans d'aventures utilisant les progrès scientifiques propres au XIXe siècle. En 1863 paraît chez l'éditeur Pierre-Jules Hetzel son premier roman, Cinq semaines en ballon, qui connaît un très grand succès y compris à l'étranger. Jules Verne nous a légué une œuvre immense, plusieurs dizaines de romans dont quelques chefs-d’œuvre comme Vingt mille lieues sous les mers (1870) pour n’en citer qu’un et mon préféré. Populaire dans le monde entier, il vient au deuxième rang des auteurs les plus traduits en langue étrangère après Agatha Christie.
Jules Verne (Jules-Gabriel Verne de son nom exact), né en 1828 à Nantes et mort en 1905 à Amiens, est un écrivain français dont les livres sont, pour la plus grande partie, constituée de romans d'aventures utilisant les progrès scientifiques propres au XIXe siècle. En 1863 paraît chez l'éditeur Pierre-Jules Hetzel son premier roman, Cinq semaines en ballon, qui connaît un très grand succès y compris à l'étranger. Jules Verne nous a légué une œuvre immense, plusieurs dizaines de romans dont quelques chefs-d’œuvre comme Vingt mille lieues sous les mers (1870) pour n’en citer qu’un et mon préféré. Populaire dans le monde entier, il vient au deuxième rang des auteurs les plus traduits en langue étrangère après Agatha Christie.
Paris au XXe siècle est un roman d'anticipation écrit probablement en 1860 mais paru seulement en 1994, à titre posthume, car refusé par son éditeur sous prétexte qu'il nuirait à la réputation de l'auteur en devenir « On ne croira pas aujourd'hui à vos prophéties. » On lira à ce sujet, avec beaucoup d’intérêt, la préface de Piero Gondolo Della Riva, le grand spécialiste italien de Verne, sur l’histoire et la découverte du manuscrit.
Paris en 1960. Un Paris futuriste, inventé/imaginé par Jules Verne, une métropole splendide autant que délirante, symbolique d’un monde où la Finance et la Technique règnent en maîtres. La capitale est désormais reliée à la mer par un canal, on se déplace grâce à des métros propulsés à l'air comprimé ou bien en voitures à hydrogène, on utilise des machines qui semblent être nos futures photocopieuses et surtout, la fée Electricité est partout présente. Un avenir qui serait fascinant s’il n’avait sa contrepartie négative : l’Etat régente tout et s’évertue à rayer des connaissances et des mémoires, les arts et la littérature. Seuls, quelques pauvres fous, comme le jeune Michel, héros du roman, tentent contre vents et marées de faire survivre poésie ou musique. Une marginalité qui les voue à la plus grande misère et à la faim. Un combat désespéré…
Autant le dire tout de suite, ce n’est pas du grand Jules Verne si on s’arrête au simple plaisir de la lecture, d’autant que la fin n’est pas terrible. Par contre, si on considère ce roman comme un document, il ne manque pas d’intérêt. Souvent on nous présente l’écrivain comme un fou de modernité, voyant dans le progrès la clé du succès pour un monde meilleur, ici il n’en est rien ! Au contraire même, et son héros en fera la cruelle expérience. Sa vision critique de la société ne manque pas non plus de pertinence divinatoire, « la Parisienne, sa tournure gracieuse, son regard spirituel et tendre, son aimable sourire (…) firent bientôt place à des formes longues, maigres, arides, décharnées, émaciées… » on croirait qu’il nous parle des anorexiques du mannequinat d’aujourd’hui ? A moins qu’il n’envisage la fin du mariage, « à une époque où la famille tend à se détruire, où l’intérêt privé pousse chacun de ses membres dans des voies diverses (…) le mariage me paraît une héroïque inutilité. » Bref, la plume de Verne trempe dans un pessimisme sombre, tempéré de temps à autre, de répliques ne manquant pas d’humour, « - Est-ce qu’il n’était pas athée ? – Pas du tout ; il croyait en lui. »
Quant à l’écriture de Verne, elle préfigure ce qui en fera sa marque de fabrique, des précisions techniques en veux-tu, en voilà, et ses sempiternelles listes d’exemples quand il veut étayer son propos.
Si vous êtes encore trop jeunes pour n’avoir pas encore eu le temps de lire un roman de Jules Verne, ne commencez pas par celui-ci ! Les autres, et ils sont nombreux, y jetteront un œil attentif, comme un documentaire sur l’écrivain.
« Monsieur, vous allez entendre des paroles que je vous prie de graver dans votre mémoire. Votre père était un artiste. Ce mot dit tout. J’aime à penser que vous n’avez pas hérité de ses malheureux instincts. Cependant j’ai découvert en vous des germes qu’il importe de détruire. Vous nagez volontiers dans les sables de l’idéal et, jusqu’ici, le résultat le plus clair de vos efforts a été ce prix de vers latins, que vous avez honteusement remporté hier. Chiffrons la situation. Vous êtes sans fortune, ce qui est une maladresse ; un peu plus, vous étiez sans parents. Or, je ne veux pas de poètes dans ma famille, entendez-vous bien ! Je ne veux pas de ces individus qui viennent cracher des rimes à la face des gens ; vous avez une famille riche ; ne la compromettez pas. (…) Vous m’entendez. Pas de talent. Des capacités. »
 Jules Verne Paris au XXe siècle Le Livre de Poche – 183 pages –
Jules Verne Paris au XXe siècle Le Livre de Poche – 183 pages –
27/12/2017 | Lien permanent | Commentaires (2)
William Trevor : Les Enfants de Dynmouth
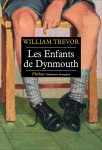 Sir William Trevor de son vrai nom William Trevor Cox est né en 1928 dans le comté de Cork en Irlande. Romancier, nouvelliste, dramaturge et scénariste, lauréat de nombreux prix littéraires aussi bien en Irlande qu'en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, membre de l'Académie irlandaise, il a été anobli par la reine Élisabeth II d'Angleterre. Les Enfants de Dynmouth, date de 1976, il vient tout juste d’être traduit en français.
Sir William Trevor de son vrai nom William Trevor Cox est né en 1928 dans le comté de Cork en Irlande. Romancier, nouvelliste, dramaturge et scénariste, lauréat de nombreux prix littéraires aussi bien en Irlande qu'en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, membre de l'Académie irlandaise, il a été anobli par la reine Élisabeth II d'Angleterre. Les Enfants de Dynmouth, date de 1976, il vient tout juste d’être traduit en français.
Dynmouth est une charmante petite ville du Dorset, en bord de mer, « avec ses salons de thé et ses dentelles », typique de cette Angleterre où évolueraient bien volontiers les personnages d’Agatha Christie ou bien l’inspecteur Barnaby (série diffusée sur France3), paisible pour les uns, un peu ennuyeuse pour d’autres. Alors que la kermesse de Pâques approche, le train-train quotidien de certains de ses habitants va être troublé par un jeune garçon de quinze ans, Timothy Gedge. Le père est parti depuis bien longtemps, sa mère et sa grande-sœur absorbées par leurs vies assez libres le laissent pousser tout seul. Le gamin s’étant mis en tête de présenter un sketch pendant la kermesse, s’adresse aux uns et aux autres afin d’obtenir les accessoires qui lui sont nécessaires pour son spectacle, un costume d’homme, une robe de mariée, une vieille baignoire et un rideau de scène. Timothy sait très bien à qui il doit présenter ses requêtes car il a depuis longtemps l’habitude d’épier les gens par leurs fenêtres et d’entrer chez eux sous prétexte de menus travaux contre de l’argent de poche. Si ses demandes sont prises à la légère dans un premier temps, elles rencontrent un autre écho quand Timothy Gedge commencent à divulguer ce qui ressemble à des secrets bien gardés, le capitaine Abigail serait attiré par les jeunes garçons, Mr Plant se paye du bon temps avec des femmes du village, le père de Stephen aurait tué son épouse pour se remarier.
Tout le charme du roman réside dans l’écriture de William Trevor, ce qui n’est plus une surprise pour moi depuis que j’ai lu Cet été là, une pure merveille. Délicatesse, finesse et retenue, l’écrivain tisse des décors de sérénité, puis petit à petit, par petites touches, les propos de Timothy sont autant de graines du doute, poison mortel qui va lever dans les esprits des personnages comme du lecteur. Le gamin est un peu « spécial », ses propos tombent comme cheveux sur la soupe souvent, son aplomb pour s’incruster chez les gens exaspère, puis le harcèlement envers ses « victimes » devient franchement crispant. Le lecteur se prend à s’agacer de ces adultes manquant de clairvoyance et d’autorité.
William Trevor enfonce le coin profondément, Timothy est un catalyseur au sein de ce microcosme, allégations mensongères, interprétation erronée de faits avérés ou turpitudes réelles ? Le manque de communication entre les acteurs, les silences coupables, profitent à la gangrène du mal et si tous cèderont aux exigences du gamin, ce sera pour de mauvaises raisons.
Excellent roman. Très belle analyse psychologique de caractères, toute en finesse, et d’un gamin ni dieu, ni diable, mais terriblement seul et livré à lui-même au sein d’une société banale, présentant tous les signes de la respectabilité tranquille.
« Timothy Gedge avait une quinzaine d’années, il était en plein dans cet âge dit ingrat, le visage carré, anguleux, les épaules maigres, les cheveux courts presque blancs, un regard vorace qui lui donnait l’air prédateur, les joues creuses. Il portait toujours les mêmes vêtements : un jean jaune pâle, un blouson jaune à fermeture éclair et, la plupart du temps, un tee-shirt jaune lui aussi. Il vivait avec sa mère et sa sœur, Rose-Ann, dans un lotissement social appelé « Cornerway ». Inscrit au lycée de Dynmouth, ce n’était pas un élève particulièrement brillant. Il adorait jouer des tours, une habitude qui le faisait parfois paraître excentrique. Il riait souvent, d’un grand sourire jusqu’aux oreilles. »
 William Trevor Les Enfants de Dynmouth Phébus – 237 pages –
William Trevor Les Enfants de Dynmouth Phébus – 237 pages –
Traduit de l’anglais (Irlande) par Marie-Odile Fortier-Masek
23/06/2014 | Lien permanent
Steve Stern : La Fabuleuse histoire du clan Kabakoff
 Steve Stern est un écrivain américain né en 1947 à Memphis (Tennessee). Après avoir suivi des ateliers d’écriture à l’Université de l’Arkansas, il s'est installé dans une communauté hippie dans le Missouri puis est parti vivre à Londres. De retour à Memphis, il se consacre à l’étude de la culture yiddish qui deviendra sa principale source d’inspiration. Il publie en 1983 son premier roman suivi d’autres, primés aux Etats-Unis. Il est aujourd’hui professeur d’anglais à Saratoga Springs (Etat de New York). Le Rabbin congelé publié en 2012 est le premier livre de Steve Stern traduit en français. Son roman, La Fabuleuse histoire du clan Kabakoff, tiré d’un recueil (A Plague of Dreamers) datant de 1994 vient de paraître chez nous.
Steve Stern est un écrivain américain né en 1947 à Memphis (Tennessee). Après avoir suivi des ateliers d’écriture à l’Université de l’Arkansas, il s'est installé dans une communauté hippie dans le Missouri puis est parti vivre à Londres. De retour à Memphis, il se consacre à l’étude de la culture yiddish qui deviendra sa principale source d’inspiration. Il publie en 1983 son premier roman suivi d’autres, primés aux Etats-Unis. Il est aujourd’hui professeur d’anglais à Saratoga Springs (Etat de New York). Le Rabbin congelé publié en 2012 est le premier livre de Steve Stern traduit en français. Son roman, La Fabuleuse histoire du clan Kabakoff, tiré d’un recueil (A Plague of Dreamers) datant de 1994 vient de paraître chez nous.
Chronique d’une famille juive de Memphis, La Fabuleuse histoire du clan Kabakoff, s’étale sur trois générations entre la fin du XIXème siècle et 1968. Il y a Yankel, le grand-père venu d’Ukraine s’installer aux Etats-Unis, toujours plongé dans ses livres et la Torah, laissant sa femme Tillie s’occuper du Grand Bazar Kabakoff, une boutique vieillotte « où Tillie jouait autant le rôle de patronne que celui de conservatrice de musée » vendant tout et n’importe quoi. Le père, Mose, lui est un entrepreneur actif sachant faire fructifier une affaire et puis il y a son fils Itchy, laid mais séducteur, sorte de vilain petit canard de la famille, qui s’en exclura pour devenir membre d’une troupe de cirque ambulant comme dans le film Freaks (Tod Browning 1932).
Steve Stern a beau se démener, j’ai eu du mal à m’intéresser à cette saga emberlificotée racontée à rebrousse-temps, partant du petit-fils pour remonter à l’époque du grand-père. Les personnages ne manquent pas, outre ceux cités, et le reste de la famille ne manque pas de couleurs, les oncles Joseph et Enoch, la tante Lailah, comme les membres de la troupe de monstres, réels ou prétendus, travaillant pour le cirque. Ajoutez-y une légère dose de fantastique avec des personnages dont les silhouettes deviennent floues jusqu’à disparaitre (on pense à Harry dans tous ses états de Woody Allen) ou bien Lailah finissant par se plaindre à Itchy, « tu crois vraiment que c’est un métier pour une goule ? »
Si ce roman ne m’a pas accroché, la raison en est je pense, au fait qu’il me manque certainement des clés. Tout du long de ma lecture, j’ai eu l’intuition que l’écrivain utilisait tout un matériau provenant de sa culture yiddish, fait de textes religieux et de légendes, dont il exploitait les thèmes à sa sauce pour en faire son roman. De plus, l’abus de mots yiddish expliqués par des notes en bas de page, m’a paru lourd et inopportun dans la majorité des cas.
Une fois encore - mais combien de roman tombent dans ce travers ? – je déplore le commentaire de quatrième de couverture annonçant « une aussi phénoménale drôlerie ». Certes Steve Stern penche plus du côté de Woody Allen que de la Shoah, mais de là à en exagérer le mince sourire qui parfois m’est venu aux lèvres, il y a un fossé.
Seule la dernière partie du roman, en gros les cinquante dernières pages, a éveillé mon intérêt quand la parabole se révèle, une histoire en boucle où Mose le père, revient au foyer en 1968 tout comme Itchy, son fils l’avait fait quatre ans plus tôt. Un livre comme un palimpseste, où l’Histoire s’écrit sur l’effacement du texte écrit précédemment.
« Au bout du compte, tous les livres qu’il connaissait par cœur étaient devenus dans l’esprit de Yankel un seul et unique Livre, contenant toutes les histoires y compris la sienne. Et il aimait se dire que le Livre portait pour lui le fardeau du souvenir ; cela lui permettait de se sentir plus libre et de ne pas percevoir comme un lieu d’exil l’endroit où, pour le moment, il se trouvait. »
 Steve Stern La Fabuleuse histoire du clan Kabakoff Editions Autrement
Steve Stern La Fabuleuse histoire du clan Kabakoff Editions Autrement
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Pierre Brévignon
23/09/2013 | Lien permanent
Paul Nizan au Pecq
 Paul-Yves Nizan (1905-1940) est un romancier, essayiste, journaliste et traducteur français. Fils d’un ingénieur des chemins de fer, Paul Nizan fait ses études secondaires à Paris au lycée Henri-IV, où il a pour camarade Jean-Paul Sartre, qui devient rapidement son meilleur ami. Reçu à l’École normale supérieure en 1924, il se lie aussi d'amitié avec Raymond Aron.
Paul-Yves Nizan (1905-1940) est un romancier, essayiste, journaliste et traducteur français. Fils d’un ingénieur des chemins de fer, Paul Nizan fait ses études secondaires à Paris au lycée Henri-IV, où il a pour camarade Jean-Paul Sartre, qui devient rapidement son meilleur ami. Reçu à l’École normale supérieure en 1924, il se lie aussi d'amitié avec Raymond Aron.
Agrégé de philosophie, membre du Parti Communiste, il enseigne et milite à Bourg-en-Bresse. Il entre à L’Humanité puis à Ce Soir où il dirige la page de politique étrangère. En 1939 il quitte le Parti à propos du pacte germano-soviétique et il subit des attaques nombreuses et violentes de la part du parti, en mars 1940 Maurice Thorez signe, dans le journal Die Welt, l'édition allemande de l'organe de la Troisième Internationale, un article intitulé « Les traîtres au pilori », et qualifie Nizan « d'agent de la police ». Mobilisé, agent de liaison auprès de la XIVth Army Field Workshop, Nizan est tué près de Dunkerque le 23 mai 1940. Il est enterré à la Nécropole nationale française de la Targette à Neuville-Saint-Vaast (carré B rangée 9 tombe nº 8189).
« L’œuvre romanesque de Paul Nizan, assez brève, est l’une des plus remarquables de l’entre-deux-guerres. En 1960, dans sa préface à la réédition d’Aden, Arabie (1931), Sartre a essayé de tirer son ami de l’oubli dans lequel il était injustement tombé. (…) Antoine Bloyé (1933), Le Cheval de Troie (1935) et La Conspiration (1938), acerbes, lucides, passionnées, ces œuvres de Nizan sont l’un des rares exemples en France, après Jules Vallès, de romans politiques de qualité. »
Paul Nizan est aussi l'un des premiers grands connaisseurs de la littérature anglaise, et il est l'un des premiers intellectuels français à avoir remarqué la jeune littérature américaine, dont Faulkner, Caldwell, Steinbeck, O'Neill.
En 1924 Paul Nizan rencontre Henriette Halphen, cousine de Claude Lévi-Strauss et il l’épouse à la mairie du 5ème à Paris, avec comme témoins Jean-Paul Sartre et Raymond Aron. Ils auront deux enfants, Anne-Marie (1928) future épouse d'Olivier Todd et Patrick (1930).
Les parents Halphen aiment l’architecture contemporaine. En 1930, un terrain est trouvé et ils font construire une maison par l’architecte Frantz Jourdain qui est le fils de leur décorateur, Francis Jourdain. C’est la première maison de Frantz, influencé par le style moderne du mouvement Bauhaus. Les Nizan s’installent Domaine de Grandchamp, 19 allée des Cèdres au Pecq (Yvelines). C’est dans cette demeure que Nizan écrira la plus grande partie de son œuvre et beaucoup d’amis, comme Sartre, Simone de Beauvoir, Aron, Berl et Jean Renoir n’hésitaient pas à leur rendre visite. Après sa mobilisation en 1940, Paul Nizan reviendra à Grandchamp pour de courtes permissions, avant de disparaître au combat.
Difficile d’apercevoir la maison de la rue, protégée par de hautes haies végétales, et ma pauvre photo n’en montre pas grand-chose. Si aujourd’hui le mot “Bauhaus” est souvent employé à toutes les sauces, ce que j’ai pu en entrevoir correspond peu ou prou à l’idée qu’on s’en fait, à savoir une maison à l’architecture épurée ou géométrique.
Sources : Wikipédia – Introduction de H. Berman pour Le Cheval de Troie (L’Imaginaire Gallimard) Photo : Le Bouquineur
13/10/2013 | Lien permanent
Florian Rochat : La Légende de Little Eagle
 Ancien journaliste, amoureux de la nature, Florian Rochat qui vit au pied des montagnes du Jura suisse est aussi un familier de l'Ouest américain, notamment du Montana. Après avoir publié deux livres chez des éditeurs traditionnels, il s'est engagé depuis 2011, dans la voie de l'auto-publication numérique. Florian Rochat a eu la gentillesse de m’adresser ses ouvrages, Cougar corridor déjà chroniqué, Un printemps sans chien court récit émouvant sur l’amour homme/chien et La légende de Little Eagle.
Ancien journaliste, amoureux de la nature, Florian Rochat qui vit au pied des montagnes du Jura suisse est aussi un familier de l'Ouest américain, notamment du Montana. Après avoir publié deux livres chez des éditeurs traditionnels, il s'est engagé depuis 2011, dans la voie de l'auto-publication numérique. Florian Rochat a eu la gentillesse de m’adresser ses ouvrages, Cougar corridor déjà chroniqué, Un printemps sans chien court récit émouvant sur l’amour homme/chien et La légende de Little Eagle.
« Août 1944 : un pilote américain meurt dans la chute de son appareil près d'un village de Bourgogne. Près de 70 ans plus tard, Hélène Marchal découvre les faits. Et cette révélation : le premier lieutenant John Philip Garreau avait tout tenté pour éviter de percuter la maison de ses grands-parents au lieu de sauter en parachute. La mère d'Hélène, âgée de 4 ans à l'époque, s'y trouvait. Hélène, bouleversée, réalise qu'elle doit au sacrifice de Johnny Garreau d'avoir pu voir le jour. Qui était cet homme, ce garçon de 18 ans ? Hélène part enquêter dans le Montana, d'où il venait. Elle y fait des rencontres inespérées, trouve des documents inattendus. De quoi reconstituer sa vie. La narratrice découvrira aussi combien les mystères du destin peuvent se révéler de manière bouleversante, se tissant au fil de son enquête et reliant tous les protagonistes de cette histoire. »
Si j’avais aimé Cougar corridor, je serai plus réservé sur ce roman, pour des raisons toutes personnelles ne mettant pas en cause le talent de l’écrivain. D’abord, je ne suis pas du tout friand de récits ayant trait aux deux grandes guerres mondiales, du coup les chapitres de combats aériens et autres références à cette époque m’ont paru bien longs. Ensuite parce que ce bouquin, mise en abime certes, relève plus de l’enquête romancée que du roman pur, ce qui parfois m’a paru déstabilisant. Ce sera d’ailleurs la seule critique que je puisse émettre sur l’œuvre de Florian Rochat en général, tient-il à rester un journaliste écrivant des textes extrêmement instructifs pour le lecteur mais délayés dans une fiction, ou bien veut-il franchir le pas pour devenir un écrivain tout court, où la fiction s’appuierait moins ostensiblement sur le travail d’enquête et de documentation. Pour La Légende de Little Eagle, la réponse est claire : « - Si je comprends bien, c’est pas une bio que vous voulez écrire, hein ? C’est pas un roman non plus, je veux dire pas un vrai roman, de la pure fiction. Un peu des deux quand même, je pense. Avec en plus, quelque chose de personnel, des trucs que vous pourriez ressentir de manière intime, mais forte, au sujet de votre personnage. C’est ça ? En gros, oui, c’était ça. »
Il y a par contre d’excellents passages sur les paysages du Montana ainsi que sur le cercle littéraire de Missoula (les amateurs de Nature Writing me comprendront) et là, la balade vaut le déplacement. On retrouve donc dans ce livre, tout ce qui caractérise l’auteur, sa grande connaissance des Etats-Unis (paysages, Indiens, histoire etc.) et son passé de journaliste (Hélène étant son avatar) induisant des textes très précis. De plus, et c’est une constante pour les trois ouvrages que j’ai lus, j’apprécie beaucoup son écriture apaisante, comme si Florian Rochat ne voulait voir ou retenir que la beauté du monde qui nous entoure. Et ne serait-ce que pour cela, le lecteur le remercie.
 Florian Rochat La Légende de Little Eagle En édition numérique chez Amazon
Florian Rochat La Légende de Little Eagle En édition numérique chez Amazon
Pour en savoir plus sur l’auteur et son œuvre, visitez son site.
18/11/2013 | Lien permanent



