Rechercher : larmes blanches
Balzac : Illusions perdues
 Le repos forcé m’a donc permis de lire en toute quiétude le roman entamé fin décembre. Toutes les conditions étaient requises pour l’apprécier dans les meilleures conditions car ce n’est pas le genre d’œuvre qu’on peut lire dans le métro.
Le repos forcé m’a donc permis de lire en toute quiétude le roman entamé fin décembre. Toutes les conditions étaient requises pour l’apprécier dans les meilleures conditions car ce n’est pas le genre d’œuvre qu’on peut lire dans le métro.
Le roman de Balzac est découpé en trois parties et il n’y a pas de chapitres intermédiaires permettant des pauses impromptues. Il faut se lancer dans la lecture de longs passages sans craindre d’être stoppé dans son élan et ne reposer le livre que lorsque l’intrigue le permet. Ce roman est le condensé ou l’illustration parfaite de sa géniale Comédie Humaine. Comment un homme peut-il écrire autant, si bien, avec une telle cohérence globale ? Je ne vais pas me lancer dans une analyse poussée du roman encore moins de l’œuvre titanesque de Balzac, d’autres plus calés que moi l’ont déjà fait et le referont encore. Néanmoins je constate une nouvelle fois que la lecture des grands classiques de la littérature permet de remettre les choses à leur place, de nombreux livres sont édités, beaucoup sont très agréables à lire mais entre un bon livre et un chef-d’œuvre il y a une différence que même le béotien remarque. Aussi quand je parcours certaines critiques dithyrambiques sur des best-sellers à peine éclos des imprimeries Brodard et Taupin à La Flèche(Sarthe) -par exemple- je leur accole un bémol d’emblée.
Pour en revenir aux Illusions perdues (et non pas Les illusions perdues) « l’absence d’article défini – cas unique chez Balzac- montre clairement le caractère absolu de la désillusion » vous en sortirez étourdi et sonné par le machiavélisme des personnages où l’intérêt et l’ambition priment sur tout autre sentiment, les alliances se font et se défont au gré des rebondissements. Lucien de Rubempré pauvre poète monté d’Angoulême à Paris nous permettra d’évoluer dans le monde de la littérature, de la presse, du théâtre, de la bourgeoisie et de l’aristocratie où tous ont partie liée selon le sens du vent. L’intrigue est puissante, atterrante quand Lucien trahira ses amis ou ruinera sa famille, éblouissante quand Balzac démonte sous nos yeux tous les mécanismes économiques et moraux qui enrichissent ou ruinent ses personnages. Paru vers 1840 le livre reste terriblement moderne et tout aussi extraordinaire. Chef-d’œuvre s’il faut encore le répéter.
« Depuis deux heures, aux oreilles de Lucien, tout se résolvait par de l’argent. Au théâtre comme en librairie, en librairie comme au journal, de l’art et de la gloire, il n’en était pas question. Ces coups du grand balancier de la monnaie, répétés sur sa tête et sur son cœur, les lui martelaient. Pendant que l’orchestre jouait l’ouverture, il ne put s’empêcher d’opposer aux applaudissements et aux sifflets du parterre en émeute les scènes de poésie calme et pure qu’il avait goûtées dans l’imprimerie de David, quand tous deux ils voyaient les merveilles de l’Art, les nobles triomphes du génie, la gloire aux ailes blanches. En se rappelant les soirées au Cénacle une larme brilla dans les yeux du poète. »
 Honoré de Balzac Illusions perdues Scènes de la vie de province Le Livre de Poche
Honoré de Balzac Illusions perdues Scènes de la vie de province Le Livre de Poche
09/10/2012 | Lien permanent
Emmanuel Bove : Mes amis
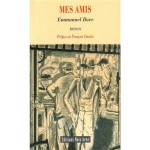 Emmanuel Bove (1898-1945) est entré en littérature en 1924 avec ce premier roman Mes amis alors qu’il n’avait que vingt-cinq ans. Comme souvent pour leur premier jet, les écrivains mettent une bonne part d’eux même et de leur vie dans cette tentative. Emmanuel Bove fils d’un émigrant russe et d’une femme de chambre luxembourgeoise a connu la misère, pratiqué divers métiers et le journalisme. C’est ce dernier job qui le fait remarquer par Colette laquelle le pousse à faire publier ce premier roman. D’autres livres suivront et le succès avec. Après sa mort en 1945 il tombera dans l’oubli et ce n’est que depuis les années soixante-dix qu’on commence à le redécouvrir.
Emmanuel Bove (1898-1945) est entré en littérature en 1924 avec ce premier roman Mes amis alors qu’il n’avait que vingt-cinq ans. Comme souvent pour leur premier jet, les écrivains mettent une bonne part d’eux même et de leur vie dans cette tentative. Emmanuel Bove fils d’un émigrant russe et d’une femme de chambre luxembourgeoise a connu la misère, pratiqué divers métiers et le journalisme. C’est ce dernier job qui le fait remarquer par Colette laquelle le pousse à faire publier ce premier roman. D’autres livres suivront et le succès avec. Après sa mort en 1945 il tombera dans l’oubli et ce n’est que depuis les années soixante-dix qu’on commence à le redécouvrir.
Le personnage principal de Mes amis est Victor Bâton, célibataire et solitaire, invalide de guerre il subsiste grâce à une petite pension et habite une chambre minable à Paris. Un looser total comme on dirait grossièrement de nos jours, passant tout son temps libre – et il n’en manque pas – à chercher et quémander une amitié. Car Victor peut tout supporter, sa vie banale et sans perspective, sauf cette solitude qui le ronge et l’obsède. On a mal à suivre Victor dans sa quête car s’il semble bien gentil, il n’est pas bien beau, pas très causant, sans le sou ou presque, bref on devine qu’il aura peu de chances de parvenir à ses fins. Sa souffrance nous gagne et l’écriture légère, en quelques mots ou phrases, nous le montre comme si nous étions au cinéma, dans sa petite vie assez déprimante. Nous le suivons le long des trottoirs, dans les petits cafés et restaurants du Paris des années trente, rien ne nous est épargné de sa vie intime, sa toilette dans une cuvette, ses dents non pas cariées mais qui se cassent, ses cheveux gras et son manteau usagé. Nous sommes aussi dans sa tête, l’écoutant réfléchir, s’imaginant les réactions des autres, paralysé parfois par ses inhibitions ou sa timidité.
Comme sur un chemin de croix, Emmanuel Bove le fera tomber cinq fois ; il y aura Lucie Dunois, Henri Billard, Neveu, Monsieur Lacaze et enfin Blanche. Une tenancière de bouis-bouis qui le jette après une nuit, un type qui ne lui rendra pas l’argent prêté, un marinier suicidaire qu’il sauve de la mort mais ne lui en sera pas reconnaissant, un industriel qui lui offre un travail mais Victor en louchant naïvement sur sa fille perd ce qu’il avait gagné et enfin une artiste de variétés avec laquelle il amorce une idylle d’un soir mais « je regrettais mon lit ». Finalement, chassé de son logement par son propriétaire il s’éloigne, poursuivant son errance, indéfiniment ? « Ah ! la solitude qu’elle belle et triste chose ! Qu’elle est belle quand nous la choisissons ! Qu’elle est triste quand elle nous est imposée depuis des années ! ».
« Quand je m’éveille, ma bouche est ouverte. Mes dents sont grasses : les brosser le soir serait mieux, mais je n’en ai pas le courage. Des larmes ont séché aux coins de mes paupières. Mes épaules ne me font plus mal. Des cheveux raides couvrent mon front. De mes doigts écartés je les rejette en arrière. C’est inutile : comme les pages d’un livre neuf, ils se dressent et retombent sur mes yeux. »
 Emmanuel Bove Mes amis Editions Nota Bene
Emmanuel Bove Mes amis Editions Nota Bene
09/10/2012 | Lien permanent
Mon plus vieux souvenir de lecture
Quand je cherche à me souvenir du premier livre que j’ai lu, et je parle des livres qui se lisent, non de ceux avec des images qu’on déchiffre à la maternelle, deux situations fortes me reviennent spontanément à la mémoire. Dans les deux cas, nous sommes à la fin des années cinquante et je n’ai pas dix ans, peut-être huit.
Je suis à l’école et le maître en blouse grise nous a demandé de sortir nos livres de lecture. Mon bouquin est rangé dans le casier de mon pupitre en bois. Sur le tableau noir derrière lui, le professeur a inscrit à la craie blanche, le nom du texte et l’auteur. Jean-Christophe de Romain Rolland. Dans sa totalité, Jean-Christophe est un roman fleuve d’une dizaine de tomes, dans notre livre de classe on n’y trouvait qu’un passage tiré de L’Aube, le début de l’ouvrage. Nous ouvrons nos livres à la page indiquée et le maître, désignant un élève, lui demande d’en lire quelques lignes, puis un second poursuit la lecture et ainsi de suite.
« Louisa servait les petits : deux pommes de terre à chacun. Lorsque venait le tour de Christophe, souvent il n’en restait que trois sur l’assiette, et sa mère n’était pas servie. Il le savait d’avance, il les avait comptées, avant qu’elles arrivent à lui. Alors il rassemblait son courage, et d’un air dégagé : – Rien qu’une, maman. Elle s’inquiétait un peu. – Deux, comme les autres. – Non, je t’en prie, une seule. – Est-ce que tu n’as pas faim ? – Non, je n’ai pas grand’ faim. » Et l’auteur de poursuivre ainsi sur une page ou deux, la description de la connivence muette et tendre entre la mère et l’enfant.
Ce texte nous l’avons lu et relu durant plusieurs jours et chaque fois, la même émotion me brisait, chaque fois les larmes me venaient aux yeux et je me hâtais de les sécher au cas où le sort me désigne pour la lecture. J’avais l’âge de Jean-Christophe peut-être, en tout cas sachant lire couramment, je pouvais appréhender le texte sans être contrarié par les embûches grammaticales ou le déchiffrage des mots. Passé le stade du décryptage, j’étais entré dans le plaisir de la lecture et des émotions induites. Ah, ce plat de pommes de terre, pas assez nombreuses pour nourrir toute la famille réunie autour de la table, je l’ai gardé en mémoire toute ma vie. Et aujourd’hui encore, tandis que je mets par écrit ce souvenir, j’en ai toujours le goût salé par les pleurs muets, en bouche.
Dieu merci, je vous rassure, j’ai aussi un souvenir plus gai ! A cette même époque, nous sommes en vacances en Bretagne, un petit bled (en ce temps-là) qui se nomme Scaër, proche de Rosporden. Une bibliothèque municipale, faite d’une toute petite pièce avec quelques étagères et pas beaucoup plus de livres, toute la famille vient y emprunter de quoi lire le soir – la télé n’étant pas encore implantée partout. C’est ici que je découvre Antoine de  Saint-Exupéry avec Vol de nuit et Courrier sud, de l’aventure réelle qui ne pouvait qu’émerveiller le petit garçon que j’étais alors et dans le genre fiction, celui qui sera mon premier héros, Bob Morane. Nous parlons ici du Bob Morane des romans, créé en décembre 1953 par le romancier belge Henri Vernes, pour la collection de poche « Marabout Junior ». Bob Morane et son copain Bill Ballantine, le gros costaud, moi et mon père en étions dingues, nous avons passé notre mois de vacances à bouquiner tout le stock local.
Saint-Exupéry avec Vol de nuit et Courrier sud, de l’aventure réelle qui ne pouvait qu’émerveiller le petit garçon que j’étais alors et dans le genre fiction, celui qui sera mon premier héros, Bob Morane. Nous parlons ici du Bob Morane des romans, créé en décembre 1953 par le romancier belge Henri Vernes, pour la collection de poche « Marabout Junior ». Bob Morane et son copain Bill Ballantine, le gros costaud, moi et mon père en étions dingues, nous avons passé notre mois de vacances à bouquiner tout le stock local.
Après, le pli était pris, la lecture m’avait déjà enseigné qu’elle était source de joies et de peines consenties, je n’avais plus qu’à piocher dans la grande bibliothèque mondiale et presque soixante ans après, je n’en ai pas encore épuisé toutes les richesses.
Et vous, quel est votre plus ancien souvenir de lecture ?
13/05/2016 | Lien permanent | Commentaires (13)
Henning Mankell : Le Chinois
 Henning Mankell est un écrivain suédois né en 1948 à Stockholm. Très vite abandonné par sa mère, il est élevé par son père, juge d'instance. Il est le gendre d'Ingmar Bergman dont il a épousé en secondes noces la fille Eva. Il partage sa vie entre la Suède et le Mozambique où il a monté une troupe de théâtre. Il est connu internationalement grâce à la série policière des enquêtes de Kurt Wallander mais ce roman, Le Chinois, qui date de 2008, ne fait pas partie de cette série.
Henning Mankell est un écrivain suédois né en 1948 à Stockholm. Très vite abandonné par sa mère, il est élevé par son père, juge d'instance. Il est le gendre d'Ingmar Bergman dont il a épousé en secondes noces la fille Eva. Il partage sa vie entre la Suède et le Mozambique où il a monté une troupe de théâtre. Il est connu internationalement grâce à la série policière des enquêtes de Kurt Wallander mais ce roman, Le Chinois, qui date de 2008, ne fait pas partie de cette série.
« Par un froid matin de janvier 2006, la police de Hudiksvall, dans le nord de la Suède, fait une effroyable découverte. Dix-neuf personnes ont été massacrées à l’arme blanche dans un petit village isolé. La policière Vivi Sundberg penche pour l’acte d’un déséquilibré. Mais la juge de Helsingborg, Birgitta Roslin, qui s’intéresse à l’affaire car les parents adoptifs de sa mère sont parmi les victimes, est persuadée que ce crime n’est pas l’œuvre d’un fou. »
Un bouquin un peu bizarre ou curieusement ficelé qui finalement, à la réflexion quand j’écris ce billet, n’emporte pas mon adhésion totale. Le roman est découpé en quatre parties, la première est réellement superbe, d’emblée nous sommes plongés dans un carnage qui met en appétit l’amateur de polars, le rythme est enlevé, on se cale dans son fauteuil pour suivre une enquête traditionnelle ponctuée, on imagine, des roublardises qu’un grand écrivain comme Mankell ne manquera pas de semer sous nos yeux. Et patatras ! Surprise, surprise ! Nous ne reviendrons en Suède qu’à la fin du livre, pour un épilogue haletant certes, mais discutable quant aux péripéties décrites.
Entretemps, c'est-à-dire l’essentiel du texte, nous serons allés aux Etats-Unis en 1863, assister à la construction du réseau ferroviaire par les immigrés Chinois (d’où le titre du roman), puis à Pékin dans la Chine d’aujourd’hui avec un détour par l’Afrique, au Zimbabwe et au Mozambique, dans les pas d’une délégation chinoise d’investisseurs.
Ce qui devait être à mes yeux, un polar, s’avère un roman de géopolitique dont la Chine est l’acteur principal. On sent l’écrivain assez remonté contre la société occidentale qui ne cesse de critiquer les autres pays (le président Mugabe au Zimbabwe, Mao en Chine) mais qui semble oublier un peu vite que c’est elle, lors des époques coloniales à travers le monde, qui a implanté les germes du grand bordel qui en découlera. Henning Mankell livre son analyse de la politique économique Chinoise moderne (à laquelle on n’est pas obligé d’adhérer), tiraillée entre « les tenants de l’ancien idéal communiste et un courant qui n’avait plus qu’un lien très superficiel avec ce qui avait fondé la République populaire » : en investissant sur le continent Noir, « d’immenses surfaces pourraient être peuplées par nos pauvres. Nous mettrions ainsi en valeur l’Afrique, tout en éliminant chez nous une menace. » Au passage et comme d’habitude, l’écrivain glisse quelques piques sur le soi-disant modèle Suédois et ses institutions et s’interroge sur ce que deviennent nos idéaux de jeunesse avec les années qui passent.
Pour en terminer, je ne sais pas quoi penser de ce roman, même si je ne n’en pense pas de mal. Le bon point, je ne me suis pas ennuyé, loin de là ; ça se lit vite et bien ce n’est pas mal écrit, il y a du suspense parfois. Le mauvais point, l’intrigue strictement policière est entachée de coups de pot ou de hasards bien venus pour l’héroïne… mais qui moi, m’agacent. Et puis surtout, il y a cette construction qui surprend, donnant l’impression de lire plusieurs livres, imbriqués sous un titre unique.
« Ce qui suivit devait faire date dans l’histoire pénale de la Suède. Ce que découvrirent les trois policiers était sans précédent. Ils passèrent de maison en maison, arme au poing. Partout ils trouvèrent des cadavres. Des chiens et des chats éventrés, et même un perroquet décapité. Dix-neuf morts, tous des personnes âgées, à l’exception d’un garçon d’une douzaine d’années. Certains avaient été tués au lit, dans leur sommeil, d’autres gisaient par terre ou étaient assis dans leur cuisine. (…) Tous avaient subi le même déchaînement de violence. Un ouragan de sang les avait emportés à leur réveil. »
 Henning Mankell Le Chinois Points – 567 pages –
Henning Mankell Le Chinois Points – 567 pages –
Traduit du suédois par Rémi Cassaigne
Une interview de l’écrivain donnée au Nouvel Observateur : ICI
17/07/2015 | Lien permanent
Kent Haruf : Le Chant des plaines
 Kent Haruf (1943 – 2014) est un écrivain américain. Fils d'un pasteur méthodiste et d'une enseignante, il étudie à la Nebraska Weslayan University où il obtient son diplôme. Avant de commencer à publier ses œuvres, il exerce différents métiers : agriculteur dans un élevage de poulets, ouvrier, bibliothécaire, enseignant dans un corps de paix en Turquie, puis enseignant à l'université. Son œuvre est très mince, quatre romans dont celui-ci, Le Chant des plaines, son premier ouvrage, datant de 1999.
Kent Haruf (1943 – 2014) est un écrivain américain. Fils d'un pasteur méthodiste et d'une enseignante, il étudie à la Nebraska Weslayan University où il obtient son diplôme. Avant de commencer à publier ses œuvres, il exerce différents métiers : agriculteur dans un élevage de poulets, ouvrier, bibliothécaire, enseignant dans un corps de paix en Turquie, puis enseignant à l'université. Son œuvre est très mince, quatre romans dont celui-ci, Le Chant des plaines, son premier ouvrage, datant de 1999.
Holt, une toute petite ville du Colorado et décor habituel des romans de l’écrivain. Victoria, dix-sept ans, enceinte, chassée par sa mère de leur maison trouve refuge dans un premier temps chez Maggie Jones, une enseignante de son lycée. Tom Guthrie, lui aussi enseignant dans ce lycée, vit seul avec ses deux gamins, Ike et Bobby, depuis que sa femme dépressive s’est éloignée pour faire une pause. Et puis il y a les deux vieux (pas ceux du Muppet Show !), Harold et Raymond McPheron, frangins, célibataires, taiseux, fermiers à l’écart de la ville chez qui tout le monde finira par trouver un réconfort imprévu.
Un de ces romans dont un résumé basique ne dit rien de son contenu. Ici aucun rebondissements spectaculaires, ni finale grandiose, même le cours du récit suit un rythme tranquille et c’est très logique, car nous partageons la vie de gens très simples, presque anonymes. Des gens qui doivent vivre avec des problèmes de tous les jours, une gamine qui se retrouve enceinte et seule, un père avec deux garçonnets dont leur mère s’est éloignée pour retrouver ses esprits avant de revenir, peut-être ?
Il y a des braves gens, tous ceux cités dans le résumé et puis bien entendu il y a ces connards habituels qui savent pourrir nos vies. J’écris « nos vies », car si le roman se déroule aux Etats-Unis, les acteurs sont universels. Il y a donc, le petit coq qui a séduit Victoria, et puis un crétin de cancre qui va pourrir l’air de Tom et faire souffrir Ike et Bobby lors d’une séquence qui m’a mis dans une rage folle.
Un livre tout simplement magnifique, peut-être celui qui m’a le plus ému de toute ma longue carrière de lecteur ! Pas moins. Du début jusqu’à la fin, j’avais les larmes aux yeux, je ne crains pas de le dire. J’ai dit que l’histoire n’était pas tellement importante en tant que telle, mais la manière dont elle est écrite m’a terrassé. Kent Haruf utilise des mots d’une grande simplicité, décrit très précisément des situations très banales. Un autre pouvait écrire ce bouquin et nous rendre une copie bien nunuche, un truc pour midinette car il est vrai que nous flirtons avec cette ligne blanche mais Kent Haruf par je ne sais quel tour de magie, en fait une petite merveille.
Je ne suis pas réellement surpris car j’avais déjà lu cet écrivain et toujours j’avais adoré. Alors, si ce roman n’est pas encore passé entre vos mains, n’hésitez pas une seule seconde, vous adorerez ses personnages et leur humanité, de ceux qu’on aimerait voir plus souvent dans ce monde.
« Et ainsi, les deux frères McPheron se mirent à discuter bétail, abattoir et bouvillons de choix, génisses et veaux de lait, expliquant tout cela aussi, et entre eux trois, ils discutèrent à fond de toutes ces choses, jusque tard dans la soirée. Parlant. Conversant. S’aventurant un peu dans d’autres sujets assez divers. Les deux vieux bonshommes et la fille de dix-sept ans assis devant la table de la salle à manger en pleine campagne après la fin du dîner, et après avoir nettoyé la table, tandis que dehors, au-delà des murs de la maison et des fenêtres sans rideaux, un vent du nord bleu et froid commençait à souffler une nouvelle série de bourrasques hivernales sur les hautes plaines. »
 Kent Haruf Le Chant des plaines Robert Laffont – 429 pages –
Kent Haruf Le Chant des plaines Robert Laffont – 429 pages –
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Benjamin Legrand
29/09/2020 | Lien permanent | Commentaires (6)
Conte de Noël
 François Édouard Joachim Coppée (1842 – 1908), est un poète, dramaturge et romancier français. Coppée fut le poète populaire et sentimental de Paris et de ses faubourgs, des tableaux de rue intimistes du monde des humbles. Poète du souvenir d'une première rencontre amoureuse, de la nostalgie d'une autre existence ou de la beauté du crépuscule, il rencontra un grand succès populaire.
François Édouard Joachim Coppée (1842 – 1908), est un poète, dramaturge et romancier français. Coppée fut le poète populaire et sentimental de Paris et de ses faubourgs, des tableaux de rue intimistes du monde des humbles. Poète du souvenir d'une première rencontre amoureuse, de la nostalgie d'une autre existence ou de la beauté du crépuscule, il rencontra un grand succès populaire.
C’est à lui que j’ai confié le soin, cette année, de nous fournir notre conte de Noël : Les sabots du petit Wolff.
« Il était une fois, – il y a si longtemps que tout le monde a oublié la date, – dans une ville du nord de l’Europe, – dont le nom est si difficile à prononcer que personne ne s’en souvient, – il était une fois un petit garçon de sept ans, nommé Wolff, orphelin de père et de mère, et resté à la charge d’une vieille tante, personne dure et avaricieuse, qui n’embrassait son neveu qu’au Jour de l’An et qui poussait un grand soupir de regret chaque fois qu’elle lui servait une écuellée de soupe.
Mais le pauvre petit était d’un si bon naturel, qu’il aimait tout de même la vieille femme, bien qu’elle lui fit grand peur et qu’il ne pût regarder sans trembler la grosse verrue, ornée de quatre poils gris, qu’elle avait au bout du nez. Comme la tante de Wolff était connue de toute la ville pour avoir pignon sur rue et de l’or plein un vieux bas de laine, elle n’avait pas osé envoyer son neveu à l’école des pauvres ; mais elle avait tellement chicané, pour obtenir un rabais, avec le magister chez qui le petit Wolff allait en classe, que ce mauvais pédant, vexé d’avoir un élève si mal vêtu et payant si mal, lui infligeait très souvent, et sans justice aucune, l’écriteau dans le dos et le bonnet d’âne, et excitait même contre lui ses camarades, tous fils de bourgeois cossus, qui faisaient de l’orphelin leur souffre-douleur. Le pauvre mignon était donc malheureux comme les pierres du chemin et se cachait dans tous les coins pour pleurer, quand arrivèrent les fêtes de Noël.
La veille du grand jour, le maître d’école devait conduire tous ses élèves à la messe de minuit et les ramener chez leurs parents. Or, comme l’hiver était très rigoureux, cette année-là, et comme, depuis plusieurs jours, il était tombé une grande quantité de neige, les écoliers vinrent tous au rendez-vous chaudement empaquetés et emmitouflés, avec bonnets de fourrure enfoncés sur les oreilles, doubles et triples vestes, gants et mitaines de tricot et bonnes grosses bottines à clous et à fortes semelles. Seul, le petit Wolff se présenta grelottant sous ses habits de tous les jours et des dimanches, et n’ayant aux pieds que des chaussons de Strasbourg dans de lourds sabots. Ses méchants camarades, devant sa triste mine et sa dégaine de paysan, firent sur son compte mille risées ; mais l’orphelin était tellement occupé à souffler sur ses doigts et souffrait tant de ses engelures, qu’il n’y prit pas garde. – Et la bande de gamins, marchant deux par deux, magister en tête, se mit en route pour la paroisse.
Il faisait bon dans l’église, qui était toute resplendissante de cierges allumés ; et les écoliers, excités par la douce chaleur, profitèrent du tapage de l’orgue et des chants pour bavarder à demi-voix. Ils vantaient les réveillons qui les attendaient dans leurs familles. Le fils du bourgmestre avait vu, avant de partir, une oie monstrueuse, que des truffes tachetaient de points noirs comme un léopard. Chez le premier échevin, il y avait un petit sapin dans une caisse, aux branches duquel pendaient des oranges, des sucreries et des polichinelles. Et la cuisinière du tabellion avait attaché derrière son dos, avec une épingle, les deux brides de son bonnet, ce qu’elle ne faisait que dans ses jours d’inspiration, quand elle était sûre de réussir son fameux plat sucré.
Et puis, les écoliers parlaient aussi de ce que leur apporterait le petit Noël, de ce qu’il déposerait dans leurs souliers, que tous auraient soin, bien entendu, de laisser dans la cheminée avant d’aller se mettre au lit ; et dans les yeux de ces galopins, éveillés comme une poignée de souris, étincelait par avance la joie d’apercevoir, à leur réveil, le papier rose des sacs de pralines, les soldats de plomb rangés en bataillon dans leur boîte, les ménageries sentant le bois verni et les magnifiques pantins habillés de pourpre et de clinquant. Le petit Wolff, lui, savait bien, par expérience, que sa vieille avare de tante l’enverrait se coucher sans souper ; mais, naïvement, et certain d’avoir été, toute l’année, aussi sage et aussi laborieux que possible, il espérait que le petit Noël ne l’oublierait pas, et il comptait bien, tout à l’heure, placer sa paire de sabots dans les cendres du foyer.
La messe de minuit terminée, les fidèles s’en allèrent, impatients du réveillon, et la bande des écoliers, toujours deux par deux et suivant le pédagogue, sortit de l’église. Or, sous le porche, assis sur un banc de pierre surmonté d’une niche ogivale, un enfant était endormi, un enfant couvert d’une robe de laine blanche, et pieds nus, malgré la froidure. Ce n’était point un mendiant, car sa robe était propre et neuve, et, près de lui, sur le sol, on voyait, liés dans une serge, une équerre, une hache, une bisaiguë, et les autres outils de l’apprenti charpentier. Éclairé par la lueur des étoiles, son visage aux yeux clos avait une expression de douceur divine, et ses longs cheveux bouclés, d’un blond roux, semblaient allumer une auréole autour de son front. Mais ses pieds d’enfant, bleuis par le froid de cette nuit cruelle de décembre, faisaient mal à voir.
Les écoliers, si bien vêtus et chaussés pour l’hiver, passèrent indifférents devant l’enfant inconnu ; quelques-uns même, fils des plus gros notables de la ville, jetèrent sur ce vagabond un regard où se lisait tout le mépris des riches pour les pauvres, des gras pour les maigres. Mais le petit Wolff, sortant de l’église le dernier, s’arrêta tout ému devant le bel enfant qui dormait.
– « Hélas ! se dit l’orphelin, c’est affreux ! Ce pauvre petit va sans chaussures par un temps si rude... Mais, ce qui est encore pis, il n’a même pas, ce soir, un soulier ou un sabot à laisser devant lui, pendant son sommeil, afin que le petit Noël y dépose de quoi soulager sa misère ! » Et, emporté par son bon cœur, Wolff retira le sabot de son pied droit, le posa devant l’enfant endormi, et, comme il put, tantôt à cloche-pied, tantôt boitillant et mouillant son chausson dans la neige, il retourna chez sa tante.
– « Voyez le vaurien ! s’écria la vieille, pleine de fureur au retour du déchaussé. Qu’as-tu fait de ton sabot, petit misérable ? » Le petit Wolff ne savait pas mentir, et bien qu’il grelottât de terreur en voyant se hérisser les poils gris sur le nez de la mégère, il essaya, tout en balbutiant, de conter son aventure. Mais la vieille avare partit d’un effrayant éclat de rire.
– « Ah ! Monsieur se déchausse pour les mendiants ! Ah ! Monsieur dépareille sa paire de sabots pour un va-nu-pieds !... Voilà du nouveau, par exemple !... Eh bien, puisqu’il en est ainsi, je vais laisser dans la cheminée le sabot qui te reste, et le petit Noël y mettra cette nuit, je t’en réponds, de quoi te fouetter à ton réveil... Et tu passeras la journée de demain à l’eau et au pain sec... Et nous verrons bien si, la prochaine fois, tu donnes encore tes chaussures au premier vagabond venu ! » Et la méchante femme, après avoir donné au pauvre petit une paire de soufflets, le fit grimper dans la soupente où se trouvait son galetas. Désespéré, l’enfant se coucha dans l’obscurité et s’endormit bientôt sur son oreiller trempé de larmes.
Mais, le lendemain matin, quand la vieille, réveillée par le froid et secouée par son catarrhe, descendit dans sa salle basse, – ô merveille ! – elle vit la grande cheminée pleine de jouets étincelants, de sacs de bonbons magnifiques, de richesses de toutes sortes ; et, devant ce trésor, le sabot droit, que son neveu avait donné au petit vagabond, se trouvait à côté du sabot gauche, qu’elle avait mis là, cette nuit même, et où elle se disposait à planter une poignée de verges. Et, comme le petit Wolff, accouru aux cris de sa tante, s’extasiait ingénument devant les splendides présents de Noël, voilà que de grands rires éclatèrent au dehors. La femme et l’enfant sortirent pour savoir ce que cela signifiait, et virent toutes les commères réunies autour de la fontaine publique. Que se passait-il donc ? Oh ! Une chose bien plaisante et bien extraordinaire ! Les enfants de tous les richards de la ville, ceux que leurs parents voulaient surprendre par les plus beaux cadeaux, n’avaient trouvé que des verges dans leurs souliers.
Alors, l’orphelin et la vieille femme, songeant à toutes les richesses qui étaient dans leur cheminée, se sentirent pleins d’épouvante. Mais, tout à coup, on vit arriver M. le curé, la figure bouleversée. Au-dessus du banc placé près de la porte de l’église, à l’endroit même où, la veille, un enfant, vêtu d’une robe blanche et pieds nus, malgré le grand froid, avait posé sa tête ensommeillée, le prêtre venait de voir un cercle d’or, incrusté dans les vieilles pierres. Et tous se signèrent dévotement, comprenant que ce bel enfant endormi, qui avait auprès de lui des outils de charpentier, était Jésus de Nazareth en personne, redevenu pour une heure tel qu’il était quand il travaillait dans la maison de ses parents, et ils s’inclinèrent devant ce miracle que le bon Dieu avait voulu faire pour récompenser la confiance et la charité d’un enfant. »
24/12/2014 | Lien permanent
Colum McCann : Les Saisons de la nuit
 Colum McCann né en 1965 à Dublin est un écrivain Irlandais. Après des études de journalisme, il travaille comme rédacteur pour l'Evening Herald puis devient correspondant junior pour l'Evening Press de Dublin dans les années 1980. À l'âge de 21 ans il part aux Etats-Unis et sillonne le pays, multipliant les petits boulots. Il décide ensuite de partir vivre au Japon, avant de revenir à New York où il vit aujourd'hui et enseigne l'écriture. Son roman Les Saisons de la nuit date de 1998.
Colum McCann né en 1965 à Dublin est un écrivain Irlandais. Après des études de journalisme, il travaille comme rédacteur pour l'Evening Herald puis devient correspondant junior pour l'Evening Press de Dublin dans les années 1980. À l'âge de 21 ans il part aux Etats-Unis et sillonne le pays, multipliant les petits boulots. Il décide ensuite de partir vivre au Japon, avant de revenir à New York où il vit aujourd'hui et enseigne l'écriture. Son roman Les Saisons de la nuit date de 1998.
Le premier chapitre, très court en deux pages, se déroule en 1991 et présente rapidement Treefrog, un SDF vivant dans un tunnel sous New York. Le second chapitre, beaucoup plus long nous permet de faire connaissance avec Nathan Walker, ouvrier tunnelier construisant une ligne de métro sous l’Hudson en 1916. Tout le roman va désormais s’articuler entre ces deux dates lointaines.
Nathan Walker a 19 ans quand commence le récit. Il travaille à la construction d’un tunnel ferroviaire, un boulot dangereux et éprouvant mais qui créé des liens entre les ouvriers et c’est ainsi, qu’il deviendra ami pour la vie avec Con O’Leary l’Irlandais, Sean Power et Vannucci l’Italien. Nathan lui, est un noir venu de Géorgie. A eux quatre ils forment une petite bande multiculturelle dans un pays et à une époque où le racisme sévit, ce dont Nathan subit chaque jour les conséquences. Brimades exacerbées quand plus tard, Nathan épousera une femme blanche, Eleanor, fille d’O’Leary et dont il aura plusieurs enfants dont leur histoire va venir se greffer à la narration globale.
De son côté, dans le futur, Treefrog vit seul dans un tunnel de New York où il s’est aménagé un chez lui. Aucun confort, dans le sens commun où nous l’entendons, il fait froid, il n’y a aucunes commodités bien sûr, mais il s’y sent bien. Autour de lui, d’autres malheureux se sont installés, chacun se créant son propre univers solitaire. Jusqu’à l’arrivée d’Angela. Violée, battue, droguée, elle se rapprochera un peu de Treefrog à un moment, et de leurs discussions va surgir lentement et de manière confuse, l’histoire de la vie de ce Treefrog.
L’une des grandes réussites de ce roman tient dans sa construction savante. Historique d’abord, puisque le lecteur se retrouve balloté d’une époque à une autre, passé et présent s’éloignant ou se rapprochant ; narrative ensuite, car McCann ne dévoile pas son intrigue simplement, elle est comme en léger décalage, l’explication de situations arrivant après leurs descriptions ce qui oblige le lecteur à rester attentif pour suivre le cours de l’histoire et les liens entre les personnages. Si rien n’est évident durant la lecture, tout se tient et chaque pion est en relation avec son voisin, hier comme aujourd’hui, la vision globale n’étant révélée qu’à la fin.
Si la forme est donc particulièrement soignée, le fond emporte encore plus l’adhésion. A l’aide de phrases courtes et sèches mais d’une puissance rare tant chaque mot est chargé d’émotion, Colum McCann nous donne un roman réellement poignant comme on n’en lit peu souvent et faites moi confiance, je n’emploie pas une formule toute faite. Malgré un ton d’écriture qu’on penserait détaché, que ce soit pour décrire des joies comme des peines, l’écrivain nous met parfois au bord des larmes. Ses personnages, des gens très simples devant endurer la violence physique ou verbale permanente, font preuve d’un courage et de qualités morales exceptionnelles et leurs souffrances donnent tout son prix à ce livre.
Mêlant les faits réels à la fiction de son roman, avec en toile de fond le racisme, ce poison mortel lourd de conséquences pour les acteurs de ce drame, Colum McCann touche avec Les Saisons de la nuit, à la quintessence de la littérature ou pour le dire autrement, au chef-d’œuvre.
« Parfois, des couples s’injurient en se penchant aux fenêtres. Tout un paysage d’amour et de haine. Une brutalité sensible dans l’atmosphère. De la tendresse aussi, pourtant. Il y a là quelque chose de si vivant que le cœur de la ville semble près d’éclater de toute la douleur qui y est accumulée. Comme s’il allait soudain exploser sous le poids dela vie. Commesi la ville elle-même avait engendré toutes les complexités du cœur humain. Des veines et des artères – semblables aux tunnels de son grand-père – bouillonnantes de sang. Des millions d’hommes et de femmes irriguant de ce sang les rues de la cité. »
 Colum McCann Les Saisons de la nuit Belfond
Colum McCann Les Saisons de la nuit Belfond
Traduit de l’anglais (Irlande) par Marie-Claude Peugeot
29/04/2013 | Lien permanent
François Mauriac : Le Mystère Frontenac
 François Mauriac (1885-1970), lauréat du Grand Prix du roman de l'Académie française (1926), membre de l'Académie française (1933) et lauréat du prix Nobel de littérature (1952) a été décoré de la Grand-croix de la Légion d'honneur en 1958. Le Mystère Frontenac date de 1933.
François Mauriac (1885-1970), lauréat du Grand Prix du roman de l'Académie française (1926), membre de l'Académie française (1933) et lauréat du prix Nobel de littérature (1952) a été décoré de la Grand-croix de la Légion d'honneur en 1958. Le Mystère Frontenac date de 1933.
Le roman se déroule à cheval entre la fin d’un siècle et le début du XXème siècle, avant la Première Guerre Mondiale. Les Frontenac vivent entre leurs maisons de Bordeaux et de Bourideys où ils possèdent une exploitation agricole. Michel, le père, est décédé depuis huit ans, laissant Blanche sa veuve avec leurs enfants, Jean-Louis, Yves et José, et leurs deux sœurs. L’oncle paternel Xavier Frontenac administre pour eux leurs biens et gère le domaine.
Visiblement, les deux sœurs n’intéressent pas l’écrivain, peut-être parce qu’une fois mariées elles perdront le nom de Frontenac ? Toujours est-il qu’il n’est jamais question de leur sort et qu’on va suivre l’évolution des autres, les fils qui passent d’enfants à adultes avec la substitutions de leurs rêves à la réalité de la vie comme pour Jean-Louis l’aîné, qui se voulait philosophe mais qui reprendra la direction de l’affaire familial. Yves, écrit des poèmes dès l’enfance et se verra publié par le Mercure de France, d’où une vie plus mondaine à Paris, loin de la pesante ambiance du Bordelais ; José qui a dépensé son héritage, s’engage dans l’armée et part au Maroc où il mourra.
Le destin de ses fils angoisse Blanche qui aurait souhaité que toute la fratrie se serre les coudes et participe à la vie de l’exploitation familiale. Elle-même, n’a jamais cherché à se remarier, toute sa vie a été sacrifiée à la recherche d’une union entre ses enfants en un lieu unique, sur leur propriété. L’oncle Xavier, célibataire, est fermement attaché à la tradition et se fait un devoir moral, en mémoire de son frère, pour gérer au mieux le capital pour ses neveux. Une mission quasi mystique qui va à son insu, lui gâcher sa vie quand il décidera de garder secret sa liaison avec Josefa, une femme d’une catégorie sociale inférieure, s’interdisant de l’introduire dans la famille Frontenac, ce qui serait un déshonneur, la cachant à Angoulême (« si respectueux de l’ordre établi et si éloigné de la vie simple et normale »). Le mystère Frontenac, cette tribu qui aujourd’hui nous paraît hors du temps, comme sortie d’une Amazonie du Sud-ouest de la France, réside dans ces rapports liés aux mœurs de l’époque pour une certaine catégorie sociale et au poids de la religion.
Quand on consulte la fiche Wikipédia consacrée à François Mauriac, il est aisé de constater que ce roman est très autobiographique : le milieu social, la famille, Yves le futur écrivain, le domaine familial etc. Et même si ce roman n’est pas mon préféré de l’écrivain, il y a de très beaux passages et il y règne une sensibilité que je qualifierais de proustienne quand il est question d’Yves et de sa mère Blanche. Un fils qui portera longtemps le poids du regret de n’avoir pu embrasser sa mère avant sa mort, alors qu’il en avait la possibilité. Reste la langue de Mauriac, parfaite comme toujours.
« Il répondit d’un ton sec, et qui coupait court au débat, qu’il ne se marierait jamais. D’ailleurs cette réflexion de sa belle-sœur n’éveilla en rien sa méfiance ; car l’idée d’un mariage avec Josefa n’aurait pu même traverser son esprit. Donner le nom de Frontenac à une femme de rien, qui avait roulé, l’introduire dans la maison de ses parents, et surtout la présenter à la femme de Michel, aux enfants de Michel, de tels sacrilèges n’étaient pas concevables. Aussi ne crut-il pas une seconde que Blanche avait éventé son secret. Il quitta la fenêtre, agacé, mais nullement inquiet, et demanda la permission de se retirer dans sa chambre. »
 François Mauriac Le Mystère Frontenac Le Livre de Poche – 192 pages –
François Mauriac Le Mystère Frontenac Le Livre de Poche – 192 pages –
26/08/2021 | Lien permanent | Commentaires (2)
Où l’on parle de la jaquette
Je ne sais pas pourquoi mais j’ai tendance à me prendre la tête avec de faux problèmes. Par exemple, avec les jaquettes des livres.
Comme le précise mon ami Robert qui a toujours le mot juste, il s’agit de la « chemise protégeant la couverture d’un livre relié ou broché. » Or, très souvent pour ne pas dire toujours, si elles sont gaies, leurs couleurs criardes me paraissent très vulgaires d’autant qu’à mon âge j’ai été élevé dans le respect de la simplicité de la collection Blanche de Gallimard. Quand Philippe Djian, changeant d’écurie, est passé chez le célèbre éditeur et que l’immaculée couverture s’est ensuite enrichie d’une jaquette colorée, j’ai pris la décision de jeter à la poubelle cet emballage superfétatoire. Mon cher Djian s’aligne donc sur mes rayonnages de bibliothèque dans l’habit monacal adopté par ses illustres prédécesseurs. Et maintenant que j’ai pris cette habitude, je me vois mal rompre avec cette esthétique.
Si l’affaire s’arrêtait là, il n’y aurait pas de problème. Mais bien entendu, ce n’est pas le cas. Car si j’adopte cette pratique avec Gallimard, je ne suis pas regardant avec les autres éditeurs. Mes Virginie Despentes, chez Grasset, restent dans leurs habits bariolés et je les trouve bien beaux ainsi ! Deux poids, deux mesures.
Mais il faut croire que mon problème est lié à Gallimard puisque avec les Pléiade, là encore je m’interroge toujours : faut-il conserver les bouquins dans leur coffret cartonné ou non ? Quand j’observe les bibliothèques d’écrivains dans les magazines ou reportages à la télévision, leurs Pléiade ne sont jamais dans les coffrets. Pourtant ils sont terriblement bien pratiques ces boitiers, outre qu’ils assurent une protection maximum et conservent au livre une valeur marchande qu’on ne doit pas sous-estimer, on peut d’un coup d’œil y lire au dos, la liste des œuvres contenues dans le bouquin sans avoir à l’ouvrir ou le feuilleter. Par conséquent, moi je conserve toute ma collection dans leurs boites blanches.
Il va sans dire que vont également directement à la poubelle, les bandeaux ceignant quelquefois les livres pour mettre en valeur un prix gagné ou bien tenter de les distinguer des autres sur les tables encombrées des librairies.
Je vous ai dévoilé mes pratiques, et vous, quelle est votre position concernant la jaquette ?
23/07/2017 | Lien permanent | Commentaires (5)
Glendon Swarthout : Homesman
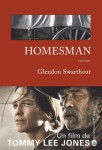 Glendon Swarthout (1918-1992) est un écrivain américain, auteur de romans de westerns et de polars. Professeur d'anglais à l'Université Concordia Ann Arbour, dans le Michigan, il publie son premier roman en 1943. Il écrit ensuite pour le théâtre. En 1958, Ceux de Cordura lui vaut la notoriété quand ce roman est adapté au cinéma l'année suivante, sous le titre éponyme, par Robert Rossen. En 1975, Glendon Swarthout fait paraître Une gâchette (The Shootist) adapté au cinéma par Don Siegel sous le titre Le Dernier des géants. Son roman, Homesman, est paru en 1988 et vient d'être réédité.
Glendon Swarthout (1918-1992) est un écrivain américain, auteur de romans de westerns et de polars. Professeur d'anglais à l'Université Concordia Ann Arbour, dans le Michigan, il publie son premier roman en 1943. Il écrit ensuite pour le théâtre. En 1958, Ceux de Cordura lui vaut la notoriété quand ce roman est adapté au cinéma l'année suivante, sous le titre éponyme, par Robert Rossen. En 1975, Glendon Swarthout fait paraître Une gâchette (The Shootist) adapté au cinéma par Don Siegel sous le titre Le Dernier des géants. Son roman, Homesman, est paru en 1988 et vient d'être réédité.
Au cœur des grandes plaines de l'Ouest, au milieu du XIXe siècle, Mary Bee Cuddy est une ancienne institutrice solitaire qui a appris à cultiver sa terre et à toujours laisser sa porte ouverte. Cette année-là, quatre femmes, brisées par les conditions de vie extrêmes en hiver et un choc psychologique dramatique ont perdu la raison, « L’une a assassiné son bébé. La deuxième a eu tellement la frousse des loups qu’elle est devenue timbrée. Une autre a essayé de descendre son gars. La plus jeune, elle a perdu trois gamins en deux jours. De la diphtérie. ». A l’initiative du pasteur qui a déjà testé la méthode l’année précédente, la solution consiste à rapatrier les démentes vers l'Est, vers leurs familles et leurs terres d'origine. Mary Bee accepte d'effectuer ce voyage de plusieurs semaines à travers le continent américain. Pour la seconder, Briggs, un bon à rien, voleur de concession voué à la pendaison, devra endosser le rôle de « rapatrieur » (Homesman, néologisme inventé par l’auteur) et l'accompagner dans son périple de cinq semaines à travers le Missouri.
Tout le roman tourne autour des rapports entre Mary Bee et Briggs. Elle, c’est l’honnête femme attachée aux règles d’humanité et à la compassion chrétienne ; lui, sauvé de la pendaison in extremis, est un vieux loup solitaire qui ne se fixe jamais, a beaucoup roulé sa bosse et connait tous les trucs de survie dans ces grands espaces, « C’était un homme sûr de lui. Il n’avait peur de rien, pas même des mots. Et il puisait sa force à la source de l’ignorance. » La seule arme que possède Mary Bee pour s’assurer que Briggs remplira sa mission, la promesse qu’il lui a faite après que sa vie ait été sauvée et une somme d’argent versée à l’arrivée. Mais que vaudront ces arguments quand la petite troupe devra affronter les mauvaises rencontres et la folie dangereuse des convoyées ?
Ecriture sèche et rythme enlevé, de nombreuses séquences très visuelles d’où son adaptation cinématographique. Mais aussi des situations prévisibles ou limite nunuches contrebalancées par des rebondissements (dont un magistral à l’approche de la fin que je vous laisse découvrir) inattendus. On pourra aussi s’interroger sur la psychologie des personnages, un peu datée pour le lecteur d’aujourd’hui. Un bon roman c’est certain, mais dont j’attendais mieux encore au vu de son scénario.
« C’était une complainte d’un tel désespoir qu’elle déchirait le cœur et enfonçait ses crocs au plus profond de l’âme. Mary Bee porta les mains à ses oreilles. Des larmes lui dévalaient le long de ses joues, les larmes qu’elle avait retenues et accumulées la veille et au cours de la journée. C’était comme si les créatures tragiques à l’intérieur du chariot comprenaient enfin ce qui leur arrivait : qu’on les arrachait à tous ceux qu’elles aimaient, à leurs hommes, à leurs enfants, vivants ou morts ; à tout ce qu’elles aimaient, à leurs graines de fleurs, à leurs bonnets et à leurs alliances – pour ne plus jamais revenir. Le chariot grondait. Mary Bee sanglotait. Briggs poussait les mules. Les femmes continuaient à gémir. A gémir. »
 Glendon Swarthout Homesman Gallmeister – 281 pages
Glendon Swarthout Homesman Gallmeister – 281 pages
Nouvelle traduction de l’américain par Laura Derajinski (Première publication française en 1992 aux Presses de la Cité sous le titre Le Chariot des damnées)
L'adaptation cinématographique de ce roman par Tommy Lee Jones, qui joue aux côtés d'Hilary Swank et de Meryl Streep, vient d’être présentée au Festival de Cannes et sort demain en salles.
20/05/2014 | Lien permanent | Commentaires (12)


