Rechercher : larmes blanches
Kenzaburô Ôé : Une Affaire personnelle
 Kenzaburô Ôé est né en 1935 dans l'île de Shikoku au Japon. Il étudie la littérature française et soutient une thèse sur Jean-Paul Sartre. Ses premiers textes paraissent dans les années 1950 et en 1958 il reçoit le prix Akutagawa, l'équivalent du prix Goncourt, pour Gibier d'élevage. Son œuvre, romans, nouvelles et essais, le place au premier rang de la littérature japonaise et lui vaut le prix Europalia en 1989, avant de recevoir le prix Nobel de littérature en 1994.
Kenzaburô Ôé est né en 1935 dans l'île de Shikoku au Japon. Il étudie la littérature française et soutient une thèse sur Jean-Paul Sartre. Ses premiers textes paraissent dans les années 1950 et en 1958 il reçoit le prix Akutagawa, l'équivalent du prix Goncourt, pour Gibier d'élevage. Son œuvre, romans, nouvelles et essais, le place au premier rang de la littérature japonaise et lui vaut le prix Europalia en 1989, avant de recevoir le prix Nobel de littérature en 1994.
Une affaire personnelle, paru en 1964, est effectivement un roman très personnel pour l’écrivain puisqu’inspiré de la naissance de son fils handicapé, l’année précédente.
Bird, le héros de ce roman, vingt-sept ans, est répétiteur dans une boîte à bachot et sa femme vient d’accoucher de leur premier enfant, atteint d’une malformation, « Le cerveau fait saillie par une brèche du crâne… », une hernie cérébrale.
Le roman se déroule durant les trois jours qui suivent, décrivant les tourments moraux par lesquels passera Bird concernant l’avenir éventuel de cet enfant. La mère n’est pas précisément informée, son enfant ayant été éloigné pour un soi-disant petit problème de santé. Le héros du bouquin n’est pas franchement sympathique, ancien alcoolique, il paraît très éloigné de la vie concrète – il rêve d’un voyage en Afrique, projet à priori inabordable pour lui -, toujours mal à l’aise, peu sûr de lui, on a l’impression qu’il glande, refusant de se colleter avec la réalité, égoïste (« Bird, penses-tu jamais à quoi que ce soit, en dehors de toi-même ? »), lâche aussi (« Je me demande, dit-elle, si tu n’es pas le genre d’hommes qui abandonnent ceux qui ont le plus besoin d’eux… »). Du moins est-ce le portrait qui se dessine en creux au vu de ses hésitations ou des réflexions émises par les autres.
Délaissant sa femme encore en clinique et veillée par sa mère, il renoue avec une ancienne amie, Himiko, veuve d’un mari suicidé, et qui mène désormais une vie très libre… ce qui nous vaut une scène très Empire des Sens (film de Nagisa Oshima, 1976). On notera que Kenzaburô Ôé appelle un chat, un chat, et ne s’embarrasse pas de pudeurs ou de détours pour décrire, du vomi ou autres détails du genre. Sexe avec Himiko mais compliqué par l’état psychologique de Bird, ce qui étend le domaine d’activité de la jeune femme devenue sa confidente, voire psychanalyste, n’hésitant pas à s’engager à son côté pour l’aider à résoudre son dilemme : « je ne suis ni assez diabolique pour étrangler ce bébé de mes mains ni assez angélique pour mobiliser une armée de médecins et les supplier de sauver la vie d’un enfant condamné à être un monstre… »
Je tairai la fin du roman pour vous en laisser la surprise ( ?) mais disons que Bird, saura in extremis, se racheter des défauts qu’on pouvait lui attribuer jusque là.
Roman japonais, donc traité à la japonaise : le lecteur se sent toujours à l’extérieur, comme voyeur d’une intrigue qui le désarçonne un peu car rédigée d’une manière tellement différente de ce qu’en aurait écrit un écrivain occidental, ici pas de larmes ou d’émotions dégoulinantes, absence d’empathie ou plus exactement, des liens entre les acteurs hors de nos schémas culturels. Du coup le bouquin parait un peu fade à le lire, ne prenant de l’ampleur qu’une fois terminé quand le lecteur se le remémore et le traduit dans ses propres mots et sentiments. C’est aussi ça l’intérêt de la littérature, nous permettre des incursions dans les mentalités étrangères.
« - Eh bien ? Voulez-vous voir la chose ? Le jeune médecin assis à la droite du directeur se leva. C’était un grand type maigre, au visage bizarrement asymétrique : un de ses yeux avait une expression timide et inquiète, l’autre un regard absent. Bird mit un moment à se rendre compte que c’était un œil de verre. – Pourriez-vous d’abord m’expliquer ? demanda Bird avec une pointe d’angoisse dans la voix. Le mot qu’avait utilisé le directeur (la « chose ») avait suscité en lui une répulsion qui ne se dissipait pas. – Cela vaudrait peut-être mieux, oui. Quand vous le verrez, vous risquez d’être surpris, comme je l’ai été moi-même. »
 Kenzaburô Ôé Une Affaire personnelle Folio – 211 pages –
Kenzaburô Ôé Une Affaire personnelle Folio – 211 pages –
Traduit de l’anglais par Claude Elsen
03/10/2016 | Lien permanent | Commentaires (2)
Hans Fallada : Du bonheur d’être morphinomane
 Hans Fallada est le pseudonyme de l'écrivain allemand Rudolf Ditzen (1893-1947). Rudolf Ditzen naît dans une famille aisée mais a des relations conflictuelles avec elle. En 1911 suite à une sombre affaire de suicide d’un de ses amis, maquillé en duel dans lequel il est gravement blessé, Fallada est inculpé de meurtre et interné dans une clinique psychiatrique à Iéna pour une courte durée. Il abandonne ses études secondaires sans diplôme et fait un apprentissage agricole. De 1913 à 1928, il occupe des emplois divers dans ce secteur, sans être requis plus de quelques jours pendant la Première Guerre mondiale. De 1917 à 1919, il suit plusieurs cures de désintoxication (alcool et morphine) et par la suite il est à plusieurs reprises mis en prison. En 1929, il se marie et aura trois enfants, époque à partir de laquelle il travaille dans les secteurs de l'édition et du journalisme, jusqu'à ce qu'il puisse vivre de ses droits d'auteur. Hospitalisé en raison de ses problèmes d'addiction, Hans Fallada meurt d'un arrêt cardiaque le 5 février 1947.
Hans Fallada est le pseudonyme de l'écrivain allemand Rudolf Ditzen (1893-1947). Rudolf Ditzen naît dans une famille aisée mais a des relations conflictuelles avec elle. En 1911 suite à une sombre affaire de suicide d’un de ses amis, maquillé en duel dans lequel il est gravement blessé, Fallada est inculpé de meurtre et interné dans une clinique psychiatrique à Iéna pour une courte durée. Il abandonne ses études secondaires sans diplôme et fait un apprentissage agricole. De 1913 à 1928, il occupe des emplois divers dans ce secteur, sans être requis plus de quelques jours pendant la Première Guerre mondiale. De 1917 à 1919, il suit plusieurs cures de désintoxication (alcool et morphine) et par la suite il est à plusieurs reprises mis en prison. En 1929, il se marie et aura trois enfants, époque à partir de laquelle il travaille dans les secteurs de l'édition et du journalisme, jusqu'à ce qu'il puisse vivre de ses droits d'auteur. Hospitalisé en raison de ses problèmes d'addiction, Hans Fallada meurt d'un arrêt cardiaque le 5 février 1947.
Du bonheur d’être morphinomane, recueil de nouvelles, vient d’être réédité en collection de poche. Des textes regroupés en six grands thèmes : Les addictions, Les garnements, A la campagne, Vie de couple, Avec le petit homme, Voyous truands et autres voleurs. Le titre de l’ouvrage est à prendre comme un euphémisme, bien entendu, mais il traduit bien l’état d’esprit de l’écrivain, ironique et autocritique, car Fallada sait de quoi il parle, lui-même drogué et alcoolique, « Cela fait sept ans que je suis enchaîné à l’addiction, un jour à la morphine, un autre à la cocaïne, une fois à l’éther, une autre à l’alcool. »
Six thèmes, donc les addictions ne sont qu’une partie de ce recueil. L’ensemble par contre, ce sont beaucoup de faits tirés de sa propre vie faite de plus de bas que de hauts, l’écrivain n’hésitant pas parfois à se nommer dans ses écrits. Et quand il ne s’agit pas de Hans Fallada, les autres personnages sont tout aussi pittoresques, issus du petit peuple, rarement exemplaires mais toujours attachants néanmoins : un alcoolique cherche à se faire emprisonner pour arriver enfin à se désintoxiquer, une paysanne au mari jaloux perd son alliance pendant la récolte des pommes de terre, un cambrioleur rêve de retourner en prison où la vie est finalement si tranquille, un mendiant vend sa salive porte-bonheur...
Jamais l’écrivain ne cherche à se disculper ou cacher ses faiblesses (ou celles de ses personnages), jamais il ne cherche à vous tirer une larme de compassion, il dit ce qui est, clairement et lucidement, d’une écriture d’une grande limpidité et non sans humour ; des textes riches en informations sur la situation sociale de son époque et d’un point de vue scénaristique, ses nouvelles sont particulièrement bien torchées.
Si vous ne connaissez pas Hans Fallada, peut-être est-ce le bouquin qu’il vous faut pour l’aborder en douceur car tôt ou tard, il vous faudra lire cet écrivain.
« Les choses sont comme ça : avant, quand Möcke avait encore du travail, il ouvrait souvent aux mendiants, et quand ceux-ci lui débitaient leur litanie sur le mode chômeur, Herr Möcke disait brièvement : « Désolé, je suis moi-même chômeur. » Lorsqu’il devint vraiment chômeur, il passa quelques nuits sans dormir, à ruminer : je n’aurais jamais dû dire ça. C’est moi qui ai provoqué le chômage. Ce salaud de Wrede n’est pas le seul responsable, j’ai provoqué tout ça à cause de mes bêtises. Depuis les Möcke n’ouvrent plus du tout aux mendiants. Ils regardent d’abord par le judas pour savoir qui sonne à leur porte. » [Le Mendiant porte-bonheur]
 Hans Fallada Du bonheur d’être morphinomane Folio – 400 pages –
Hans Fallada Du bonheur d’être morphinomane Folio – 400 pages –
Traduit de l’allemand par Laurence Courtois
04/11/2016 | Lien permanent | Commentaires (3)
Charles Frazier : A l’orée de la nuit
 Charles Frazier, né en 1950 à Asheville en Caroline du Nord, est un romancier américain. Il élève actuellement des chevaux dans une ferme près de Raleigh en Caroline du Nord, où il vit avec sa fille et son épouse qui enseigne la comptabilité. Son premier roman, Cold Mountain (1997), l’a propulsé aux premiers rangs des grands écrivains américains contemporains, surtout après qu’il ait été adapté au cinéma par le cinéaste britannique Anthony Minghella en 2004 avec Jude Law et Nicole Kidman à l’affiche. Son troisième ouvrage, A l’orée de la nuit, est paru en 2014.
Charles Frazier, né en 1950 à Asheville en Caroline du Nord, est un romancier américain. Il élève actuellement des chevaux dans une ferme près de Raleigh en Caroline du Nord, où il vit avec sa fille et son épouse qui enseigne la comptabilité. Son premier roman, Cold Mountain (1997), l’a propulsé aux premiers rangs des grands écrivains américains contemporains, surtout après qu’il ait été adapté au cinéma par le cinéaste britannique Anthony Minghella en 2004 avec Jude Law et Nicole Kidman à l’affiche. Son troisième ouvrage, A l’orée de la nuit, est paru en 2014.
Au cœur des Appalaches, Luce une jeune femme au passé difficile après un viol, vit seule en pleine cambrousse, jusqu’au jour où l’administration lui confie la garde de Franck et Dolorès, les deux gamins jumeaux de sa sœur Lily, assassinée par Bud son époux, sous leurs yeux. Les deux gosses traumatisés, se sont retranchés dans le mutisme et des réactions imprévisibles autant que violentes. La vie de Luce va se retrouver chamboulée à un plus d’un titre. Devoir rééduquer les deux enfants, si c’est encore possible ; gérer les approches bienveillantes de Stubblefield, son nouveau propriétaire, alors qu’elle fuit les hommes depuis plusieurs années ; et surtout, faire face à une menace mortelle, le retour au pays de Bud, innocenté par la justice, venu reprendre un magot (produit de ses rapines) qu’il pense détenu par les mômes…
Passons rapidement sur la vague ressemblance entre cette course au magot et le célèbre film, La Nuit du chasseur avec Robert Mitchum. Une parenté évidente mais sans suite, point final. Quand un roman débute par une phrase aussi simple mais aussi lourde de sous-entendu que : « Les nouveaux enfants adoptifs de Luce étaient beaux, menus et violents » vous pouvez vous attendre à un bon bouquin, la suite vous démontrera que vous étiez en-dessous de la vérité. Tout est parfait dans ce roman !
J’ai adoré le style et l’écriture de Charles Frazier, très détaillée de ces détails qui trahissent le vécu ; exsudant un amour immodéré pour la nature ; et ce rythme – un aspect auquel je suis particulièrement sensible – que je qualifierai de majestueux, c'est-à-dire pas très rapide mais loin d’être mou, fait de phrases bien dimensionnées procurant à la lecture, l’équivalence d’un bon vin restant en bouche lors d’une dégustation. La narration avance, envoûtante, car le récit s’enrichit à posteriori d’informations cruciales sur les liens entre tel ou tel, ou bien de pans de vie de chaque acteur, ce qui renforce la dramaturgie. De plus l’écrivain néglige une chronologie basique trop simple tout en évitant une alternance de passé/présent bien usée, il mène sa barque, et nous avec, dans une voie médiane plus attrayante intellectuellement parlant.
Jamais l’écrivain ne force le trait, il y a de la violence, une poursuite, du suspense, mais pas dans le sens traditionnel d’un thriller, Charles Frazier la joue plus subtile, utilisant la fascination pour sidérer son lecteur. Même la fin est réussie, un écueil particulièrement coriace en général mais ici, bien négocié.
J’ai emprunté ce livre à ma médiathèque municipale, en fin d’ouvrage sur le petit carton réservé aux avis des lecteurs, quelqu’un a écrit « Ennuyeux ». Comment peut-on porter un tel jugement sur ce roman ? Personnellement, je le trouve magnifique pour ne pas dire plus.
« Après l’incident du bain, Luce ne revit jamais les enfants pleurer. Ce n’était pas pour eux un moyen de communiquer. Ils exprimaient leurs émotions par des biais autres que les gémissements, les tremblements du menton et les larmes. Parfois ils te sautaient dessus, les poings serrés, pour essayer de se battre avec toi. Parfois, aussi, ils détalaient vers la forêt. Ils émettaient un son semblable à un grognement, et puis divers hurlements, hululements et cris aigus. Ou alors, ils te coulaient un regard assassin qui suggérait que, s’ils avaient pesé cinquante kilos de plus, ils t’auraient tuée sur-le-champ. »
 Charles Frazier A l’orée de la nuit Grasset – 383 pages –
Charles Frazier A l’orée de la nuit Grasset – 383 pages –
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Brice Matthieussent
27/07/2015 | Lien permanent | Commentaires (2)
David Goodis : Vendredi 13
 David Goodis (1917- 1967), est un écrivain américain de roman noir. David Loeb Goodis fréquente brièvement l'université de l'Indiana avant de terminer ses études en journalisme à l'université Temple en 1938. Peu après, il se trouve un emploi dans une agence de publicité et, pendant ses temps libres, rédige un grand nombre de nouvelles policières pour diverses publications. Il publie son premier livre en 1938 mais c’est en 1946 avec la publication de Cauchemar (Dark Passage) qu’arrive le succès et l'adaptation de ce récit en 1947, sous le titre Les Passagers de la nuit avec Humphrey Bogart et Lauren Bacall, lui permet de signer un lucratif contrat de six ans avec la Warner Bros, mais la plupart des scénarios qu'il écrit pour le studio ne dépassent pas l'étape de la rédaction. Oublié dans son pays natal, David Goodis doit son succès en France à l'adaptation de plusieurs de ses livres au cinéma, notamment de Tirez sur le pianiste par François Truffaut en 1960. Vendredi 13 paru initialement en 1955, vient de faire l’objet d’une toute nouvelle réédition.
David Goodis (1917- 1967), est un écrivain américain de roman noir. David Loeb Goodis fréquente brièvement l'université de l'Indiana avant de terminer ses études en journalisme à l'université Temple en 1938. Peu après, il se trouve un emploi dans une agence de publicité et, pendant ses temps libres, rédige un grand nombre de nouvelles policières pour diverses publications. Il publie son premier livre en 1938 mais c’est en 1946 avec la publication de Cauchemar (Dark Passage) qu’arrive le succès et l'adaptation de ce récit en 1947, sous le titre Les Passagers de la nuit avec Humphrey Bogart et Lauren Bacall, lui permet de signer un lucratif contrat de six ans avec la Warner Bros, mais la plupart des scénarios qu'il écrit pour le studio ne dépassent pas l'étape de la rédaction. Oublié dans son pays natal, David Goodis doit son succès en France à l'adaptation de plusieurs de ses livres au cinéma, notamment de Tirez sur le pianiste par François Truffaut en 1960. Vendredi 13 paru initialement en 1955, vient de faire l’objet d’une toute nouvelle réédition.
Hart, le héros du roman recherché par la police pour le meurtre, erre dans les rues de Philadelphie en plein hiver, sans un sou et peu vêtu. Pris par hasard dans un règlement de comptes et pour échapper à une mort certaine, il tente de se faire passer pour un truand – qu’il n’est pas - afin d’être accepté par la bande et échapper aux flics par la même occasion.
Si l’on excepte deux courtes séquences, l’une en introduction et l’autre vers la fin du roman, il s’agit d’un huis-clos pour un polar qui s’apparente au roman psychologique. Sept personnages, planqués dans une maison en attendant de préparer un cambriolage. Il y a Hart, au début prisonnier de cette bande de gangsters ; Charley en est le chef, un type à qui on le la fait pas, ses acolytes, Paul un jeune gars blessé à mort, Mattone la brute qui ne peut pas piffrer Hart, Rizzio l’homme à tout faire, et deux femmes, Frieda la poule à Charley et Myrna la sœur de Paul.
David Goodis s’intéresse aux relations entre les uns et les autres qui vont évoluer au cours du récit. Charley va-t-il faire confiance à Hart ? Comment va réagir Mattone ? Mais bien sûr, le plus subtil est à venir avec les deux femmes : Frieda va en pincer grave pour Hart et Myrna en vouloir à Hart car il sera responsable de la mort de Paul… Sauf que Hart ne veut pas d’embrouilles avec Charley et n’a aucun sentiment pour Frieda, laquelle connait partiellement le secret lié au meurtre commis par Hart ce qui pourrait lui valoir l’inimitié de Charley ; et de son côté Myrna balance, « elle ne veut pas m’assassiner. Et, en même temps, elle le veut. » Complications à tous les étages pour Hart – qui n’est pas un méchant homme comme on le découvrira – et va devoir la jouer fine pour se sortir (s’il s’en sort ?) du pétrin dans lequel il s’est fourré. Et comme nous sommes dans un polar, des cadavres viendront prendre place dans le décor.
L’écriture est assez moderne et ne nécessite pas d’efforts pour la replacer dans son contexte historique. On s’amusera en remarquant l’utilisation fréquente de pyjamas (surtout dans un polar !) à moins qu’on ne ricane devant ce que j’imagine être de l’humour aux dépens de la brute Mattone, « Ses yeux s’emplirent de larmes. – C’est toujours moi qui prends, gémit-il. Pourquoi toujours moi ? »
Un très bon roman, un classique du polar.
« Ils entrèrent dans la chambre du fond. Paul gisait tout nu sur le lit ; ses yeux mi-clos ne semblaient pas faire partie de son visage. – Prends-le par les jambes, dit Charley. Ils le portèrent au rez-de-chaussée. Hart frissonnait comme un malade. Il essaya de se convaincre que c’était à cause du froid. Ils descendirent l’escalier de la cave et déposèrent Paul près de la chaudière. (…) Peu après Charley apparut au bas de l’escalier, armé d’une scie à métaux dans une main et d’un énorme couteau dans l’autre. – Apporte-moi des journaux, dit-il. »
 David Goodis Vendredi 13 Folio – 214 pages –
David Goodis Vendredi 13 Folio – 214 pages –
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par François Gromaire. Traduction révisée par Isabelle Stoïanov
24/10/2016 | Lien permanent
David Vann : Goat Mountain
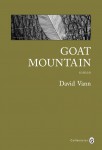 David Vann, né en 1966 sur l'Île Adak en Alaska, est un écrivain américain. En France, la publication de Sukkwan Island en 2010 rencontre un fort succès critique autant que public ce qui lui vaut le prix Médicis étranger. Il partage désormais son temps entre la Nouvelle-Zélande où il vit et l'Angleterre où il enseigne tous les automnes la littérature. Quatrième roman de l’écrivain traduit en français, Goat Mountain vient de sortir en librairies.
David Vann, né en 1966 sur l'Île Adak en Alaska, est un écrivain américain. En France, la publication de Sukkwan Island en 2010 rencontre un fort succès critique autant que public ce qui lui vaut le prix Médicis étranger. Il partage désormais son temps entre la Nouvelle-Zélande où il vit et l'Angleterre où il enseigne tous les automnes la littérature. Quatrième roman de l’écrivain traduit en français, Goat Mountain vient de sortir en librairies.
Automne 1978, nord de la Californie. C’est l’ouverture de la chasse sur les deux cent cinquante hectares du ranch de Goat Mountain où un garçon de onze ans, son père, son grand-père et un ami de la famille, Tom (seul personnage nommé dans le roman), se retrouvent comme chaque année pour chasser. À leur arrivée, les quatre hommes aperçoivent au loin un braconnier qu’ils observent à travers la lunette de leur fusil. Le père invite son fils à tenir l’arme et à venir regarder. Et l’irréparable se produit.
Si il y a une chose dont on peut être certain quand on ouvre un roman de David Vann, c’est qu’on ne va pas se marrer, et là, je dois dire qu’il fait très fort, au point que je dois immédiatement prévenir les âmes sensibles, inutile de vous lancer dans l’aventure. Pour les autres, pincettes et gants chirurgicaux ne seront pas un luxe superflu.
Roman à la limite du soutenable dans des scènes et des situations hors du commun ; roman extrêmement fort et puissant sur le fond et les idées qu’il véhicule. On se souvient de la fin d’Apocalypse Now et Marlon Brando scandant « L’horreur, l’horreur…», avec ce roman nous y sommes. Le meurtre du braconnier n’est qu’un hors d’œuvre, il faut voir ce qu’il va advenir du cadavre de l’homme et ce sommet éprouvant quand l’enfant abattra son premier cerf, un carnage répugnant suivi du rite initiatique cannibale que je vous laisse découvrir. Sans parler des rapports de haine/amour/force qui vont s’établir entre les acteurs, les poussant à s’entredéchirer et plus encore quand ils devront décider de la conduite à tenir après le meurtre du braconnier. Et comme si les images n’étaient pas assez fortes, David Vann pousse le curseur à fond en développant ses théories ou ses interrogations sur la valeur de la vie humaine et sur l’acte de tuer, convoquant l’Ancien Testament avec Abel et Caïn dans ce qui s’apparente à un long délire mystique, faisant de ce bouquin l’ultime volet d’une cure psychanalytique étalée sur quatre romans, « Ce roman consume les derniers éléments qui, à l’origine, m’ont poussé à écrire : les récits sur ma famille et sa violence » avoue l’auteur dans sa postface. J’avoue ne pas être mécontent de savoir que l’écrivain va s’engager sur d’autres voies dans le futur.
J’ai été pétrifié durant la lecture de ce livre, les images sont horribles, l’écriture est hachée comme éructée, certaines phrases pas très claires, le propos provocant (pourquoi s’étonner d’un homme abattu mais pas d’un cerf ?), voire illuminé « En tuant le braconnier, j’étais comme David, défendant ma famille, notre terre et la loi. J’étais dans le camp de dieu. » Quelle part de l’animal subsiste dans l’homme ? Mais j’ai aussi été gêné par l’outrance globale, le grandguignolesque de certaines situations et la crédibilité douteuse d’autres qu’il ne faut pourtant pas prendre au premier degré, le bouquin devant se concevoir comme un drame antique ou une fable.
Roman extrêmement dur, portant un éclairage troublant et embarrassant sur les lois morales de nos sociétés.
« De profondes expirations, des renâclements dans la poussière, et il était comme embourbé là. Je voyais bien qu’une part de lui-même avait juste envie d’en finir, de s’étendre et d’attendre la mort. Une part de lui-même savait que c’était terminé. Je n’avais rien ressenti en tuant le braconnier, mais c’était désormais différent. Je voyais ce que ressentait le cerf, la catastrophe, une si grande perte, aucun espoir de s’en remettre, la fin d’une vie. Je ressentais cette fin. Nous chassons les grands animaux car ce sont eux qui nous ressemblent le plus. »
 David Vann Goat Mountain Gallmeister – 247 pages –
David Vann Goat Mountain Gallmeister – 247 pages –
Traduit de l’américain par Laura Derajinski
15/09/2014 | Lien permanent | Commentaires (2)
Matthew Neill Null : Allegheny River
 Né en 1984, Matthew Neill Null a étudié le « creative writing » à l’université de l’Iowa puis à celle de l’université de Provincetown dans le Massachusetts où actuellement où il coordonne un master d’écriture. Après un premier roman (Le Miel du lion) paru en 2018, arrive Allegheny River, un recueil de nouvelles, soit neuf textes, parus précédemment dans diverses revues et magazines américains.
Né en 1984, Matthew Neill Null a étudié le « creative writing » à l’université de l’Iowa puis à celle de l’université de Provincetown dans le Massachusetts où actuellement où il coordonne un master d’écriture. Après un premier roman (Le Miel du lion) paru en 2018, arrive Allegheny River, un recueil de nouvelles, soit neuf textes, parus précédemment dans diverses revues et magazines américains.
Je découvre aujourd’hui Matthew Neill Null et j’avoue être estomaqué par le talent de cet écrivain. Que cette année 2020 commence bien !
Neuf nouvelles qui se déroulent au cœur des Appalaches, cette chaîne de montagnes située dans l'Est de l'Amérique du Nord et ici plus particulièrement en Virginie-Occidentale ou Pennsylvanie. Toutes se passent en pleine nature, dans des coins perdus et des décors de montagnes ou rivières. On va à la chasse à l’ours ou bien l’on tente d’en réguler la population, on étudie le déplacement des truites dans une rivière ; ou bien c’est un jeune gars qui s’initie au flottage du bois, à moins que ce ne soit un commis voyageur qui tente de vendre une charrue à des fermiers roublards…
Là, je vous devine faire une moue convenue du genre, il va nous refourguer du Nature Writting comme souvent. Ce n’est pas faux, en partie, sauf qu’ici nous sommes dans de l’exceptionnel, je dirais même de l’innovant car – certes, mon expérience de lecteur à ses limites – l’écriture de ce nouveau venu vous réservera de magnifiques surprises.
Je ne citerai que deux des nouvelles qui m’ont terrassé afin que vous puissiez tester en librairie, le bien-fondé de mon enthousiasme : La Saison de Gauley, où dans un bled perdu à bout de ressources (« Nous qui avions perdu nos emplois dans les mines allions désormais nous réorienter dans le sport en eau vive, labourer ce sillon liquide ») on se lance dans le rafting qui attire les touristes, mais un accident dramatique va entacher l’affaire. Une nouvelle d’une intensité dramatique à vous tirer les larmes, ma préférée peut-être. L’Île au milieu de la rivière est elle aussi très belle. Sur une île au milieu d’une rivière donc, un hospice de mourants contagieux. Une gamine et un gamin, chacun sur sa rive, amours enfantines mais l’innocence est traître, le message envoyée par-dessus les flots par la petite va contaminer la famille du gosse et implanter le drame. Là encore, nous touchons au sublime.
Toutes les histoires sont originales mais au-delà, elles s’inscrivent le plus souvent dans un contexte social (misère des petits fermiers, mines de charbon ayant fermé…) étayé par une écriture particulièrement riche en détails, d’une précision parfaite et au vocabulaire soigné (« … ses cheveux s’entortillaient en zostères autour de nos mains et de nos bras, auxquels ils s’agrippaient obstinément. ») L’écrivain sait marier le réalisme du reportage journalistique au lyrisme du récit, tout en maniant l’ellipse courte ou le raccourci qui déstabilisent légèrement le lecteur. Des nouvelles à la construction insolite qui chez d’autres s’appelleraient des rebondissements mais ici c’est beaucoup plus subtil. Du très grand art.
Je ne m’emballe pas souvent, alors croyez moi, ne ratez surtout pas ce bouquin. Si tous les écrivains écrivaient comme ce Null, la vie serait belle au pays des lecteurs.
« Son père piégeait des renards et abattait des rapaces du temps où l’on pouvait encore gagner de l’argent avec cette activité – en vendant les peaux ou en touchant les primes promises par l’Etat. Des familles entières participaient à ce commerce, entassant au bord des chemins infestés de mouches des piles de cadavres raidis : renards, faucons, aigles – des aigles ! -, hiboux, coyotes, ratons laveurs, ours et lynx. Les agents du gouvernement et les marchands de fourrures débarquaient toutes les deux semaines avec de grosses liasses de billets qui permettaient à beaucoup de s’acheter de quoi manger, même à l’époque de la Grande Dépression, puis ils repartaient à bord de chariots repus d’hémoglobine, aux planches parcheminées par le sang séché. (…) C’est grâce à cela, mais aussi aux maigres récoltes qu’ils tiraient de ce sol peu fertile et aux emplois offerts par le programme gouvernemental du Civilian Conservation Corps, qu’ils arrivaient à survivre. »
 Matthew Neill Null Allegheny River Albin Michel – 271 pages – (A paraître le 2 janvier 2020)
Matthew Neill Null Allegheny River Albin Michel – 271 pages – (A paraître le 2 janvier 2020)
Traduit de l’américain par Bruno Boudard
30/12/2019 | Lien permanent | Commentaires (4)
Eric Chevillard : Oreille rouge
 Eric Chevillard, né en 1964 à La Roche-sur-Yon, est un écrivain français auteur de très nombreux ouvrages. Son roman, Oreille rouge, date de 2005.
Eric Chevillard, né en 1964 à La Roche-sur-Yon, est un écrivain français auteur de très nombreux ouvrages. Son roman, Oreille rouge, date de 2005.
Le héros du roman est un écrivain invité au Mali pour une résidence d’écriture. Certains sauteraient au plafond d’excitation, pas lui. Notre homme aime ses habitudes et n’est pas un fanatique des voyages (« Au nom de quoi faudrait-il partir ? Et s’il était plus aventureux de rester ? ») mais finalement il va se décider favorablement. Déjà on commence à cerner le bonhomme, les préparatifs ne sont pas une mince affaire pour lui, passeport, vaccins, penser à emporter tout un tas de médicaments… Un début d’intérêt pour ce voyage commence à poindre quand il annonce autour de lui qu’il va partir pour l’Afrique, ça lui donne une petite importance.
Un gentil petit roman qui a certainement beaucoup amusé Eric Chevillard quand il l’a écrit. Le texte est en trois parties, avant, pendant et après le voyage, fait de très courts paragraphes enchainant faits et réflexions divers, toujours sur un mode humoristique léger (« La grenouille ne risquait pas de se faire aussi grosse que le bœuf dans la fontaine : la chose eut donc lieu dans le fleuve. »).
Le thème du bouquin est donc le voyage. Le voyage vers l’exotique Afrique et qui plus est, par un écrivain sensé en retirer quelque chose, genre littérature de voyage. Notre homme se propose ainsi d’écrire le grand poème de l’Afrique, pas moins. Vous l’avez compris, Eric Chevillard fait dans la satire, satire douce et molle, mais satire quand même.
Muni d’un petit carnet en moleskine, l’arme absolue de l’écrivain-voyageur, notre homme au Mali y consigne des faits insignifiants, compile les idées reçues et les images convenues, tout en s’imaginant et s’étonnant lui-même d’être un grand voyageur. Venir ici et ne pas croiser d’hippopotames, serait une hérésie, vous allez tout savoir du bestiau en lisant ce bouquin. De retour en France, tout comme les soirées diapos d’autrefois saoulaient les malheureux amis conviés, la ramener sans arrêt pour tout et n’importe quoi, en se référant au Mali finit par lasser les proches les plus aimables.
Notons que certains passages sont assez poétiques, litote polie pour dire qu’on ne comprend pas trop ce que veux dire l’écrivain à cet instant. Alors que dire pour conclure ? Certes c’est amusant et souvent bien vu mais comment dire, c’est un peu lisse, ça manque d’aspérités (dans le sens positif ou négatif) pour en faire une tartine.
« Je passerais volontiers le restant de mes jours dans un de vos jolis petits greniers à mil ! s’écrie-t-il. C'est-à-dire qu’il y tiendrait une heure, puis ferait jouer son assurance rapatriement. Il circule parmi les étals avec l’air faussement préoccupé d’un qui vaque à de très importantes affaires pour cacher son malaise. La viande et le poisson sont frais pourtant : ils bourdonnent encore. Oreille rouge jaunissant presse le pas mais son nez ne saurait être aussi distrait que son œil qui se détourne et devient blanc. C’est ainsi qu’il visite le marché dont il vantera le soir même dans ses lettres la joyeuse animation. »
 Eric Chevillard Oreille rouge Les Editions de Minuit – 159 pages -
Eric Chevillard Oreille rouge Les Editions de Minuit – 159 pages -
15/04/2019 | Lien permanent
Doisneau Cavanna : Les Doigts pleins d’encre
 Robert Doisneau (1912-1994) est un photographe français, parmi les plus populaires de l’après-guerre. Il fut, aux côtés de Willy Ronis, d'Edouard Boubat, d'Izis et d'Emile Savitry l'un des principaux représentants du courant de la photographie humaniste française. François Cavanna (1923-2014) est un écrivain, journaliste et dessinateur humoristique français.
Robert Doisneau (1912-1994) est un photographe français, parmi les plus populaires de l’après-guerre. Il fut, aux côtés de Willy Ronis, d'Edouard Boubat, d'Izis et d'Emile Savitry l'un des principaux représentants du courant de la photographie humaniste française. François Cavanna (1923-2014) est un écrivain, journaliste et dessinateur humoristique français.
Les Doigts pleins d’encre, livre de photos, date de 1989 pour sa première édition.
Quelle bonne idée que d’avoir associé Doisneau et Cavanna pour réaliser cet ouvrage – en fait, comment pouvait-il en être autrement ? Le thème du livre, l’enfance et plus particulièrement les gamins d’une dizaine d’années, dans les salles de classe ou la cour de récréation, à moins que la cloche de la délivrance ayant sonné, ils ne courent dans les rues et les terrains vagues, se livrant à ces jeux qu’on joue à cet âge. A noter qu’il n’y a que des garçons en classe (écoles non mixtes à l’époque) ou même à l’extérieur… Le photographe sait rendre à merveille, dans ce Noir & Blanc magique, l’innocence des gosses. Leurs yeux comme leurs attitudes exprimant la joie, la perplexité, la concentration, la malice. Pour accompagner ces documents – qui se suffisent à eux-mêmes en vérité – Cavanna a écrit un court texte, quelques notes ou réflexions, toujours teinté d’humour et plein d’empathie. Ces deux-là savent y faire pour raviver nos souvenirs et entretenir notre nostalgie.
A chaque fois que je feuillette ce livre, et très souvent quand je tombe sur une photo de Doisneau, je l’examine avec beaucoup d’attention, persuadé que je vais m’y reconnaitre. Ces clichés d’école, me rappellent mon enfance à Paris au cœur des années 50 : la façon dont les mômes sont vêtus, la salle de classe avec les pupitres en bois et l’encrier en faïence, la cour de récré et nos jeux de billes ou autres etc. Tout cela me parle car tout cela je l’ai vécu. Au choc des photos de l’un, le poids des mots de l’autre font de ce recueil photographique, un quasi album photos de famille. Si je ne me retenais, j’en aurais la larme à l’œil…
La seule critique que je pourrais avancer, c’est l’absence de renseignements concernant les photos. Pas de dates de prise de vue, ni d’indication de lieux, les curieux devront tout comme moi faire leurs propres recherches sur Internet. C’est dommage.
« Au premier rang, juste devant l’estrade où il y a le bureau du maître, tous les bons élèves sont là, alignés bien sages. Tous ceux qui lèvent le doigt les premiers pour répondre aux questions. La deuxième rangée de tables, c’est encore les bons, mais déjà pas aussi bons, quand même. Et ça va comme ça de moins en moins bons jusqu’au dernier rang, tout au fond contre le mur, si bien que là-bas c’est rien que les terreurs, ceux qui s’en foutent pas mal de l’école et que même le certif ça leur fait pas peur. Nous on se dit comme ça que c’est pas normal, c’est ces gars-là qui devraient être tout devant, bien sous le nez du maître, à peine ils commenceraient à faire leurs tours de cons, à peine à peine, aussitôt, crac, un grand coup de la grande baguette sur les doigts et hop, au coin. Tandis que là, bien planqués derrière les autres, ils font tranquillement tout ce qu’ils veulent et ce qu’ils veulent c’est rien que des conneries et faire des misères aux petits. »

26/04/2019 | Lien permanent
John Grisham : Le Dernier match
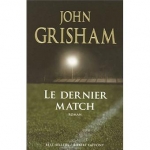 John Ray Grisham né en 1955 dans l’Arkansas est avocat, auteur américain de romans judiciaires et de romans qui décrivent le sud rural des Etats-Unis. Il est surtout connu pour ses livres qui ont été portés à l'écran tels que La Firme (avec Tom Cruise et Gene Hackman), L'Affaire Pélican (avec Julia Roberts) ou encore Le Maître du jeu (avec Dustin Hoffman et Gene Hackman) par exemple. Le Dernier match date de 2006.
John Ray Grisham né en 1955 dans l’Arkansas est avocat, auteur américain de romans judiciaires et de romans qui décrivent le sud rural des Etats-Unis. Il est surtout connu pour ses livres qui ont été portés à l'écran tels que La Firme (avec Tom Cruise et Gene Hackman), L'Affaire Pélican (avec Julia Roberts) ou encore Le Maître du jeu (avec Dustin Hoffman et Gene Hackman) par exemple. Le Dernier match date de 2006.
Messina, une petite ville américaine. Ici, comme dans de nombreuses autres villes américaines, le football (américain) a une place prépondérante dans la vie locale. Quand Eddie Rake, retiré du sport mais mythique coach des Spartiates au palmarès impressionnant, est à l’article de la mort, tout le monde suspend son souffle dans l’attente et se remémore la grande époque des succès de l’entraineur. Neely Crenshaw, légendaire joueur, a même fait le déplacement et revient pour la première fois dans sa ville natale depuis son départ il y a une quinzaine d’années…
Je ne suis pas un admirateur de l’écrivain mais je voulais lui accorder une dernière chance avec un roman qui ne soit pas un polar/thriller. Là encore, raté ! Ce bouquin est une enfilade de clichés ou de banalités très quelconques.
Le récit s’étale sur quatre jours. Neely a failli devenir une grande vedette du football professionnel quand il avait seize ans mais une blessure au genou, dont il conserve des séquelles aujourd’hui, l’en a empêché. Il y a un secret autour d’un match crucial, en 1987, un évènement qui s’est déroulé dans les vestiaires mais dont les rares témoins d’alors ne veulent jamais parler. Ces quelques jours dans l’attente de la mort du coach, comme une thérapie, vont délier les langues par le biais des souvenirs. Les anciens joueurs évoquent leur gloire passée, les méthodes de l’entraineur (extrêmement rudes)… Et chacun en vient à révéler directement ou non, son amour et sa haine pour cet homme : il leur en a fait baver sur le terrain mais il leur a aussi donné des armes pour la vie. On n’a rien sans rien.
John Grisham nous montre l’importance de ce sport aux Etats-Unis : les universités prêtes à tout pour s’attacher les meilleurs joueurs, les pots-de-vin, le rôle social des équipes dans ces petites villes, moments de communion entre tous les habitants le temps d’un match. Mais aussi la gloire éphémère autant qu’aveuglante pour des gamins qui se voient déjà en professionnels de renom. On évoque ici le football américain, mais ça peut aussi s’appliquer à d’autres sports.
Il y a tout cela dans ce livre, mais ça manque de force ou de puissance pour sortir du simple cliché ou de l’évidence. Les personnages sont peu attachants, très basiques et quand Neely revoit brièvement son ex-petite amie d’alors qu’il avait larguée pour une plus dévergondée, la scène hésite entre le nunuche et le mauvais scénario.
Un sujet relativement intéressant mais traité trop succinctement, donc un bouquin dont on pourra se passer facilement…
« - On compte les années en attendant d’entrer dans l’équipe première, poursuivit Paul, puis on devient un héros, une idole, un connard prétentieux à qui tout est permis dans cette ville. On gagne, on gagne, on est le roi d’un petit univers et, du jour au lendemain, plus rien. On joue son dernier match et tout le monde est en larmes. On ne peut pas croire que ce soit fini. La saison suivante, une nouvelle équipe arrive et on est jeté aux oubliettes. – C’est si loin, tout ça. – Quinze ans, mon vieux. »
 John Grisham Le Dernier match Robert Laffont – 203 pages –
John Grisham Le Dernier match Robert Laffont – 203 pages –
Traduit de l’américain par Patrick Berthon
09/08/2019 | Lien permanent
Michael Farris Smith : Nulle part sur la terre
 Michael Farris Smith, né dans le Mississipi, est nouvelliste et romancier. Titulaire d'un doctorat de l'University of Southern Mississippi il a été professeur associé d'anglais au département de langues, littérature et philosophie à la Mississippi University for Women à Columbus. Il vit à Oxford (Mississippi) avec sa femme et ses deux filles. Nulle part sur la terre, son deuxième roman, vient de paraître.
Michael Farris Smith, né dans le Mississipi, est nouvelliste et romancier. Titulaire d'un doctorat de l'University of Southern Mississippi il a été professeur associé d'anglais au département de langues, littérature et philosophie à la Mississippi University for Women à Columbus. Il vit à Oxford (Mississippi) avec sa femme et ses deux filles. Nulle part sur la terre, son deuxième roman, vient de paraître.
Après onze années, Russel sort de prison ayant purgé sa peine et retourne à McComb sa ville natale dans le Mississipi à la frontière avec la Louisiane. Ailleurs, Maben, une femme seule avec une fillette, marche le long des routes, sans ressources et fuyant un danger qui rôde. Elle aussi revient à McComb où elle a vécu autrefois. L’un comme l’autre vont devoir affronter un présent plein de dangers et revivre un passé douloureux.
Je ne vais surtout pas entrer plus loin dans les détails de l’intrigue car ce serait aller contre la volonté de l’auteur. Toute la force de ce roman résidant dans sa construction et l’écriture de Michael Farris Smith. Appâté autant qu’épaté, le lecteur est constamment dans l’attente. Qu’est-ce qui s’est passé pour que cette femme et cette gamine errent ainsi sur les routes ? Pourquoi Russel a-t-il écopé de onze ans de tôle, quel genre de crime a-t-il commis ? Pourquoi à peine descendu du car le déposant à McComb se fait-il dérouiller par deux types bien décidés à se venger ? Tels sont les premiers appâts de ce récit.
Quant à l’épate, c’est l’écriture. Une longueur de phrase donnant un rythme envoutant et captivant, immédiatement perceptible dès les premières pages. Nombreux sont les romans qui se ressemblent dans les grandes lignes de leurs scénarios – particulièrement ce genre de romans américains -, les décors, le pick-up qui roule de nuit avec les canettes de bières à portée de main, les hommes rudes et bagarreurs, les femmes qui subissent etc. J’ai lu des piles de bouquins de ce type, pourtant malgré leur analogie apparente, il y en a de bons et il y en a de mauvais, toute la différence résidant dans l’écriture ; et là avec Michael Farris Smith nous sommes dans la seconde catégorie, celle des très bons romans et peut-être même des grands écrivains si d’autres livres viennent confirmer cette hypothèse.
Si le lecteur est pris par la technique de l’écrivain, il succombe aussi au charme des personnages. Tous sont attachants et paradoxe, ce sont leurs faiblesses ou leurs défauts qui attirent notre sympathie ou du moins notre compréhension. Pour donner un exemple, c’est le genre de bouquin où les méchants peuvent pleurer, « Il pleurait comme un homme qui a perdu la foi et il n’essaya pas d’empêcher les larmes de couler… »
Le Bien, le Mal ne sont que des mots dont on voudrait facilement qualifier les gens, pourtant il ne tient qu’à un rien de tomber dans une case ou l’autre. Russel et Maben ne le savent que trop bien, poursuivis par un fatum qui n’a que de sales tours dans son sac. Et pour ceux qui ont fait le mal, la repentance les absout-elle de leurs crimes ?
Un très beau roman car extrêmement touchant.
« Il éprouvait souvent une grande sérénité lorsqu’il roulait sur les chemins de l’arrière-pays au plus profond de la nuit : les routes désertes, ce sentiment d’être séparé de tout ce qui vivait là-bas dans les lumières de la ville. Mais cette sérénité pouvait tout aussi bien se briser et s’éparpiller dans les recoins les plus sombres de la campagne quand il était soudain submergé par les pensées haineuses qui l’habitaient – l’épouse qu’il n’avait plus, et le fils qu’il ne pouvait pas voir, et la femme qui était la sienne aujourd’hui, et les hommes qui fricotaient avec elle, et les morts qui ne reviendraient jamais, et les vivants qui reviendraient toujours. Et alors il enrageait contre l’objet le plus saillant de sa haine, et il regardait dans le rétroviseur et cet objet était là et lui rendait son regard… »
 Michael Farris Smith Nulle part sur la terre Editions Sonatine – 362 pages –
Michael Farris Smith Nulle part sur la terre Editions Sonatine – 362 pages –
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Pierre Demarty
11/09/2017 | Lien permanent | Commentaires (2)


