Rechercher : larmes blanches
Tim Gautreaux : Le Dernier arbre
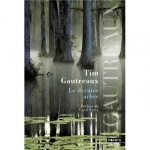 Timothy Martin Gautreaux, né en 1947 en Louisiane où il vit toujours, est le fils d'un capitaine de remorqueur. Professeur émérite d'anglais à la South Eastern Louisiana University, il est l'auteur de nouvelles publiées par The Atlantic Monthly, GQ, Harper's Magazine et The New Yorker. Le Dernier arbre, son premier roman, date de 2013.
Timothy Martin Gautreaux, né en 1947 en Louisiane où il vit toujours, est le fils d'un capitaine de remorqueur. Professeur émérite d'anglais à la South Eastern Louisiana University, il est l'auteur de nouvelles publiées par The Atlantic Monthly, GQ, Harper's Magazine et The New Yorker. Le Dernier arbre, son premier roman, date de 2013.
En 1923. Noah Aldridge, le père des frères Byron et Randolph, négociant en bois de Pittsburg a acheté une scierie dans un bled perdu des marécages de Louisiane, « dans le trou du cul du monde, un endroit qui s’appelle Nimbus ». Il y envoie Randolph, le cadet, pour réorganiser et rentabiliser la scierie, mais surtout pour tenter de ramener dans le giron familial, Byron qu’il espère lui succéder. Byron qui est revenu traumatisé par la Grande Guerre en France et le carnage de Verdun, Byron qui a rompu tout lien avec sa famille, planqué dans ce trou où il a trouvé un job d’officier de police et fait régner la loi à la manière forte, parmi ces hommes seuls n’ayant que l’alcool du saloon et ses prostituées pour oublier la pénibilité du travail. Randolph, laisse sa femme, et débarque dans ce bourbier…
Un roman magnifique, très touchant avec des personnages inoubliables.
Le thème principal en est la fraternité. Byron et Randolph, deux caractères très différents et opposés, façonnés par leur expérience de la vie. Si le cadet n’a connu qu’une existence assez simple et tranquille, régie par les principes moraux inculqués par l’église, Byron lui, a vu et subi ce que les hommes sont capables de faire subir à d’autres hommes, Verdun cet épouvantable massacre où la vie humaine n’avait aucune valeur ; il en est revenu laminé moralement, ne croyant plus qu’en violence pour faire cesser les conflits de poivrots prompts à sortir le couteau ou le rasoir, souls d’alcool, lors de parties de cartes truquées où disparait leur maigre paye.
Le plus jeune vient pour changer l’état d’esprit de l’aîné mais le terrain et les circonstances, la réalité de la vie donc, vont déplacer l’ordre de ce qui était prévu. Quand Randolph, patron de la scierie voudra fermer le saloon le dimanche, il va déclencher un processus fatal, ce tripot appartient à Buzetti, un Sicilien résidant à La Nouvelle Orleans d’où il dirige trafic d’alcool et prostitution avec une poignée de sbires pas commodes qui vont lancer des représailles. Randolph en viendra à la manière forte…
Le roman se partage entre la crainte des actions que peut mener Buzetti et les acteurs de la scierie. Byron vit avec une femme qui l’aime et supporte son caractère difficile et violent, la femme de Randolph finira par le rejoindre et tentera de mettre de l’humanité dans le camp, en faisant venir les familles des travailleurs, construisant une petite école et permettant des messes le dimanche ; et il y a aussi May, la gouvernante de Randolph, une métisse instruite qui veut absolument un enfant d’un Blanc pour se reconstruire une vie ailleurs. Tous ces maillons « faibles » sont des cibles potentielles pour le Sicilien et nous valent des moments émouvants.
Un très beau roman qu’on pourra ranger à côté de ceux de Ron Rash.
« « Un demi-million de soldats m’ont tiré dessus, disait Byron, avec les fusils les plus précis du monde, et pas un seul d’entre eux n’a réussi ce qu’a fait un abruti de mécano avec un pistolet à quinze dollars. » Il ferma les yeux et des larmes coulèrent dans ses oreilles. « J’espérais en avoir fini avec la guerre, sanglota-t-il, mais cette foutue planète tout entière est désormais en guerre. » »
 Tim Gautreaux Le Dernier arbre Seuil - 411 pages -
Tim Gautreaux Le Dernier arbre Seuil - 411 pages -
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Jean-Paul Gratias
« Il savait que ce pays regorgeait d’immenses cyprès chauves, aux troncs imputrescibles et résistant aux termites, donnant un bois au grain incomparable, des arbres dont le pied atteignait trois mètres de diamètres, prêts à être débités en planches qui survivraient trois cents ans aux banquiers… »
25/01/2024 | Lien permanent | Commentaires (6)
Brandon Hobson : Dans l’écho lointain de nos voix
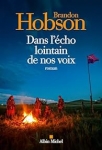 Brandon Hobson est un écrivain américain, nouvelliste et romancier. Titulaire d'un doctorat d'Anglais de l'Université d'Etat de l'Oklahoma, il enseigne la création littéraire à l'Université du Nouveau-Mexique et à l'Institut des arts des Indiens d'Amérique. Cet écrivain cherokee de l’Oklahoma, journaliste et enseignant, s’est rapidement imposé comme une voix incontournable de la littérature autochtone. Dans l’écho lointain de nos voix, son quatrième roman mais le premier à être traduit en français, vient de paraître.
Brandon Hobson est un écrivain américain, nouvelliste et romancier. Titulaire d'un doctorat d'Anglais de l'Université d'Etat de l'Oklahoma, il enseigne la création littéraire à l'Université du Nouveau-Mexique et à l'Institut des arts des Indiens d'Amérique. Cet écrivain cherokee de l’Oklahoma, journaliste et enseignant, s’est rapidement imposé comme une voix incontournable de la littérature autochtone. Dans l’écho lointain de nos voix, son quatrième roman mais le premier à être traduit en français, vient de paraître.
De nos jours dans l’Oklahoma. Il y a une quinzaine d’années, Ray-Ray, un adolescent cherokee a été tué, victime d’une bavure policière. Depuis cette date, sa famille tente de vivre avec son chagrin. Maria, la mère « J’ai fait toute ma carrière dans le social, pour servir la justice dans un monde qui me donne l’impression d’en manquer », s’occupe de son époux Ernest atteint de la maladie d’Alzheimer ; Sonja, leur fille, habite plus loin dans la même rue, une solitaire, quant à Edgar, le fils cadet qui vit à Albuquerque au Nouveau-Mexique, c’est un drogué qui n’a pas la volonté de s’en sortir, « J’ai à peine vingt et un ans, et je suis déjà dans l’impasse ». Alors que l’anniversaire du décès de Ray-Ray approche, Maria prépare une petite fête et souhaiterait qu’Edgar puisse venir bien qu’il ne réponde pas à ses appels. C’est à cette période que les services sociaux de la ville, leur confient provisoirement en tant que famille d’accueil, Wyatt un jeune gamin…
Bizarre, émouvant, très beau. En gros voilà ce qui pourrait résumer ce roman.
Roman choral ou chaque chapitre laisse entendre la voix d’un membre de la famille, qui tous à leur manière, expriment leur chagrin, la douleur de la perte d’un des leurs. Pour Maria et Sonja vous en découvrirez vous-même leurs propos et ce qui a modifié leur existence en conditionnant leur présent, c’est très beau et émouvant.
J’en viens au « bizarre ». Tout d’abord, il y a les chapitres où Edgar intervient, une sorte de mystère en entoure le récit, un coq sauvage le poursuit incessamment, il quitte sa copine et échoue dans une ville étrange où les Indiens sont reluqués avec méfiance, il loge chez un créateur de jeux-vidéos dont il semble qu’il utilise Edgar comme modèle de proie pour des tueurs d’Indiens, avec Ray-Ray qui apparaît sous forme d’hologramme ! On ne comprend pas très bien ce qui se passe mais est-ce bien la réalité, sachant que c’est un drogué qui s’exprime ? Le roman est aussi ponctué de chapitres liés à l’histoire tragique du peuple Cherokee (La Piste des larmes) sous forme de conte philosophique, les voix des ancêtres et les croyances indiennes planent vaguement en permanence tout du long du récit.
Le bizarre, l’émotion et la beauté du roman se condensent dans le personnage de Wyatt. Le gamin de douze ans s’avère présenter des similitudes de comportement et intérêts avec Ray-Ray ce qui déclenche des émotions puissantes en particulier chez le père qui montre des signes de guérison de sa maladie, la mémoire lui revenant lors de ses discussions avec Wyatt, un gosse plein d’entrain et de sagesse.
Je ne vous en dis pas plus, le roman est très bien et surtout très prometteur : un Indien dont on suivra la plume.
« Je pense aux complexités du temps, à la lenteur et à la vitesse auxquels il passe. Quinze années malheureuses se sont écoulées depuis la mort de notre fils. On a commencé à faire ces feux de joie pour le dixième anniversaire de sa mort, et ces cinq dernières années, c’est devenu pour nous une façon de nous réunir et de nous dire franchement les choses, de penser à l’importance de notre famille, de notre terre. Jusqu’alors, même si Ernest et moi avons grandi près d’ici, je n’avais jamais senti un lien aussi fort avec tout ce qui nous entoure. »
 Brandon Hobson Dans l’écho lointain de nos voix Albin Michel - 293 pages -
Brandon Hobson Dans l’écho lointain de nos voix Albin Michel - 293 pages -
Traduit de l’américain par Stéphane Roques
29/04/2024 | Lien permanent | Commentaires (4)
La Série Noire fête ses 70 ans
Paris, été 1944, les alliés viennent de débarquer en Normandie lorsque Marcel Duhamel, agent pour Gallimard, sort de chez l'auteur dramatique Marcel Achard avec trois bouquins que ce dernier vient de lui confier : This man is dangerous et Poison Ivy de Peter Cheyney, et No orchids for miss Blandish d'un certain James Hadley Chase. Un an plus tard, en octobre 1945, le public français découvre une nouvelle collection à travers ses deux premiers titres, La Môme vert-de-gris (titre français de Poison Ivy) et Cet homme est dangereux, les deux polars de Cheyney.
La « Série noire » est née et personne ne se doute que soixante-dix ans plus tard, presque 3000 romans seront à son catalogue. On notera que si La Môme vert-de-gris porte le n° 1 de cette collection, Le Dernier Coup de Kenyatta de Donald Goines paru en 2005 avec le n° 2743, est l’ultime roman de La Série Noire à se voir attribuer un numéro.
Mais revenons aux origines. En quoi cette collection a-t-elle révolutionné le monde de l’édition ? La réponse nous est donnée dès 1948 par Marcel Duhamel, à travers ce court texte de présentation, véritable manifeste :
« Que le lecteur non prévenu se méfie : les volumes de la « Série noire » ne peuvent pas sans danger être mis entre toutes les mains. L'amateur d'énigmes à la Sherlock Holmes n'y trouvera pas souvent son compte. L'optimiste systématique non plus. L'immoralité admise en général dans ce genre d'ouvrages uniquement pour servir de repoussoir à la moralité conventionnelle, y est chez elle tout autant que les beaux sentiments, voire de l'amoralité tout court. L'esprit en est rarement conformiste. On y voit des policiers plus corrompus que les malfaiteurs qu'ils poursuivent. Le détective sympathique ne résout pas toujours le mystère. Parfois il n'y a pas de mystère. Et quelquefois même, pas de détective du tout. Mais alors ?... Alors il reste de l'action, de l'angoisse, de la violence — sous toutes ses formes et particulièrement les plus honnies — du tabassage et du massacre. Comme dans les bons films, les états d'âmes se traduisent par des gestes, et les lecteurs friands de littérature introspective devront se livrer à la gymnastique inverse. Il y a aussi de l'amour — préférablement bestial — de la passion désordonnée, de la haine sans merci, tous les sentiments qui, dans une société policée, ne sont censés avoir cours que tout à fait exceptionnellement, mais qui sont parfois exprimés dans une langue fort peu académique mais où domine toujours, rose ou noir, l'humour. A l'amateur de sensations fortes, je conseille donc vivement la réconfortante lecture de ces ouvrages, dût-il me traîner dans la boue après coup. En choisissant au hasard, il tombera vraisemblablement sur une nuit blanche. »
 Voilà pour le fond. Quant à la forme, elle se distingue par une esthétique particulière (pochette cartonnée noire et jaune avec une jaquette noire avec liseré blanc) qui va faire beaucoup pour la notoriété de la collection, dont le nom a été inventé par Jacques Prévert.
Voilà pour le fond. Quant à la forme, elle se distingue par une esthétique particulière (pochette cartonnée noire et jaune avec une jaquette noire avec liseré blanc) qui va faire beaucoup pour la notoriété de la collection, dont le nom a été inventé par Jacques Prévert.
La littérature anglo-américaine se taille la part du lion dans la collection. Marcel Duhamel se charge lui-même de la traduction de nombreux ouvrages (Raymond Chandler et Dashiell Hammett). Tous les grands auteurs du roman noir américain seront publiés (Horace McCoy, W. R. Burnett, Ed McBain, Chester Himes, David Goodis ou Jim Thompson). Dans le même temps Duhamel va éditer des auteurs français, le premier est Serge Arcouët (publié sous le pseudonyme de Terry Stewart en 1948) puis Albert Simonin avec Touchez pas au grisbi !, et permettre au genre de prendre son envol définitif en France. Les écrivains du néo-polar (par exemple, Jean-Patrick Manchette, A.D.G. et Jean-Pierre Bastid) en feront un véhicule pour le commentaire social et politique.
Au cours des années 1980 la collection commence à subir la concurrence de nouvelles collections comme Rivages/Noir. On critique aussi l'absence d'auteurs de sexe féminin. Patrick Raynal essaiera d'y remédier en donnant leur chance à Maïté Bernard, Laurence Biberfeld, Pascale Fonteneau, Sylvie Granotier, Nadine Monfils, Chantal Pelletier.
Devant l'érosion des ventes constatée depuis que nous avons changé de siècle, Antoine Gallimard a profondément modifié la collection, confiant sa direction en 2005 à Aurélien Masson : la collection sœur La Noire disparaît tandis que la Série noire passe d'un format mi-poche (19 X 12,5 cm.) au grand format, gardant l'esprit de la dernière version des semi-poches (photo en noir et blanc, typographie en jaune) et supprime la fameuse numérotation. Les tirages sont moins importants et leur prix plus élevé.
A titre personnel, ces modifications me désolent énormément car j’étais très attaché au format précédent mais je conçois que ce soit là une réflexion de petit vieux borné. Et puis comme disait l’autre, on ne juge pas un livre sur sa couverture, l’important restera donc toujours le texte et la valeur des auteurs publiés.
Dans une interview accordée au Monde des Livres (27/03/2015), Aurélien Masson envisage les axes de développement suivants : « Continuer de promouvoir des voix françaises dans leur diversité. J’ai aussi demandé l’autorisation de publier exceptionnellement quelques biographies de rock. Pourquoi s’interdire des choses ? Il faut abolir les frontières. Patrick Pécherot (1), par exemple, est publié alternativement dans des collections de littérature noire (Tranchecaille, 2008) et blanche (L’Homme à la carabine, 2011). Je compte enfin développer le polar rural en 2016, parce qu’il traite de problèmes rarement évoqués : fermetures d’usines et de commerces, ennui de la jeunesse, délinquance diffuse… »
Longue vie à la Série Noire ou, pour reprendre le titre d’un Peter Cheyney, A toi de faire, ma mignonne…
(1)- Mon prochain billet chroniquera l’excellent nouveau roman de Patrick Pécherot : Une plaie ouverte.
Sources : Gallimard – Wikipedia – Le Monde
19/09/2015 | Lien permanent
Truman Capote : Les chiens aboient
 Truman Garcia Capote - né Truman Streckfus Persons - en 1924 à La Nouvelle-Orléans, décédé en 1984 à Los Angeles, est un écrivain américain auteur de romans, nouvelles, reportages, portraits, récits de voyages, adaptations théâtrales et scénarios de films. Ses romans les plus connus, Petit déjeuner chez Tiffany (1958) et surtout De sang-froid (1966).
Truman Garcia Capote - né Truman Streckfus Persons - en 1924 à La Nouvelle-Orléans, décédé en 1984 à Los Angeles, est un écrivain américain auteur de romans, nouvelles, reportages, portraits, récits de voyages, adaptations théâtrales et scénarios de films. Ses romans les plus connus, Petit déjeuner chez Tiffany (1958) et surtout De sang-froid (1966).
Les chiens aboient est un recueil de textes datant de 1951 à 1973. Initialement paru en France en 1977, il vient tout juste de ressortir dans cette nouvelle édition. Sous-titré Souvenirs, sites, silhouettes qui donne leur titre aux trois chapitres, il regroupe 23 textes courts et autobiographiques.
« Je considère ces textes brefs, ces silhouettes et ces souvenirs – notes sur certaines gens, sur certains sites – comme une sorte d'atlas personnel, de géographie de ma vie d'écrivain tout au long de trois décennies : en gros, de 1945 à ces dernières années. Tout dans ce livre est emprunté à la réalité, ce qui ne veut pas dire que ce soit là le réel à l'état brut ; mettons que c'en est la meilleure approximation possible pour moi : un reportage même, à tout prendre, ne peut se dire vérité pure ; et pas davantage l'objectif d'une caméra. Car enfin, l'art n'est pas de l'eau pasteurisée : notre façon de percevoir, nos préjugés, le choix opéré par notre sensibilité, tout cela vient troubler le cristal du Vrai absolu. »
Tous les textes ne sont pas d’un intérêt égal il est vrai. Mais on se régalera de La Rose blanche où l’auteur narre sa rencontre avec Colette dans son appartement du Palais-Royal, de Lola sorte de nouvelle se déroulant lors d’un séjour en Sicile où le personnage central est un corbeau femelle aux ailes rognées. Le portrait d’Ezra Pound et Autoportrait sont deux textes excellents eux aussi.
Truman Capote a l’écriture précise et on se délecte de l’acuité de ses jugements ou de ses portraits comme par exemple quand il évoque Humphrey Bogart « Toujours le même rôle, c’est vrai, mais il n’est rien de plus difficile à rendre sans cesse intéressant que la répétition. »
On trouvera dans ce court ouvrage des détails sur l’adaptation cinématographique de son roman De sang froid, des impressions de voyage en Sicile où il croise André Gide, à Venise ou à Tanger. Les portraits, bien qu’extrêmement courts hélas, croquent Karen Blixen, Mae West « inimaginablement virginale », Jean Cocteau et Gide, Maryline Monroe dont il note « le tortillement rythmique de volumes toujours en mouvement qui luttent pour plus d’espace dans l’infini de son décolleté ». Avec en fil rouge, une réflexion sur l’Art.
« Gide avait l’habitude, tous les matins, de rêvasser sur la place ensoleillée, assis le dos au mur, et sirotant une bouteille d’eau salée fraîchement remplie à la mer, mandarin immobile enfoui dans une pèlerine d’hiver en laine noire, et coiffé d’un sombre chapeau mou dont le large bord ombrageait sa longue et triste figure au teint sulfureux. Une idole, à sa façon ; sacrée mais sans emploi ; ne parlant jamais et n’écoutant personne, si ce n’est quelque Ganymède de village qui avait suscité un instant sa fantaisie. »
 Truman Capote Les chiens aboient Gallimard L’Imaginaire – 227 pages –
Truman Capote Les chiens aboient Gallimard L’Imaginaire – 227 pages –
Traduit de l’américain par Jean Malignon
19/03/2014 | Lien permanent
Michael Punke : Le Revenant
 Michael Punke a grandi dans le Wyoming et a longtemps vécu dans le Montana. Il a travaillé à la Maison-Blanche comme Directeur des affaires économiques internationales ainsi qu'au Conseil de sécurité nationale et au Conseil économique national. Aujourd'hui, il est ambassadeur et le représentant permanent des Etats-Unis auprès de l'OMC et vit à Genève. Outre son roman, Le Revenant, en cours d'adaptation au cinéma, il a publié deux ouvrages sur l'histoire de l'Ouest américain et deux scénarios. Si le roman date de 2002, il vient tout juste de paraître chez nous.
Michael Punke a grandi dans le Wyoming et a longtemps vécu dans le Montana. Il a travaillé à la Maison-Blanche comme Directeur des affaires économiques internationales ainsi qu'au Conseil de sécurité nationale et au Conseil économique national. Aujourd'hui, il est ambassadeur et le représentant permanent des Etats-Unis auprès de l'OMC et vit à Genève. Outre son roman, Le Revenant, en cours d'adaptation au cinéma, il a publié deux ouvrages sur l'histoire de l'Ouest américain et deux scénarios. Si le roman date de 2002, il vient tout juste de paraître chez nous.
« En 1823, au cours d'une expédition à travers les Grandes Plaines des Etats-Unis, le trappeur Hugh Glass est attaqué par un grizzly. Défiguré, le corps déchiqueté par la bête, Hugh est confié à deux volontaires chargés de le veiller jusqu'à sa mort puis de l'enterrer. En plein territoire indien, chaque heure qui passe amenuise les chances de ses gardiens de retrouver leurs compagnons. Aussi abandonnent-ils le blessé à son triste sort. Seul, désarmé et à bout de forces, Glass survit. Son unique motivation : la vengeance. Commence alors la légende de Hugh Glass : l'histoire d'un homme hors du commun qui va parcourir cinq mille kilomètres depuis le Dakota du Sud jusqu'au Nebraska pour retrouver ceux qui l'ont trahi... »
Basé sur une histoire réelle, de celles qui ont construit l’histoire de l’Amérique, le bouquin de Michael Punke relève du roman d’aventures comme ceux que je dévorais quand j’étais gamin. Western, avec ses trappeurs commerçant les fourrures, Indiens bons et méchants, forts perdus au milieu de nulle part, mais aussi histoire de pirates avec Jean Lafitte qui s’invite au scénario. Vous allez croire qu’il s’agit-là d’un émule de R.L.Stevenson, las ! Le talent en moins.
Certes le roman se lit bien, mais entre des aventures rocambolesques alternant avec une narration simpliste et le manque de subtilité psychologique des personnages, on comprend vite qu’il y a erreur de public de cible. Ce livre devrait être destiné à un jeune lectorat uniquement. L’écriture manque de puissance ou de souffle pour dépasser la simple relation du récit et intéresser réellement un lecteur moyennement exigeant. Donc, un roman qui se lit facilement et vite, mais « vite » dans le sens de passons rapidement à autre chose. Dommage car la matière scénaristique ne manquait pas, c’est le moins que l’on puisse dire.
« Jamais cependant il n’avait vu un corps humain dans cet état, juste après l’attaque. Glass était en lambeaux de la tête aux pieds. Son cuir chevelu pendait d’un côté de sa tête et il fallut un moment à Harris pour reconnaître les éléments qui composaient son visage. Le pire, c’était la gorge. Les griffes du grizzly avaient creusé trois rainures profondes, de l’épaule à l’autre côté du cou. Quelques centimètres de plus et la jugulaire aurait été sectionnée. Le coup de patte avait ouvert la gorge, tranchant dans le muscle et découvrant le gosier. Les griffes avaient aussi coupé la trachée et Harris, horrifié, vit une grosse bulle se former dans le sang qui coulait de la blessure. C’était le premier signe clair que Glass vivait encore. »
 Michael Punke Le Revenant Presses de la Cité – 352 pages –
Michael Punke Le Revenant Presses de la Cité – 352 pages –
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Jacques Martinache
11/04/2014 | Lien permanent | Commentaires (2)
Pascal Garnier : Cartons
 Pascal Garnier est un écrivain français né en 1949 à Paris et mort en 2010 à Cornas (Ardèche). Après une vie d'errance et de petits boulots, et un passage éclair par le rock 'n' roll, il décide à 35 ans de se lancer dans l'écriture. Son œuvre abondante et multiforme comprend des romans noirs comme des ouvrages de littérature d'enfance et de jeunesse. En 2001, il obtient un prix du festival Polar dans la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines pour Nul n'est à l'abri du succès et en 2006, le Grand Prix de l'humour noir avec Flux. Dernier roman de l’écrivain, Cartons est paru en 2012 après son décès.
Pascal Garnier est un écrivain français né en 1949 à Paris et mort en 2010 à Cornas (Ardèche). Après une vie d'errance et de petits boulots, et un passage éclair par le rock 'n' roll, il décide à 35 ans de se lancer dans l'écriture. Son œuvre abondante et multiforme comprend des romans noirs comme des ouvrages de littérature d'enfance et de jeunesse. En 2001, il obtient un prix du festival Polar dans la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines pour Nul n'est à l'abri du succès et en 2006, le Grand Prix de l'humour noir avec Flux. Dernier roman de l’écrivain, Cartons est paru en 2012 après son décès.
Brice, la cinquantaine, déménage. Il quitte son appartement à Lyon pour une maison dans un bled près de Valence. Sa femme Emma est absente, reporter, elle doit être à l’étranger. Dans son nouveau logis, au milieu de ses cartons, Brice est un peu perdu et incertain, doit-il tout remettre en place dès maintenant ou attendre le retour d’Emma qui aura évidemment une autre idée de l’emplacement des choses. Brice pense beaucoup à Emma dont il n’a – curieusement - pas de nouvelles. Sa solitude, tournant à la dépression, va être troublée par l’irruption impromptue d’un chat qui s’installe chez lui et par Blanche, une jeune femme excentrique qui s’immisce dans son quotidien.
Le roman est très court et je ne peux guère vous en dire plus au risque de gâcher votre lecture. Pascal Garnier est un funambule, quand il entraine le lecteur sur son filin on ne peut que le suivre. Chaque pas, chaque page veux-je dire, est une surprise ou une inquiétude. Chaque personnage apporte son lot d’étonnement au point que le lecteur se demande parfois, si tel ou telle est bien sain d’esprit, pourquoi ce mystère qui plane, ces non-dits qui éclaireraient tout mais que Pascal Garnier nous tait dans un premier temps. Sa plume est un compte-goutte qui lentement libère les explications que nous réclamons, un travail d’orfèvre.
Ce bouquin est une perle, le genre de « petit livre » qu’on adore pour mille raisons : il est simple à lire, il est court, le style ciselé et le propos envoûtent, on est intrigué par l’histoire, on ouvre de grands yeux à certaines révélations et quand il s’achève on se sent comblé par ce que la lecture est capable d’offrir de meilleur. Et alors que vous vous réjouissez d’avoir dégotté un superbe écrivain inconnu, de rapides recherches sur internet vous apprennent que vous seul étiez dans cette ignorance. Je ne découvre Pascal Garnier qu’aujourd’hui, quelle misère ! Mais j’ai un avantage sur vous, il me reste une bonne quinzaine de ses romans à découvrir.
« Chez tout quinquagénaire il y a une guitare qui sommeille. Comme il venait de loin cet accord perdu !... Brice ouvrit l’étui avec autant de précaution qu’un égyptologue un sarcophage. Dans son écrin de velours rouge le bois satiné de la Gibson resplendissait. Seules les cordes semblaient un peu rouillées. La guitare était aussi légère qu’une jeune mariée quand il la posa sur sa cuisse. A peine désaccordée. Du majeur gauche il lui fit rendre les harmoniques. Intacte. Le chat, l’œil écarquillé, n’en revenait pas de voir les mains de l’homme faire chanter ce meuble. D’un bond il sauta sur la table et chercha à mordre ces moustaches d’acier semblables aux siennes jaillissant des mécaniques. »
 Pascal Garnier Cartons Zulma - 185 pages –
Pascal Garnier Cartons Zulma - 185 pages –
16/04/2014 | Lien permanent | Commentaires (7)
Ron Rash : Une terre d’ombre
 Ron Rash, né en Caroline du Sud en 1953, titulaire d’une chaire à l’Université, écrit des poèmes, des nouvelles et des romans. Son premier roman paru en France en 2009, Un pied au paradis, a fait forte impression et Serena en 2011, l’impose comme l’un des grands écrivains américains contemporains. Son nouveau livre, Une terre d’ombre, vient tout juste de paraître.
Ron Rash, né en Caroline du Sud en 1953, titulaire d’une chaire à l’Université, écrit des poèmes, des nouvelles et des romans. Son premier roman paru en France en 2009, Un pied au paradis, a fait forte impression et Serena en 2011, l’impose comme l’un des grands écrivains américains contemporains. Son nouveau livre, Une terre d’ombre, vient tout juste de paraître.
Laurel vit seule avec son frère Hank, revenu de la Première Guerre mondiale qui fait encore rage en Europe amputé d’une main, dans la ferme héritée de leurs parents. La maison est à l’écart du monde, dans un vallon qu’on dit maudit, au pied d’une falaise en faisant une terre d’ombre. Laurel est tenue à l’écart par les habitants de la ville proche en raison d’une tache de naissance qui la désignerait comme sorcière. Leur seul ami, le vieux Slidell qui leur donne un coup de main par-ci, par-là, soit pour les travaux de la ferme, soit pour les accompagner en ville avec sa carriole.
Hank envisage de se marier avec Carolyn lorsque son père l’aura jugé assez apte à tenir une ferme quand on n’a plus qu’une seule main et Lauren s’imagine vivre avec le couple. Jusqu’au jour où apparait un mystérieux vagabond, il est muet et joue divinement de la flûte. Désormais la vie de Laurel va changer.
Dès les premières pages le lecteur est pris par l’écriture lyrique de Ron Rash, cette petite musique envoûtante émanant des mots et des phrases ainsi que par le mystère qu’on sent s’insinuer dans la narration. Si nous en savons plus que Lauren et Hank, Walter le musicien s’est échappé d’un camp de prisonniers et désire rejoindre New York, pour autant nous ne savons pas pour quel motif il était emprisonné, ni pourquoi il tient tant à cette destination. Comme l’écrivain ne manque pas d’habileté pour décrire des actions dont l’explication n’est fournie qu’à postériori, le lecteur reste parfois un temps dans l’ignorance ou l’incompréhension, une délicieuse incertitude qui rajoute au charme de la lecture.
Et quelle idée géniale d’avoir fait de Walter, un muet ! Sans en révéler trop, on devine aisément que l’inconnu va troubler la charmante Laurel, toute prête à tâter de la flûte à Walter. Et où tant d’autres se seraient fourvoyés dans une romance mièvre, en privant de parole l’un des protagonistes, Ron Rash nous évite des dialogues nunuches mais qui obligent l’écrivain à nous émouvoir par des moyens plus subtils, ce qu’il réussit parfaitement. Econome de mots et écourtant les situations, Rash nous offre un roman assez court mais assez fort pour séduire tous les publics, en un final tragique mais quasi obligatoire pour que le bouquin tienne ses promesses jusqu’au bout.
Si Lauren et Walter sont au premier plan, l’auteur utilise ses héros pour dénoncer la folie des hommes durant les guerres, ici la chasse aux Allemands en terre américaine supposés être des espions et d’une manière plus général, le rejet des autres comme cette soi-disant sorcière, tout en s’interrogeant sur le rôle des choix que la vie nous impose et qui feront de nous, ce que nous sommes.
« La falaise la dominait de toute sa hauteur, et elle avait beau avoir les yeux baissés, elle sentait sa présence. Même dans la maison elle la sentait, comme si son ombre était tellement dense qu’elle s’infiltrait dans le bois. Une terre d’ombre et rien d’autre, lui avait dit sa mère, qui soutenait qu’il n’y avait pas d’endroit plus lugubre dans toute la chaine des Blue Ridge. Un lieu maudit, aussi, pensait la plupart des habitants du comté, maudit bien avant que le père de Laurel n’achète ces terres. Les Cherokee avaient évité ce vallon, et dans la première famille blanche à s’y être installée tout le monde était mort de la varicelle. »
 Ron Rash Une terre d’ombre Seuil
Ron Rash Une terre d’ombre Seuil
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Isabelle Reinharez
31/01/2014 | Lien permanent | Commentaires (6)
Thomas Gunzig : Manuel de survie à l’usage des incapables
 Thomas Gunzig est un écrivain belge francophone né en 1970, fils du cosmologue Edgard Gunzig. Son enfance a été marquée par sa dyslexie et il a d’abord connu une scolarité difficile avant d’obtenir une licence de sciences politiques. Après avoir été libraire pendant 10 ans à Bruxelles, il est devenu professeur de littérature et en 1993 il publie un premier recueil de nouvelles. Depuis avril 2010, il est chroniqueur sur une radio belge. Son troisième roman, Manuel de survie à l’usage des incapables, vient de paraître.
Thomas Gunzig est un écrivain belge francophone né en 1970, fils du cosmologue Edgard Gunzig. Son enfance a été marquée par sa dyslexie et il a d’abord connu une scolarité difficile avant d’obtenir une licence de sciences politiques. Après avoir été libraire pendant 10 ans à Bruxelles, il est devenu professeur de littérature et en 1993 il publie un premier recueil de nouvelles. Depuis avril 2010, il est chroniqueur sur une radio belge. Son troisième roman, Manuel de survie à l’usage des incapables, vient de paraître.
Quatre délinquants redoutables braquent un fourgon blindé contenant la recette d’un hypermarché. Jean-Jean, responsable de la sécurité dans ce magasin, à la demande de ses supérieurs épie une caissière pour lui trouver un motif de renvoi. Jacques Chirac ( !) employé est le petit ami de Martine la caissière, mère des quatre délinquants. Accidentellement, Jean-Jean tue Martine. Les quatre délinquants renseignés par Jacques Chirac jurent de faire la peau à Jean-Jean. En gros, voici le résumé de base sur lequel est construit le roman.
Pourtant, ce livre n’est pas un polar mais un cocktail (Molotov, tant il décape) dont les ingrédients sont, le polar, la SF et la fable. La dose de polar vient de vous être résumée ; la SF, parce que le récit se déroule dans un futur très proche où l’Homme, c'est-à-dire les sociétés commerciales, a déposé des copyrights sur les codes de l’ADN et où les femmes peuvent se faire « upgrader » et donner naissance à des enfants marqués de gênes animaux. Les quatre délinquants, par exemple, sont des hommes-loups (des loup-bards ?), Marianne l’épouse de Jean-Jean a des gênes de mamba vert… Quant à la fable, elle réside dans le ton sarcastique avec lequel Thomas Gunzig décrit notre monde fait de meubles Ikea et dont le symbole le plus criard est l’hypermarché, où se joue une guerre sans merci pour le profit, livrée par des managers surentraînés afin de sortir vainqueurs de ce « struggle for life », car seuls les plus forts en réchappent. Triste morale, mais loi naturelle qui conclut le roman quand les « gentils » mais faibles, seront éliminés par les « méchants » mais forts. D’où le titre du livre. Avant de servir le cocktail, ajoutez une dose d’humour avec ces patronymes attribués à ses personnages, Jacques Chirac ou Blanche de Castille, ou ces détails saugrenus comme lorsque nous apprenons que les parents de Marianne se sont rencontrés dans un gang-bang !
L’astucieux Thomas Gunzig a écrit son roman, un genre de polar, avec juste un poil de décalage avec notre réalité quotidienne pour le rendre attractif et étrange. Autre bon point, il insère de-ci de-là une certaine dose de culture dans son bouquin accessible à tout public. Point négatif, j’ai trouvé faible les rapports homme/femme de ses personnages. Cette dernière remarque grève la note finale, nous avons donc-là, un roman mineur mais qui vous assure néanmoins un très bon moment de lecture.
« Jean-Jean se disait souvent que s’il avait un jour des enfants, ce qui soit dit en passant était fortement improbable vu que ni son salaire ni celui de Marianne n’étaient suffisants pour se le permettre, il leur dirait d’être vigilants, de faire attention aux détails, d’essayer de sentir quand les choses, discrètement, tournent mal. (…) Il leur dirait d’être égoïstes, d’être individualistes, que même si ça faisait d’eux des salauds aux yeux du monde, il valait mieux être un salaud heureux qu’un brave type qui, à l’heure de rentrer chez lui, en pesant le pour et le contre, se dit que tout compte fait il n’a pas envie mais qu’il n’a pas le choix. »
 Thomas Gunzig Manuel de survie à l’usage des incapables Au Diable Vauvert
Thomas Gunzig Manuel de survie à l’usage des incapables Au Diable Vauvert
02/09/2013 | Lien permanent | Commentaires (2)
Lisa Jackson : De glace et de ténèbres
 Lisa Jackson est née en 1952 dans une petite ville de l’Oregon. Elle sort diplômée de l'Université d'État de l'Oregon et commence par travailler dans le secteur bancaire avant que son premier roman ne paraisse en 1983. Habituellement ses bouquins se placent sur les listes des meilleures ventes de livres du New York Times, USA Today et Publisher's Weekly. Son nouvel ouvrage, De glace et de ténèbres, est le douzième publié en France.
Lisa Jackson est née en 1952 dans une petite ville de l’Oregon. Elle sort diplômée de l'Université d'État de l'Oregon et commence par travailler dans le secteur bancaire avant que son premier roman ne paraisse en 1983. Habituellement ses bouquins se placent sur les listes des meilleures ventes de livres du New York Times, USA Today et Publisher's Weekly. Son nouvel ouvrage, De glace et de ténèbres, est le douzième publié en France.
En voici le résumé, tel qu’on peut le lire au dos de l’ouvrage : « Selena Alvarez en est persuadée, l’affaire sur laquelle elle et sa coéquipière Regan Pescoli enquêtent est hors normes. D’abord parce que les victimes — toutes des femmes — se ressemblent étonnamment : ossature du visage, peau claire, cheveux auburn, yeux verts. Ensuite parce que le tueur, qui s’attaque méthodiquement et froidement à ses victimes, semble insaisissable et tout proche à la fois. En pleine période de Thanksgiving, dans ce Montana de ténèbres et de glace que les décorations de Noël peinent à réchauffer, Selena sait qu’elle va devoir faire preuve d’une ingéniosité et d’un courage sans égal pour arrêter ce tueur implacable. Et pour révéler au grand jour le terrible secret qui le pousse à agir… »
Il n’y a rien de plus épouvantable, comme ici, que d’entamer un pavé de plus de cinq cents pages et de s’apercevoir après dix pages ( !) qu’on a fait mauvaise pioche. Certes je n’avais pas vraiment choisi de lire ce bouquin, arrivé gracieusement entre mains par des voies que je ne peux dévoiler.
Que dire de ce livre ? D’abord, il est beaucoup trop long, on peut facilement en retirer la moitié sans en édulcorer le sens. Un texte qui s’étale comme un bavardage sans fin, s’attardant sur des détails vestimentaires ou alimentaires sans intérêt, comme si l’auteure s’imaginait que les lecteurs mesuraient le talent d’un écrivain ou la qualité d’un roman, à son épaisseur ! Le pire, c’est que je ne suis pas loin de penser que c’est exactement une part du raisonnement de Lisa Jackson ou de son éditeur, d’ailleurs tout le bouquin pue l’artificiel. Tous les trucs éculés du thriller s’empilent éhontément, les clichés abondent et bien entendu le style est inexistant. Même la traduction laisse planer un doute parfois. Exemple de phrase qu’on peut lire dans ce navet, « Le tueur éclata d’un rire démoniaque qui résonna dans la nuit » (p. 517), comment peut-on encore écrire de telles foutaises à notre époque ?
Il existe beaucoup de mauvais livres, pour de multiples raisons qui en général restent néanmoins honorables, mais celui-ci va plus loin et c’est en cela que je l’exècre. Il s’agit d’un roman écrit par une femme pour un public féminin, chaque phrase en traduit le créneau visé, chaque digression le révèle (enfants malades, femmes vivant seules se cherchant un mec, éducation des ados etc.). Aucune littérature là-dedans, un simple produit marketing qu’on espère vendre en grosses quantités. Tous comme la série des SAS de Gérard de Villiers s’adresse aux hommes, ce bouquin est pour les femmes. Ce n’est pas un propos machiste, c’est une simple constatation qui mériterait l’ire des féministes, car Lisa Jackson entretient dans ce bouquin tous les modèles les plus crétins d’une féminité infantile.
Je ne pense pas qu’il soit nécessaire que je m’étende plus, vous avez compris ce que je pensais de ce truc….
« Il songea à la gorge gracile d’Acacia et se vit brandissant un couteau, celui-là même avec lequel elle l’avait marqué à vie. Il imagina la lame étincelante inciser sa peau laiteuse et pénétrer dans la fine chair de son cou. Il crut la voir écarquiller les yeux tandis que des gouttes de sang perlaient au passage de l’acier tranchant, scintillant comme autant de rubis dans un écrin soyeux, avant de former un ruisseau écarlate sur son sternum et ses seins, se diluant ensuite dans l’eau du bain. Les bulles de savon blanches se teintaient de rouge tout autour de son corps tandis qu’elle s’affaissait dans l’eau chaude. »
 Lisa Jackson De glace et de ténèbres Editions Harlequin (à paraître le 1er août 2013)
Lisa Jackson De glace et de ténèbres Editions Harlequin (à paraître le 1er août 2013)
Traduit de l’américain par Philippe Mortimer
17/06/2013 | Lien permanent
Mircea Eliade : La nuit bengali
Mircea Eliade (1907-1986) est historien des religions, philosophe et romancier roumain. A quatorze ans il publie son premier article et à vingt ans il parle déjà allemand, anglais, français et italien. Adulte, il parlait et écrivait couramment huit langues dont l’hébreu, le persan et le sanskrit. De 1933 à 1940 il enseigne la philosophie indienne à l‘Université de Bucarest.
Son roman La nuit bengali date de 1933 mais ne sera traduit en français pour Gallimard qu’en 1950. C’est cette édition que j’ai achetée dans une brocante, son premier ( ?) propriétaire l’avait faite relier, avec le nom de l’auteur et le titre du livre sur la tranche ainsi que ses initiales. A l’intérieur du bouquin, un premier cachet à l’encre bleue en partie délavée précise, me semble-t-il, « Le lieutenant Corroyez – O.D. de la C.P.L.E. » tandis qu’un second sur la page suivante indique le nom et le prénom ainsi qu’une adresse à Draveil (91210). Rien qu’avec ces éléments on pourrait écrire un roman ou du moins une histoire passionnante. Mais aujourd’hui ce n’est pas mon propos.
Revenons à notre roman qui se déroule au Bengale dans les années 30. Allan, un jeune européen, ingénieur et dessinateur technique pour une entreprise de canalisation du delta du Gange, mène une vie de célibataire relativement agréable au sein de la petite communauté blanche qu’il fréquente. Le roman est écrit à la première personne, souvenirs d’Allan et extraits de son journal intime. L’ingénieur va rencontrer Maitreyi une jeune fille indienne fille de son patron, et a son plus grand étonnement – car lors de leurs premières rencontres elle ne l’avait pas particulièrement frappé - il va en tomber amoureux.
Dès lors, tout le roman va s’articuler autour cet amour qui doit rester secret, tant pour Allan vis-à-vis de ses compatriotes qui n’accepteraient pas cette relation entre un blanc et une quasi « négresse », que pour les parents de Maitreyi très à cheval sur les conventions liées à leur religion et leur système de classes typique de la société indienne. La situation est d’autant plus complexe, qu’Allan a été accueilli par les parents de la jeune fille et vit sous leur propre toit chaque jour un peu plus comme un fils. Ajoutez à cela, les jeux de l’amour dont les codes diffèrent selon les cultures et qui mettent les nerfs d’Allan à l’épreuve.
Sans dévoiler vraiment la fin du roman, on peut deviner que l’histoire se terminera tragiquement pour certains des acteurs quand la vérité éclatera, que des souffrances s’atténueront avec le temps pour d’autres, peut-être.
Un très beau livre, peut-être un peu désuet mais avec une très belle histoire d’amour dans un décor exotique et un choc des cultures.
« Le dimanche, mes serviteurs partaient en train pour Shillong et ramenaient des provisions. Je dormais jusqu’à midi et me réveillais la tête lourde et la bouche pâteuse. Je restais au lit tout le jour à recopier mes notes sur mon journal. Je voulais publier plus tard un livre sur la vie réelle du blanc en Assam et je m’analysais moi-même avec le plus de précision possible. Mes jours de marasme et de neurasthénie avaient leur place auprès des jours, naturellement plus nombreux, où le pionnier se réveillait en moi plein d’orgueil et de puissance. »
 Mircea Eliade La nuit bengali Gallimard
Mircea Eliade La nuit bengali Gallimard
13/10/2012 | Lien permanent




