Rechercher : histoires bizarroides
Mary Costello : Academy Street
 Originaire de Galway, Mary Costello vit à Dublin. Elle est l'auteur d'un recueil de nouvelles largement acclamé par la critique anglophone. Academy Street, son premier roman, est paru récemment.
Originaire de Galway, Mary Costello vit à Dublin. Elle est l'auteur d'un recueil de nouvelles largement acclamé par la critique anglophone. Academy Street, son premier roman, est paru récemment.
Nous sommes en Irlande dans les années 40, dans le vaste domaine familial d’Easterfield et Tess a sept ans lorsque sa mère meurt de la tuberculose. De ses études d’infirmière à son départ pour New York à l’invitation de sa sœur Claire jusqu’aux dernières années de sa vie, nous suivons cette enfant puis cette femme dans son parcours à travers la vie.
Les plus belles histoires sont souvent des histoires tristes, Academy Street nous conte une belle histoire. Vous connaissez la formule, « une fois le livre refermé vous n’oublierez pas le portrait de cette femme », je crois qu’il s’applique avec justesse à ce roman.
Il y a des êtres qui semblent condamnés d’avance à porter une croix toute leur existence, comme cette Tess dont la perte de sa mère va la plonger dans une solitude silencieuse qui la marquera à jamais. Toujours en marge des autres, confinée dans sa bulle intérieure qui la condamne à une solitude virtuelle dans un premier temps, puis bien réelle quand sa sœur aînée et adorée Claire partira pour l’Amérique, « La sensation de proximité qu’elle éprouvait envers ses frères et sœurs, ce lien si fort, elle ne l’avait avec personne d’autre ». Quand à son tour elle rejoindra New York, une vie nouvelle sur un autre continent plein de promesses devrait être signe d’espoir mais le sillon était tout tracé, manque de confiance en soi, dévalorisation d’elle-même, timidité, « Jamais de toute sa vie elle n’avait vraiment su quoi faire, comment agir », elle ne peut se lier avec personne, les hommes l’indiffèrent et donc ils l’ignorent et quand l’un d’eux, David, semblera combler ses vœux, il l’abandonnera en lui laissant un souvenir cuisant en son sein, d’où d’autres tourments.
La pauvre Tess nous file un peu le bourdon, les décès familiaux s’enchaînent, ses souffrances psychologiques s’accumulent, sa profonde solitude et son manque d’amour, nous attristent d’autant plus qu’en tant que lecteur nous ne pouvons rien y faire, seule Mary Costello…. Mais ce serait un autre roman, or pourquoi en faire un autre puisque celui-ci est très bon.
Le texte est fait de phrases très courtes le plus souvent, presque brutalement jetées sur le papier, très sobre. Et cette sobriété, contre toute attente, amplifie l’émotion qui étreint le lecteur durant tout le roman. Le temps s’écoule en Amérique et l’auteure le signifie discrètement, un mot ou une demie phrase, mais nous comprenons que Kennedy vient d’être assassiné, qu’il y a le Vietnam ou plus tard l’effondrement des tours.
Un très beau roman, très émouvant ou poignant parfois, sans effets ostentatoires pour vous tirer la larme, s’accordant parfaitement avec la saison automnale et humide, et Billie Holiday en sourdine.
« Ce n’était pas des réponses ou des consolations qu’elle trouvait dans les romans, mais un degré d’empathie qu’elle n’avait croisé nulle part ailleurs et qui atténuait sa solitude. Ou qui la renforçait, comme si une partie d’elle-même – son côté ermite – se trouvait à portée de main, attendant d’être incarnée. La pensée qu’à une époque lointaine, une personne – un étranger qui écrivait à son bureau – avait su ce qu’elle savait, ressenti ce qu’elle ressentait dans son cœur plein de vie, lui donnait confiance et force. Il est comme moi, se disait-elle. Il partage mes sensations. »
 Mary Costello Academy Street Editions du Seuil – 187 pages –
Mary Costello Academy Street Editions du Seuil – 187 pages –
Traduit de l’anglais (Irlande) par Madeleine Nasalik
20/10/2015 | Lien permanent | Commentaires (2)
Patrick Pécherot : Une plaie ouverte
 Patrick Pécherot est un journaliste, écrivain et scénariste de bande dessinée né en 1953 à Courbevoie. Il a exercé plusieurs métiers dans le secteur de la protection sociale. Un temps proche des milieux libertaires et pacifistes, il s'engage syndicalement à la CFDT. Son premier roman est publié à la Série noire en 1996. En dehors du roman noir, Patrick Pécherot a écrit des romans pour la jeunesse, des nouvelles, un essai ainsi que trois scénarios de bande dessinée pour Jeff Pourquié. Une plaie ouverte, son nouveau roman, vient de paraître.
Patrick Pécherot est un journaliste, écrivain et scénariste de bande dessinée né en 1953 à Courbevoie. Il a exercé plusieurs métiers dans le secteur de la protection sociale. Un temps proche des milieux libertaires et pacifistes, il s'engage syndicalement à la CFDT. Son premier roman est publié à la Série noire en 1996. En dehors du roman noir, Patrick Pécherot a écrit des romans pour la jeunesse, des nouvelles, un essai ainsi que trois scénarios de bande dessinée pour Jeff Pourquié. Une plaie ouverte, son nouveau roman, vient de paraître.
Dans le Paris assiégé de 1870, le court temps de la Commune approche. Durant ces trois mois, de mars à mai 1871, des hommes et des femmes vivent la fièvre de l’insurrection qui s’achèvera dans le sang. Les amis sont dispersés, arrêtés ou recherchés. Dana, en fuite, est condamné à mort par contumace, accusé d’avoir participé au massacre des otages de la rue Haxo. Qui était-il ? Son souvenir hante Marceau jusqu’à l’obsession. Trente ans plus tard, il croit le reconnaître parmi les figurants du premier western de l’histoire du cinématographe, et n’aura de cesse de retrouver sa trace.
Je ne sais pas si vous connaissez la chanson où il est question de « marabout- bout de ficelle-selle de cheval » etc. mais Patrick Pécherot, lui, doit en faire son air favori sous la douche, car c’est l’un des points forts de ce roman, une construction décoiffante où tout s’enchaîne avec une logique vertigineuse. Partant du Far-West des pionniers nous rejoindrons le Paris communard qui finira par voir débouler le Buffalo Bill’s Wild West, le fameux spectacle destiné à recréer l’atmosphère de l’Ouest américain dans toute son authenticité, dans les murs de la capitale en 1899. Quant aux acteurs à l’affiche de cet incroyable scénario, ce ne sont ni plus ni moins que Jules Vallès, Paul Verlaine, Gustave Courbet, Charles Baudelaire, Thomas Edison, Charles Pathé, Calamity Jane, Buffalo Bill et tant d’autres illustres. L’écrivain est particulièrement calé sur la période, tout sonne juste dans les moindres détails et l’on serait prêt à jurer que tout est vrai dans ce roman, tant le faux (si peu, mais l’intrigue du bouquin) se mêle habilement au vrai (j’ai vérifié sous Google).
Si le style d’écriture évolue, le début du livre (la première moitié ?) ma scotché tant ce style extrêmement personnel, est superbe et déroutant. Si la construction du scénario est complexe, les phrases ne le sont pas moins en ce début d’ouvrage et j’avoue avoir été partagé entre admiration (devant l’écriture sublime et pleine d’ellipses) et répulsion (j’avais du mal à comprendre de quoi il en retournait, suivant la narration déstructurée à l’aveuglette). Ajoutons que l’écriture à la troisième personne tient aussi le lecteur à distance. Lecteurs éventuels du roman, n’abandonnez pas trop vite si vous peinez à suivre, bientôt l’horizon va se dégager, même s’il gardera jusqu’au bout, la touche ou la patte caractéristique voulue par Pécherot. Mais pour tout ce que je viens de dire, je ne pense pas que ce livre fasse l’unanimité.
Le coup de théâtre final est franchement réussi et ajoute un plus à ce polar pas ordinaire. Un très bon roman, plein d’Histoire et d’histoires. Mais qui se mérite.
« Il y avait eu la guerre. Hideuse et bête. Elles le sont toutes, mais celle-ci battait tous les records. Quand l’idiotie est si crasse on peut dire « j’y étais ». Comme l’autre à Austerlitz. L’Austerlitz de la connerie ! L’Empereur et le Kaiser enchamaillés. Des disputes de têtes couronnées. Des scènes de ménage à protocole. L’honneur offensé et le bon droit pour soi. De quoi faire valser les enfants de la patrie. Troupeaux d’hommes lancés sur les routes. Cahotant tête à cul dans le glinglin des bidons et des chassepots. M. Godillot, promu bottier de la nation. Des régiments de pieds à chausser. Grosse affaire. Belle réclame. Le godillot c’est du solide, inusable, dur à la mêlée. Il vous enterrera. On marchait là-dedans comme dans la merde. Les pieds au jus, macérant dans la sueur. Tours, détours, contournements, mouvements tournants, kilomètres avalés, la victoire en chantant puait des arpions. »
 Patrick Pécherot Une plaie ouverte Série Noire Gallimard - 270 pages –
Patrick Pécherot Une plaie ouverte Série Noire Gallimard - 270 pages –
21/09/2015 | Lien permanent | Commentaires (4)
Timur Vermes : Il est de retour
 Timur Vermes, né en 1967 à Nuremberg, est un écrivain allemand d'origine hongroise par son père. Après des études d’histoire et de sciences politiques, il devient journaliste et contribue à de nombreux journaux et magazines. Ancien nègre littéraire, son premier roman, Il est de retour, est paru en 2014.
Timur Vermes, né en 1967 à Nuremberg, est un écrivain allemand d'origine hongroise par son père. Après des études d’histoire et de sciences politiques, il devient journaliste et contribue à de nombreux journaux et magazines. Ancien nègre littéraire, son premier roman, Il est de retour, est paru en 2014.
Dans le Berlin de nos jours, un homme se réveille dans un terrain vague, Adolph Hitler que l’on croyait mort depuis 1945 est de retour ! Voici le pitch sur lequel Timur Vermes a construit son premier roman, une idée originale et provocante à la fois. A priori.
Hitler, le narrateur, ne s’explique pas sa « résurrection » et l’écrivain, à juste titre ne s’y attarde pas non plus. D’emblée le parti pris humoristique de Timur Vermes s’impose ; le ton de la narration et les étonnements successifs du fraichement débarqué face au monde qui a bien changé, amusent le lecteur. La télévision, internet etc. tout est découverte pour le fameux moustachu. Puis les sourires virent au rire jaune quand l’humour noir entre en scène, « La création d’un Etat d’Israël avait visiblement provoqué un appel d’air. On avait eu la bonne idée de placer cet Etat en plein milieu de peuplades arabes, si bien que toutes les parties étaient occupées à se battre les unes contre les autres depuis des décennies et des décennies. » Mais où l’humour est plus subtile, c’est dans les multiples recours au quiproquo : Hitler parle au premier degré tandis que ses interlocuteurs y entendent du second degré, « Et aujourd’hui, vous faites des plaisanteries sur ce sujet à la télévision… - Voilà qui est nouveau, dis-je sur un ton grave. Les juifs ne sont pas un sujet de plaisanterie. » Là, le lecteur rit moins, instruit par l’Histoire passée.
Hitler se baladant dans Berlin ne pouvait passer inaperçu, repéré par une chaîne de télévision et considéré comme un comique de haut niveau, « jouant » son personnage vingt-quatre heures sur vingt-quatre, il fait un tabac à l’audimat avant d’investir le royaume de YouTube. L’écrivain en profite pour fustiger les médias, de l’audiovisuel à la presse du Bild Zeitung. Les uns propulsant un soi-disant comique vers la starisation, l’autre reconstruisant sa popularité passée en vue de continuer son combat d’hier en utilisant cette tribune. Le plus agaçant pour le lecteur – mais c’est aussi le ressort principal et voulu du bouquin – c’est que cet Hitler n’est pas aussi antipathique qu’on le voudrait, comparé aux crétins qui le montent en épingle.
Globalement le roman est souriant et intéressant mais il souffre aussi de longueurs parfois, d’un manque de punch dans l’écriture et surtout de profondeur dans la dénonciation du système. On comprend bien le propos de l’écrivain, nous mettre en garde contre le possible retour de leaders extrémistes qui n’utiliseraient que les outils modernes de communication pour parvenir à leurs fins, mais tout cela reste bien gentillet. Enfin, c’est mieux que rien.
PS : Je vais faire le boulot de l’éditeur, puisqu’il ne l’a pas fait. Information importante pour les lecteurs amateurs, qui n’ont pas comme moi, l’habitude d’éplucher de fond en comble un bouquin avant de le lire, en fin d’ouvrage il y a un glossaire bien venu pour éclairer des points d’Histoire oubliée ou méconnue ; or ce glossaire n’est indiqué nulle part et aucun astérisque ou autre moyen dans le texte n’y renvoie.
« C’était peut-être une erreur ? Déclarai-je. Je veux dire : ces gens ne ressemblent pas du tout à des… - C’est quoi cet argument ? demanda Melle Krömeier d’un ton froid. Et s’ils ont été tués par erreur, ça veut dire que ce n’est pas grave ? Un type s’est dit un jour qu’il fallait tuer les juifs, la voilà l’erreur ! Et les gitans ! Et les homosexuels ! Et tous ceux qui ne lui convenaient pas. Je vais vous dire une chose assez simple : si on ne tue pas, on ne risque pas de se tromper de personnes ! C’est simple comme bonjour ! »
 Timur Vermes Il est de retour Belfond – 393 pages –
Timur Vermes Il est de retour Belfond – 393 pages –
Traduit de l’allemand par Pierre Deshusses
25/11/2015 | Lien permanent | Commentaires (5)
Nicolas Bouvier : Chronique japonaise
 Nicolas Bouvier (1929-1998) est un écrivain, photographe, iconographe et voyageur suisse. Après avoir suivi des cours d'histoire médiévale, de sanskrit et de droit à l'Université de Genève, Nicolas Bouvier se lance dans un long voyage de plus d’un an en Asie, commencé avec un ami, puis en solitaire à travers l'Inde afin de gagner la Chine. La route étant fermée pour des raisons politiques, il gagne Ceylan où, malade et déprimé, il reste neuf mois. A son actif plusieurs séjours au Japon (seul ou avec femme et enfants) et d'autres voyages en Asie (Corée du Sud, Chine) ou en Europe (Irlande, Iles d'Aran).
Nicolas Bouvier (1929-1998) est un écrivain, photographe, iconographe et voyageur suisse. Après avoir suivi des cours d'histoire médiévale, de sanskrit et de droit à l'Université de Genève, Nicolas Bouvier se lance dans un long voyage de plus d’un an en Asie, commencé avec un ami, puis en solitaire à travers l'Inde afin de gagner la Chine. La route étant fermée pour des raisons politiques, il gagne Ceylan où, malade et déprimé, il reste neuf mois. A son actif plusieurs séjours au Japon (seul ou avec femme et enfants) et d'autres voyages en Asie (Corée du Sud, Chine) ou en Europe (Irlande, Iles d'Aran).
Chronique japonaise a connu plusieurs versions : la première a été publiée en 1967 sous le titre Japon. La première édition sous le titre Chronique japonaise, en 1975, modifie le texte de Japon en y ajoutant des épisodes du séjour de 1964-1966, et une troisième version, définitive, publiée en 1989, reprend des textes écrits au cours du séjour de 1970. C’est de cette ultime version qu’il est question ici, regroupant les récits de ses trois séjours au Japon (en 1955-1956, 1964-1966 et 1970)
J’ai lu ce livre pour la première fois, il y a vingt-cinq ans, et j’avoue que j’en avais gardé un souvenir déçu. Ce qui était franchement étonnant puisque j’avais en main le bouquin d’un écrivain de talent, d’un voyageur et qui plus est, relatant un séjour au Japon ! Trois arguments qui théoriquement ne pouvaient que m’enchanter. Il fallait donc que je répare ou confirme définitivement mon jugement.
J’ai vite compris ce qui avait dû me rebuter à l’époque, ce long début d’ouvrage consacré à l’histoire du Japon. Certainement un malentendu, je pensais mettre mes pas dans ceux d’un crapahuteur décrivant par le menu ce qu’il voyait en chemin, genre guide touristique des chemins creux. En fait, nous avons là le livre d’un vrai écrivain et d’un homme cultivé – style impeccable et explications claires, mêlant le vécu à l’Histoire pour donner du sens au tout. Et ce tout, en creux, nous éclaire sur la mentalité des Japonais. Ce qui n’est pas un mince exploit. Du coup mes réticences d’hier me paraissent bien minables après relecture.
Nicolas Bouvier voyage le bagage léger et le porte-monnaie pas plus lourd, ce qui le conduit à séjourner dans les quartiers populaires, les pensions parfois limite sordides, au plus près des petites gens, ce qui lui permet de découvrir par l’intérieur la réalité du pays, grandement aidé il faut le dire par sa connaissance de la langue. Pour enrichir son maigre pécule, il écrit des articles pour de petits journaux, et il photographie les Japonais, les vieux, les jeunes, les travailleurs… Notre Suisse aime la discrétion et la simplicité, la beauté du naturel, « J’aime d’ailleurs beaucoup ces natures qui ne font pas de musique symphonique mais ne connaissent que quelques notes et les répètent inlassablement. »
Avec ce voyageur vous comprendrez mieux ce qu’est le Zen même si l’auteur toujours modeste avoue, « ce que je sais du Zen aujourd’hui me permet tout juste de mesurer à quel point j’en manque, et combien ce manque est douloureux », le Tao et ses chemins d’accès, koans et satori. Vous vous régalerez aussi des très belles pages sur le théâtre No.
Un très bon livre. Et si le début vous rebute, persévérez, la lumière est au bout du chemin.
« Ce train omnibus est bondé… (…) Les deux vieilles qui me font face ont terminé leur besogne, sorti leur bento (pique-nique) et prennent leur petit déjeuner – du riz collé et quelques brins de choux aigre – littéralement sur mes genoux. Puis le première déplie un mouchoir immaculé et essuie d’un geste gracieux les grains qui couvrent mon paletot, tandis que la deuxième frotte une allumette soufrée et la laisse brûler jusqu’au doigt parce qu’elle a lâché un de ces vents que la civilité réprouve. »
 Nicolas Bouvier Chronique japonaise Petite Bibliothèque Payot – 286 pages –
Nicolas Bouvier Chronique japonaise Petite Bibliothèque Payot – 286 pages –
J'ai retrouvé avec émotion, plié en quatre dans mon exemplaire du bouquin, l’article de Libération daté du 19 février 1998, consacré au décès de l’écrivain :

27/06/2017 | Lien permanent | Commentaires (10)
Jean Rolin : Les Evènements
 Jean Philippe Rolin, né en 1949 à Boulogne-Billancourt, est un écrivain et journaliste français. Etudiant, Jean Rolin s'investit dans la tendance maoïste de mai 68. Au début des années 1970, il intervient comme représentant de la Gauche prolétarienne à Saint-Nazaire. Journaliste, il a surtout effectué des reportages, entre autres pour Libération, Le Figaro, L'Événement du jeudi et GEO. Écrivain, il est l'auteur de récits de voyage, de chroniques, de souvenirs, de romans et de nouvelles. Paru en 2015, son roman Les Evènements vient d’être réédité en poche.
Jean Philippe Rolin, né en 1949 à Boulogne-Billancourt, est un écrivain et journaliste français. Etudiant, Jean Rolin s'investit dans la tendance maoïste de mai 68. Au début des années 1970, il intervient comme représentant de la Gauche prolétarienne à Saint-Nazaire. Journaliste, il a surtout effectué des reportages, entre autres pour Libération, Le Figaro, L'Événement du jeudi et GEO. Écrivain, il est l'auteur de récits de voyage, de chroniques, de souvenirs, de romans et de nouvelles. Paru en 2015, son roman Les Evènements vient d’être réédité en poche.
La France est en guerre civile. Pour venir en aide à un ami qui serait malade, le narrateur doit quitter Paris, au volant d’un véhicule déglingué, et rouler vers le sud. En chemin, toutes sortes de difficultés vont surgir, imputables aux différents groupes armés qui se disputent le territoire, ou aux casques bleus qui s’efforcent mollement de les séparer.
Encore un de ces romans qui me laissent perplexe à la lecture et bouche bée quand je le referme, car honnêtement, je ne le comprend pas. Certes, je l’ai lu jusqu’au bout sans envisager de l’abandonner en route mais seulement parce qu’il est très court. Un roman sans histoire réellement construite et sans fond (message) apparent, ce n’est pas ma tasse de thé.
Nous suivons donc un narrateur (on ne sait qui) partant de Paris avec des médocs (on ne sait pour quel traitement) devant être remis en mains propres à Brennecke, un vieil ami de jeunesse, qui aurait (peut-être) été son amant d’alors, en tout cas, ils formaient avec une certaine Victoria un trio amoureux pas très clair. Cet ami est chef d’un groupe armé, un de ceux (de droite, de gauche ou islamistes ou encore chrétiens) qui se combattent à travers la France, sous le contrôle franchement mou des casques bleus de l’ONU (des finlandais et des ghanéens). Le narrateur donnera ses médicaments à son ancien pote, il recroisera le chemin de Victoria qui lui avoue avoir un fils de seize ans disparu (rejeton qui pourrait être du narrateur ou bien de Brennecke) et qu’elle aimerait qu’il l’aide à le retrouver, du coup ils partent tous les deux vers le Sud, elle se fait enlever (on ne sait par qui), il arrive à Port-de-Bouc, retrouve Victoria en possession d’une valise pleine de fric (venant d’on ne sait où) mais pas le fils (qui n’a jamais existé) et ils se préparent à l’exil vers les Baléares ! Fin de l’histoire, n’oubliez pas de fermer la porte en sortant !
Le texte est fait, le plus souvent, de phrases assez longues avec un excès de détails topographiques ou autres qui n’ont aucun intérêt particulier mais franchement agaçants quand on les oppose au manque d’indications claires concernant la narration proprement dite. Une histoire complètement floue dans des décors extrêmement précis ! La virée, de Paris à la Méditerranée s’apparente à un documentaire de France3 genre Des racines et des ailes, un peu gâché par le fait que nous sommes en guerre (molle, si on se fie à la lecture). Le ton varie de l’humour pince-sans-rire (« Puis par des rues que je n’eus guère le loisir d’identifier, dans la position que j’occupais au milieu de la banquette arrière, les mains menottées dans le dos et la tête sur les genoux… » [L’humour, c’est que tout du long du roman, Rolin nous soule avec les noms des rues, boulevards et places qu’il emprunte !]) à l’ironie critique, seul point positif de cet étrange bouquin.
« La veille du jour où ils m’avaient hébergé, ils avaient ainsi vu venir sur la route un automobiliste ensanglanté, dépourvu de son automobile et presque entièrement dévêtu, auquel, m’avait dit l’officier, ils n’avaient pu prodiguer que des soins rudimentaires avant de lui enjoindre de repartir, à pied, dans la direction d’où il était arrivé, faute d’instructions de leur état-major sur ce qu’ils devaient faire dans un cas de ce genre. D’autant que l’homme ensanglanté et à demi-nu était dans l’incapacité de justifier de son identité. « La FINUF, avait ajouté l’officier, a reçu un mandat précis, et elle n’a pas vocation à secourir toutes les misères, surtout quand elles n’affectent qu’un individu isolé. » »
 Jean Rolin Les Evènements Folio - 178 pages –
Jean Rolin Les Evènements Folio - 178 pages –
27/05/2016 | Lien permanent | Commentaires (5)
Arnaldur Indridason : Les Nuits de Reykjavik
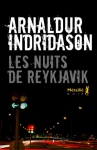 Arnaldur Indridason, né en 1961 à Reykjavík et fils de l'écrivain Indrid G. Porsteinsson, est un écrivain islandais. Après un diplôme en histoire à l’université d'Islande, il exerce les métiers de journaliste, scénariste puis critique de films. Entré en littérature en 1997, nombre de ses romans policiers sont des best-sellers. Les Nuits de Reykjavik est paru en 2015.
Arnaldur Indridason, né en 1961 à Reykjavík et fils de l'écrivain Indrid G. Porsteinsson, est un écrivain islandais. Après un diplôme en histoire à l’université d'Islande, il exerce les métiers de journaliste, scénariste puis critique de films. Entré en littérature en 1997, nombre de ses romans policiers sont des best-sellers. Les Nuits de Reykjavik est paru en 2015.
Si Erlendur, le héros récurrent d’Indridason, a souvent l’occasion d’enquêter sur des affaires ayant leur source dans le passé, ici l’écrivain nous convie à revenir sur le passé même d’Erlendur.
Nous sommes au début des années 70, Erlendur vient d’entrer dans la police, et les rues de Reykjavik dans lesquelles il patrouille la nuit sont agitées, accidents de la circulation, vols, violences domestiques… Des gamins trouvent en jouant dans un fossé plein d’eau le cadavre d’un clochard, Hannibal, qu’il croisait régulièrement dans ses rondes. On conclut à l’accident, noyade d’un poivrot, et l’affaire est classée. Pour le jeune policier, qui se demande « si ce n’était pas sa passion pour les destins tragiques qui l’avait conduit à s’engager dans la police », cette mort mérite qu’on s’y intéresse…
C’est donc en solitaire, prenant sur ses temps libres, qu’Erlandur va tenter de comprendre ce qui s’est passé, d’autant qu’au fur et à mesure qu’il se renseigne, des éléments troublants viennent se greffer sur cette affaire, comme la disparition de cette femme la nuit même où Hannibal est décédé ou bien ce troublant incendie dont il réchappa de peu quelques temps avant…
Arnaldur Indridason excelle à dérouler son histoire par petites touches. Que ce soit l’enquête proprement dite, menée hors contexte légal par Erlandur, interrogeant les proches, les voisins, les clochards de la ville, tentant de relier les bribes d’informations qu’il collecte ; mais c’est aussi avec beaucoup de talent qu’il dresse les portraits de ses personnages, tout en empathie et petits détails, à commencer par son héros dont on redécouvre les origines modestes, son intérêt pour l’Histoire, le poids du drame vécu plus jeune avec la disparition de son frère dont il se croit responsable, ce qui explique son intérêt pour les disparus, ou encore son caractère solitaire qui s’accommode mal d’une relation trop engagée avec une femme.
De petites gens, de petites vies, certains s’en sortent à peu près, d’autres doivent faire avec leurs chagrins et leurs douleurs, gens « normaux » ou SDF, l’écrivain les traite tous avec amour et nous les donne à voir avec beaucoup de compréhension. Et au milieu de ce microcosme, à Reykjavik, un jeune homme déjà obstiné, va dénouer tout seul les fils de cette embrouille et finir par se faire remarquer par Marion Briem, « Vous devriez passer nous voir à la Criminelle si vous avez envie d’un peu de changement… » Le destin d’Erlandur est désormais scellé.
Un très, très, beau roman.
« Pourquoi était-il hanté par ce vagabond qu’il avait en fin de compte rarement croisé ? Etait-ce parce qu’il l’avait repêché, et que cette image l’avait si fortement marqué ? Il avait eu un choc en reconnaissant le visage du noyé. Pourtant, il aurait dû s’attendre à le retrouver mort quelque part en ville. Il était de toute évidence en mauvaise santé. Cet homme vivait dans des conditions terribles depuis trop longtemps. Et son moral n’était pas fameux non plus. Erlendur avait pu le constater lors de leur dernière entrevue dans une cellule du commissariat de Hverfisgata. Hannibal avait alors parlé de sa détresse et du courage qui lui manquait pour y mettre fin. »
 Arnaldur Indridason Les Nuits de Reykjavik Editions Métailié – 261 pages –
Arnaldur Indridason Les Nuits de Reykjavik Editions Métailié – 261 pages –
Traduit de l’islandais par Eric Boury
18/07/2016 | Lien permanent | Commentaires (2)
Dolores Redondo : Une offrande à la tempête
 Dolores Redondo, née en 1969 à Saint-Sébastien, dans la province de Guipúzcoa, au Pays basque, est une romancière espagnole, auteur de romans historiques et policiers. Après des études de droit, elle travaille dans le commerce pendant plusieurs années avant de publier un premier roman en 2009. Mais sa renommée naissante elle la doit à sa trilogie, dite Trilogie de la vallée du Baztan qui comprend, Le Gardien invisible (2013), De chair et d’os (2015) et ce dernier volet qui paraît aujourd’hui, Une offrande à la tempête.
Dolores Redondo, née en 1969 à Saint-Sébastien, dans la province de Guipúzcoa, au Pays basque, est une romancière espagnole, auteur de romans historiques et policiers. Après des études de droit, elle travaille dans le commerce pendant plusieurs années avant de publier un premier roman en 2009. Mais sa renommée naissante elle la doit à sa trilogie, dite Trilogie de la vallée du Baztan qui comprend, Le Gardien invisible (2013), De chair et d’os (2015) et ce dernier volet qui paraît aujourd’hui, Une offrande à la tempête.
« La mort subite d’une petite fille devient suspecte lorsque le médecin légiste découvre qu’une pression a été appliquée sur le visage du bébé. Très vite, les soupçons se portent sur le père au comportement étrange, qui tente même de dérober le cadavre du nourrisson afin de « terminer ce qui a été commencé ». La grand-mère, elle, est persuadée que ce meurtre est l’acte d’Inguma, créature maléfique issue de la mythologie basque. Aux yeux de l’inspectrice Amaia Salazar, cette histoire est une énième légende. Mais lorsqu’elle décide de s’intéresser de plus près aux morts subites de nourrisson déclarées dans la vallée de Baztán ces dernières années, Amaia observe pourtant des similitudes troublantes et l’enquête prend une tournure inattendue. Fuyant son rôle d’épouse et de mère, Amaia se consacre entièrement à cette nouvelle affaire qui la mène à l’origine même des événements qui ont frappé la vallée et la confronte bientôt à son passé et à ses propres démons. »
L’éditeur, gentil garçon, m’a offert ce bouquin et je l’en remercie, hélas, je n’avais pas lu les deux tomes précédents. Je le précise pour que vous ne fassiez pas la même erreur que moi. Certes on peut ne lire que cet épisode mais les références aux deux autres sont très fortes et obligent le lecteur à des reconstructions mentales, agaçantes en elles-mêmes et énervantes car on s’en veut d’avoir loupé un croustillant passé sur lequel on ne reviendra plus maintenant. Je ne vais pas lire une histoire dont je connais désormais la fin. Cette parenthèse refermée, il s’agit d’un thriller de très bonne qualité.
Le sujet est de ceux que j’aime beaucoup quand ils sont bien traités, comme ici : des crimes rituels, des croyances ancestrales secrètement entretenues, des pratiques satanistes ou de sorcellerie, le Vatican pas loin, des ambiances genre Rosemary’s Baby et autres pouvoirs des ténèbres…. Brrr ! Moi, ça me glace délicieusement les sens. Rien de réellement révolutionnaire dans le genre mais tout est correctement géré par l’écrivain et j’ai littéralement dévoré le bouquin. Et quand en postface, Dolores Redondo vous apprend que cette histoire est tirée d’un entrefilet lu dans la presse sur lequel elle a brodé au point de croix (évidemment) sa trilogie, ça ne calmera pas vos palpitations.
« Amaia suivait les explications du père Sarasola avec une attention croissante. – Compte tenu du fait que vous êtes venue me voir pour m’interroger sur un démon qui tue les dormeurs et que Berasategui a été en relation avec Esparza, lequel a assassiné sa fille par la suite, et avec votre mère, qui a tenté de faire la même chose à votre fils, et qu’en plus l’un des policiers qui enquêtait sur cette affaire a été assassiné, il me semble qu’il y a largement de quoi s’inquiéter. Elle songea à la tombe vide de sa sœur et hésita un instant à s’en ouvrir à Sarasola. – Père Sarasola, pourquoi ai-je la sensation que, malgré tout ce que vous m’avez raconté, vous ne m’avez encore rien dit ? »
 Dolores Redondo Une offrande à la tempête Mercure Noir - 516 pages –
Dolores Redondo Une offrande à la tempête Mercure Noir - 516 pages –
Traduit de l’espagnol par Judith Vernant
17/03/2016 | Lien permanent
Antoine Blondin : Les Enfants du bon Dieu
 Fils de parents bohèmes, Antoine Blondin (1922-1991) a connu la notoriété dès la publication de son premier livre, L'Europe buissonnière, qui capte l'attention d'auteurs comme Marcel Aymé et Roger Nimier qui lui accordent aussitôt leur amitié. Roman couronné en 1950 par le prix des Deux Magots. Se partageant entre le journalisme (il est l'auteur de nombreux articles parus notamment dans le journal L'Équipe pour lequel il suivra vingt-sept éditions du Tour de France et sept Jeux Olympiques, et obtient en 1972 le Prix Henri Desgrange de l'Académie des sports. Ses chroniques sur le Tour de France ont contribué à forger la légende de l'épreuve phare du sport cycliste) et la littérature, il laisse une grosse poignée de romans. Buvant souvent plus que de raison « ses amis en étaient venus, lorsqu'ils le croisaient dans la rue, à changer de trottoir de peur que Blondin ne les invite à boire un coup ». Les Enfants du bon Dieu, date de 1952.
Fils de parents bohèmes, Antoine Blondin (1922-1991) a connu la notoriété dès la publication de son premier livre, L'Europe buissonnière, qui capte l'attention d'auteurs comme Marcel Aymé et Roger Nimier qui lui accordent aussitôt leur amitié. Roman couronné en 1950 par le prix des Deux Magots. Se partageant entre le journalisme (il est l'auteur de nombreux articles parus notamment dans le journal L'Équipe pour lequel il suivra vingt-sept éditions du Tour de France et sept Jeux Olympiques, et obtient en 1972 le Prix Henri Desgrange de l'Académie des sports. Ses chroniques sur le Tour de France ont contribué à forger la légende de l'épreuve phare du sport cycliste) et la littérature, il laisse une grosse poignée de romans. Buvant souvent plus que de raison « ses amis en étaient venus, lorsqu'ils le croisaient dans la rue, à changer de trottoir de peur que Blondin ne les invite à boire un coup ». Les Enfants du bon Dieu, date de 1952.
Les bouquins de Blondin, c’est dans les brocantes et vides-greniers que j’en fais l’acquisition, ça leur va bien je trouve. Deux expériences passées – chroniquées ici, je vous laisse chercher – m’avaient réjoui aussi est-ce sans hésitation que je me suis plongé dans ce roman. Mais sachez-le tout de suite, je ne vais pas vous refaire le coup de l’écrivain oublié qu’il faut absolument lire, - du moins pas avec ce roman-là.
Dans le Paris des années 50. Le narrateur, Sébastien Perrin, est professeur d’’histoire aux écoles. Son métier ne le passionne pas vraiment et son mariage bourgeois avec Sophie aurait peut-être perduré sans anicroche si le destin ne l’avait pas remis face à la princesse Albertina d'Arunsberg-Giessen qui fût sa maîtresse quand il séjourna en Allemagne pour cause de S.T.O.
L’intrigue n’est pas bien folichonne et si l’on se cantonnait à ce seul critère, le bouquin serait mauvais. Point barre. N’y trouveront leur compte que ceux qui s’attendrissent à la lecture de textes datés, tant dans la forme que dans le fond, désuets en somme. Mais aussi ceux qui apprécient l’humour discret ou latent, les jeux avec les mots et les situations parfois saugrenues. En fait, le début est très bien, la description de l’immeuble où habite Sébastien et de ses locataires : bien vu, bien torché, poétique, touchant et souriant, le Blondin comme je l’aime. Bien aussi, en fil rouge pour ainsi dire, l’Histoire de France revisitée par l’écrivain. Mais ces bons points ne suffisent pas à sauver le roman, même s’il reste fréquentable pour les curieux et fouineurs des brocantes.
« Le vicomte n’a pas d’histoire. Sa femme lui en fait une. A contempler notre avenue qui file vers le viaduc du métro, elle a peur qu’on croie qu’elle habite dans l’arrondissement voisin. Effectivement, il s’en faut d’un rien. Elle en mourrait. C’est un bel arrondissement chaud, tout grouillant de commères, de crocheteurs et de camelots ; un village déjà, parmi ceux qui font à Paris une ceinture de flanelle rouge. Pour mettre les choses au point, elle donne des réceptions où son mari manque d’assurance. Le soir, ils s’injurient en lavant la vaisselle : trois invités se sont trompés, ils sont arrivés par la station « Cambronne ». C’est du propre. »
 Antoine Blondin Les Enfants du bon Dieu Club du meilleur livre - 249 pages –
Antoine Blondin Les Enfants du bon Dieu Club du meilleur livre - 249 pages –
26/12/2016 | Lien permanent | Commentaires (6)
Scholastique Mukasonga : La Vache du roi Musinga
 Scholastique Mukasonga, née en 1956, est une écrivaine rwandaise d'expression française. Elle connaît dès l’enfance la violence et les humiliations des conflits politiques qui agitent le Rwanda. En 1960, sa famille est déplacée dans une région insalubre du pays et en 1973 elle est chassée de l’école d’assistante sociale de Butare et doit s’exiler au Burundi avant de s’établir en France en 1992. En 1994, année du génocide des Tutsi, elle apprend que 27 membres de sa famille ont été massacrés, dont sa mère.
Scholastique Mukasonga, née en 1956, est une écrivaine rwandaise d'expression française. Elle connaît dès l’enfance la violence et les humiliations des conflits politiques qui agitent le Rwanda. En 1960, sa famille est déplacée dans une région insalubre du pays et en 1973 elle est chassée de l’école d’assistante sociale de Butare et doit s’exiler au Burundi avant de s’établir en France en 1992. En 1994, année du génocide des Tutsi, elle apprend que 27 membres de sa famille ont été massacrés, dont sa mère.
En 2014 parait, Ce que murmurent les collines, un recueil de six nouvelles. La présente édition de poche, nommée La Vache du roi Musinga, contient trois de ces textes et permet d’approcher l’univers de l’écrivain.
Bizarrement, c’est la nouvelle donnant son titre au bouquin qui m’a le moins plu. Très certainement n’en ai-je pas cerné la portée profonde mais les références à l’histoire du pays ou ses légendes me sont passées au-dessus de la tête et pour le dire plus crûment m’ont légèrement ennuyé. Par contre j’ai bien aimé les deux autres textes, Le Bois de la croix et Un Pygmée à l’école. Beaucoup plus simples à comprendre, ils mettent mieux en valeur l’écriture de Scholastique Mukasonga, légère et aérienne, alors qu’en fait tout n’est que tristesse ou émotion esquissées.
Dans Le Bois de la croix, il est question de religion, celle des Pères missionnaires et des croyances locales ancestrales avec des allusions discrètes à la sexualité interdite des religieux blancs, et la narratrice encore enfant, obtenant son diplôme scolaire puis partant à l’internat dans la grande ville, loin de sa famille et premiers pas vers l’exil à venir. Un Pygmée à l’école, comme le titre l’indique, est une courte fable sur le racisme – une attitude universellement partagée. Un gamin d’origine Pygmée, soutenu par un prêtre contre l’avis des enseignants ruandais accède à l’école. Mis à l’écart mais secret ami de la narratrice et de ses deux copines, il s’avérera le plus doué de la classe mais ce n’est qu’en s’exilant dans un autre pays africain qu’il connaitra devenu un homme, un brillant avenir.
Dans tous les textes, même si l’auteure ne le dénonce pas franchement, nous sommes dans une société africaine sous la coupe de l’homme Blanc, ses prêtres missionnaires ou ses autorités politiques. Les natifs, selon leur caractère ou la situation, adoptent des attitudes différentes vis-à-vis de la religion qu’on veut leur inculquer, soit la ruse « - Les Pères te racontent leurs histoires. Moi, je vais te raconter l’histoire de l’arbre géant et de sa forêt comme ma mère me l’a racontée. » Soit le pragmatisme, « Il faut que, toi aussi, tu acceptes comme les autres le Rwanda que nous fabriquent les Blancs. »
Un gentil petit recueil qui ne m’a pas déplu du tout mais qui ne m’a pas emballé plus que ça, non plus. Mais comme l’ouvrage est court et son prix plus que modique, le détour en vaut la chandelle ne serait-ce que pour découvrir Scholastique Mukasonga.
« Certains prétendaient – et c’étaient certainement les gens de Kivumu qui faisaient courir le bruit – que les Blancs étaient venus pour s’emparer de nos morts et les rendre malveillants, plus malveillants qu’ils ne le sont déjà, à l’égard des pauvres Rwandais vivants. On avait remarqué en effet qu’ils étaient toujours à la recherche des mourants. Quand un de leurs boys signalait que, sur une colline, quelqu’un allait mourir, qu’un bébé qui venait de naître ne survivrait pas, un père accourait aussitôt et lui versait de l’eau sur la tête, et le malade, le vieillard ou le bébé mourait peu après. Comment pouvions-nous savoir, disait ma mère, que c’était ça le baptême qui faisait monter directement au ciel ? Quand on voyait un père s’approcher d’un enclos, on disait : « Quelqu’un va mourir », et on s’enfuyait. » [Le Bois et la croix]
 Scholastique Mukasonga La Vache du roi Musinga Folio 2 euros – 107 pages –
Scholastique Mukasonga La Vache du roi Musinga Folio 2 euros – 107 pages –
30/06/2016 | Lien permanent | Commentaires (4)
Paolo Rumiz : La Légende des montagnes qui naviguent
 Paolo Rumiz, né en 1947 à Trieste, est un journaliste et écrivain voyageur italien. Envoyé spécial au journal Il Piccolo de Trieste, puis à la rédaction de La Repubblica, il couvre en 1986 les événements de la zone balkanique. Pendant la dissolution de la Yougoslavie, il suit en première ligne le conflit de la Croatie puis celui de Bosnie-Herzégovine. En novembre 2001 il est à Islamabad puis à Kaboul, pour couvrir l'attaque des Etats-Unis en Afghanistan. En tant qu'écrivain voyageur, Paolo Rumiz a parcouru de nombreux pays, notamment le long des frontières de la communauté européenne. La Légende des montagnes qui naviguent, est son nouvel ouvrage.
Paolo Rumiz, né en 1947 à Trieste, est un journaliste et écrivain voyageur italien. Envoyé spécial au journal Il Piccolo de Trieste, puis à la rédaction de La Repubblica, il couvre en 1986 les événements de la zone balkanique. Pendant la dissolution de la Yougoslavie, il suit en première ligne le conflit de la Croatie puis celui de Bosnie-Herzégovine. En novembre 2001 il est à Islamabad puis à Kaboul, pour couvrir l'attaque des Etats-Unis en Afghanistan. En tant qu'écrivain voyageur, Paolo Rumiz a parcouru de nombreux pays, notamment le long des frontières de la communauté européenne. La Légende des montagnes qui naviguent, est son nouvel ouvrage.
Un périple de huit mille kilomètres, de la baie de Kvarner en Croatie jusqu’au Capo Sud italien, Paolo Rumiz chevauche les deux grands ensembles montagneux de l’Europe, Alpes et Apennins, passant par les Balkans, la France, la Suisse et bien sûr l’Italie. Parti de la mer, il arrive à la mer. Un voyage qui s’étale entre 2003 et 2006, empruntant divers modes de locomotion mais on retiendra particulièrement sa voiture, une Fiat 500 (la Topolino).
Un récit particulièrement dense qu’on s’étonne de voir condenser dans si peu de pages finalement. L’écrivain aime les gens, tout son voyage n’est fait que de rencontres avec des personnages, quelques uns connus (comme Jörg Haider (1950-2008) le politique populiste autrichien) mais le plus souvent des inconnus extraordinaires, paysans, bergers, écrivains, artisans, vieillards… tous, porteurs d’une philosophie de vie et mémoire encore vivante du passé proche. Conséquence directe, si vous n’avez qu’un livre en main, celui-ci recèle mille histoires ébouriffantes et passionnantes.
Impossible de résumer la diversité des sujets abordés car l’auteur, cultivé, sait marier avec une facilité déconcertante, l’Histoire et les petites histoires locales, la géographie, l’écologie comme l’économie, la politique et les sciences sociales, la philosophie… que sais-je encore ? Il y a donc des reconstitutions historiques, des ours et des loups, Ötzi la fameuse momie décongelée, les migrants et les frontières disparues, des régions dépenaillées et d’autres où tout est réglé comme des horloges.
De ce long voyage, se dessine en creux, une Europe partagée : un vieux continent coincé entre la modernité qui se retranche derrière l’économie et son bras armé le commerce, et de l’autre cette Europe chargée de nostalgie et de bon sens, celle des traditions qui ne faisaient qu’un de l’homme et de la terre. Le combat semble inégal mais n’interdit pas la résistance de certains.
Les premières pages m’ont paru un peu difficiles mais bien vite, l’écriture parfaite de Paolo Rumiz vous embarque (« dans un silence venteux de marmotte » superbe autant que mystérieux, non ?) dans un inoubliable périple.
Une lecture chaudement recommandée !
« La maison du crucifié. C’était là que je dormirais. Les éclairs illuminaient un démon en bois, installé juste au-dessous du toit pour monter la garde. Mais c’était le Christ qui faisait peur, cloué un peu plus bas. Ruisselant de pluie, il était accroché à la maison, en plein orage. A l’origine, il se trouvait dans l’église du village, mais le curé s’en était débarrassé, parce qu’il faisait pleurer les petits enfants. « Alors je l’ai pris chez moi », me dit Max en me montrant le chemin de ma chambre. Un Christ refusé par le prêtre, ça ne porte pas bonheur, me dis-je. Mais son visage et ses membres désarticulés, sa douleur terrestre et indicible exprimaient l’essence même de cette amère région qu’est la Carnie. »
 Paolo Rumiz La Légende des montagnes qui naviguent Arthaud – 457 pages – (Parution le 6 septembre 2017)
Paolo Rumiz La Légende des montagnes qui naviguent Arthaud – 457 pages – (Parution le 6 septembre 2017)
Traduit de l’italien par Béatrice Vierne
« Les Apennins n’en finissent jamais. Mais se les farcir dans une Topolino qui date de 1953, là, c’est du délire. (…) Une voiture sympathique, dépourvue d’arrogance, capable d’éveiller des souvenirs, de la curiosité, de la nostalgie ; parfaite pour favoriser les rencontres. » [p.242]

04/09/2017 | Lien permanent


