Rechercher : grenier
Roger Grenier : Le Palais des livres
 Roger Grenier, né en 1919 à Caen dans le Calvados, est un écrivain, journaliste et homme de radio français. Pendant la guerre, Roger Grenier suit les cours de Gaston Bachelard à la Sorbonne avant de participer en 1944 à la libération de Paris. Il est ensuite engagé par Albert Camus dans l'équipe de Combat, puis à France-Soir. Journaliste, il suivra de près les procès de la Libération auxquels il consacrera son premier essai en 1949 sous le titre Le Rôle d'accusé. Homme de radio, scénariste pour la télévision et le cinéma, membre du comité de lecture des éditions Gallimard depuis novembre 1963, il reçoit le Grand prix de littérature de l'Académie française en 1985 pour l'ensemble de son œuvre qui compte aujourd’hui une trentaine d'ouvrages, romans, essais et nouvelles.
Roger Grenier, né en 1919 à Caen dans le Calvados, est un écrivain, journaliste et homme de radio français. Pendant la guerre, Roger Grenier suit les cours de Gaston Bachelard à la Sorbonne avant de participer en 1944 à la libération de Paris. Il est ensuite engagé par Albert Camus dans l'équipe de Combat, puis à France-Soir. Journaliste, il suivra de près les procès de la Libération auxquels il consacrera son premier essai en 1949 sous le titre Le Rôle d'accusé. Homme de radio, scénariste pour la télévision et le cinéma, membre du comité de lecture des éditions Gallimard depuis novembre 1963, il reçoit le Grand prix de littérature de l'Académie française en 1985 pour l'ensemble de son œuvre qui compte aujourd’hui une trentaine d'ouvrages, romans, essais et nouvelles.
Le présent livre, publié initialement en 2011, est un essai sur la littérature, composé de neuf textes parus précédemment pour certains, dans différentes revues. Neuf angles différents pour nous parler des livres mais surtout de leurs auteurs, pour entrer dans la peau de l’écrivain, ce qui le motive. Roger Grenier s’appuie sur mille et une références littéraires, titres d’ouvrages, citations, écrivains, cet étalage de culture impressionne tout en restant très accessible à tous.
Il sera donc question ici : du rôle des faits divers dans l’inspiration des écrivains, de l’amour (« Donc, à quelques exceptions près, la grande affaire du roman, c’est l’amour. »), de ce genre littéraire qu’on appelle « la nouvelle » (« elle prend son essor, dans un pays et à une époque donnés, lorsqu’il existe une presse et des revues capables de faire vivre les auteurs. »), des œuvres posthumes, inachevées ou abandonnées, ou encore du besoin d’écrire, des motivations diverses des écrivains dont l’une effraie un peu, « Mais on écrit le plus souvent parce que l’on est trop seul »…
Deux textes m’ont particulièrement frappé, « S’en aller », qui aborde le problème du suicide et du droit de se contredire, toujours avec citations ou écrivains en références ; et « Vie privée », où Grenier s’interroge, « Est-ce que connaitre la vie privée d’un auteur est important pour comprendre son œuvre ? » tout en abordant aussi la technique d’écriture avec l’emploi du « Je », ou bien le rôle de la mémoire…
Tout cela m’a passionné et si (seule petite critique) le premier texte m’a paru légèrement complexe à lire, ne vous laissez pas impressionner, cet essai extrêmement intéressant – pour ceux qui aiment entrer dans la cuisine des écrivains – tout autant que cultivé, est d’un abord très aisé. Le genre de petit bouquin indispensable pour tous les amoureux des livres, des lectures et fatalement des écrivains. Un livre dans lequel on souligne beaucoup de passages pour mieux y revenir plus tard, comme ce « … le paradoxe fondamental du roman demeure. Il est une fiction, un récit mensonger qui nous permet de rechercher et de découvrir la vérité des hommes et du monde. »
« La durée de la vie humaine, qui ne cesse d’augmenter, est plus longue que celle de l’amour. Plus longue que celle de l’amitié, des goûts littéraires, musicaux, artistiques. J’ai éprouvé de grandes passions pour des auteurs qui aujourd’hui ne m’intéressent guère. Ou bien mes préoccupations ont changé et ne sont plus celles qu’ils exprimaient. Ou bien j’ai fait le tour de ces écrivains et je n’ai plus de plaisir à les fréquenter. Ou bien trop de gens se sont mis à les aimer et cela a gâté l’amitié un peu exclusive que j’avais pour eux (ce qui n’est pas un beau sentiment). Ou bien encore ma frivolité m’a ôté le courage de retourner les lire, et je ne les vénère plus que de loin. Sans parler des dieux de notre enfance. L’âge mûr nous fait découvrir que nous avions adoré des idoles creuses. »
 Roger Grenier Le Palais des livres Folio – 195 pages -
Roger Grenier Le Palais des livres Folio – 195 pages -
15/07/2016 | Lien permanent | Commentaires (2)
Gabrielle Wittkop : Les Héritages
 Gabrielle Wittkop née Gabrielle Ménardeau (1920-2002), est une femme de lettres française et traductrice. Elle est l'auteure d'une littérature dérangeante, macabre, bien souvent au-delà de toute morale. Son style, ainsi que ses centres d'intérêt (thanatos, sexe, identité de genre, étrangeté) apparentent son œuvre à celles du Marquis de Sade, de Villiers de L'Isle Adam, de Lautréamont ou d'Edgar Allan Poe. Elle rencontre dans le Paris sous occupation nazie un déserteur allemand homosexuel du nom de Justus Wittkop, âgé de vingt ans de plus qu'elle. Ils se marient à la fin de la guerre, union qu'elle qualifiera d'« alliance intellectuelle », elle-même affichant à diverses reprises son homosexualité. Le couple s'installe en Allemagne où Gabrielle Wittkop vivra jusqu'à sa mort d’un probable suicide ( ?) atteinte d’un cancer au poumon. Les Héritages, roman inédit, vient de paraître.
Gabrielle Wittkop née Gabrielle Ménardeau (1920-2002), est une femme de lettres française et traductrice. Elle est l'auteure d'une littérature dérangeante, macabre, bien souvent au-delà de toute morale. Son style, ainsi que ses centres d'intérêt (thanatos, sexe, identité de genre, étrangeté) apparentent son œuvre à celles du Marquis de Sade, de Villiers de L'Isle Adam, de Lautréamont ou d'Edgar Allan Poe. Elle rencontre dans le Paris sous occupation nazie un déserteur allemand homosexuel du nom de Justus Wittkop, âgé de vingt ans de plus qu'elle. Ils se marient à la fin de la guerre, union qu'elle qualifiera d'« alliance intellectuelle », elle-même affichant à diverses reprises son homosexualité. Le couple s'installe en Allemagne où Gabrielle Wittkop vivra jusqu'à sa mort d’un probable suicide ( ?) atteinte d’un cancer au poumon. Les Héritages, roman inédit, vient de paraître.
En 1895, Célestin Mercier fait construire une villa – Séléné - en bord de Marne et finit par s’y pendre ! La maison désormais hantée, connaitra plusieurs propriétaires et de multiples locataires durant un siècle, jusqu’en 1995, date à laquelle elle sera détruite, devenue insalubre, mais laissant place à un vaste terrain riche en profit immobilier.
Le roman est assez mince, pourtant Gabrielle Wittkop réussit à en faire une sorte de mini « comédie humaine » en y casant une ribambelle de personnages – dont beaucoup vont mourir - de toutes les catégories sociales qui traverseront le siècle et ses remous. Pour ne citer que quelques figures par ordre d’entrée en scène, vous y trouverez un amateur de roulette russe, une artiste qui peint ses visions, un inspecteur de police accordéoniste frustré, un couple homosexuel avec un corbeau, un pharmacien exhibitionniste, un égyptologue britannique, le rat Astérix etc.
Pour les époques et donc l’Histoire, la Grande guerre, la Seconde avec l’Occupation et une famille Juive cachée dans le sous-sol, les années Sida. L’écrivaine n’oublie pas les amours homosexuelles, le féminisme et un chouya de fantastique mineur avec le « petit sac de moleskine noire » qui apparaît et disparaît tout du long du roman, vestige du pendu d’origine.
Tout ceci vous semble disparate ou hétéroclite, sachez pourtant que l’intérêt principal de ce bouquin réside dans son écriture. Un style extrêmement personnel, qui marie quelque chose du style XIXème avec des phrases alambiquées mais ciselées, un vocabulaire recherché, mêlé à un ton très moderne qui n’exclut pas l’humour (« Joachim Soupé ferma définitivement ses yeux de cygne, à l’âge de quatre-vingt-sept ans, se disant peut-être qu’il partait pour le ciel, puisque là les potes iront. »)
J’ai trouvé ce livre particulièrement intrigant. Si pour vous la lecture va au-delà de la simple histoire/intrigue d’un roman, goûtez cette écrivaine à la saveur originale ; quant à moi, je me promets d’en reprendre une lampée avec un ouvrage plus corsé puisque aux dires de sa biographie elle a écrit des romans plus musclés ( ?).
« Comme tout chasseur, Jacques Grenier haïssait les chats dont il ne pouvait souffrir la concurrence. (…) Aussi, quand au volant de sa grosse Mercedes il apercevait quelque chat courant le long de la route ou la traversant, donnait-il du gaz et, dirigeant adroitement la voiture, allait-il écraser l’infâme, ce dont il tirait une immense satisfaction. Or un soir qu’ayant aperçu un grand chat roux dans la lueur des phares il fonçait sur lui, un camion venant en sens inverse emboutit frontalement la Mercedes de Jacques Grenier. On l’en retira à la cuiller, après une mort beaucoup trop prompte, cependant que le grand chat roux était déjà retourné sans encombres à ses chasses, rare exemple d’une immanente justice. »
 Gabrielle Wittkop Les Héritages Christian Bourgois Editeur – 170 pages –
Gabrielle Wittkop Les Héritages Christian Bourgois Editeur – 170 pages –
19/11/2020 | Lien permanent | Commentaires (6)
Joan Samson : Délivrez-nous du bien
 Joan Samson (1937-1976) est une écrivaine américaine. En 1975, bien qu’elle ne se soit jamais essayée à la fiction, elle se décide à écrire une nouvelle d’une dizaine de pages sur l’arrivée dans un village du New Hampshire d’un étranger venu de la ville. L’idée lui serait venue d’un cauchemar. Ce texte devenu roman paraitra en janvier 1976 et en peu de temps se hisse sur la liste des meilleures ventes. Ce sera son unique roman car Joan Samson meurt à l'âge de 38 ans, d’un cancer du cerveau, quelques semaines après la parution de ce livre qui vient enfin d’être traduit.
Joan Samson (1937-1976) est une écrivaine américaine. En 1975, bien qu’elle ne se soit jamais essayée à la fiction, elle se décide à écrire une nouvelle d’une dizaine de pages sur l’arrivée dans un village du New Hampshire d’un étranger venu de la ville. L’idée lui serait venue d’un cauchemar. Ce texte devenu roman paraitra en janvier 1976 et en peu de temps se hisse sur la liste des meilleures ventes. Ce sera son unique roman car Joan Samson meurt à l'âge de 38 ans, d’un cancer du cerveau, quelques semaines après la parution de ce livre qui vient enfin d’être traduit.
Harlowe, une petite ville rurale du New Hampshire non loin de Boston. John Moore et sa famille, Mim son épouse, Hildie leur fillette et Ma, sa mère, vivent heureux et tranquilles du travail de leurs terres. Enfin tout ça c’était avant que n’arrive en ville, Perly Dunsmore, un inconnu, commissaire-priseur de son état, beau parleur doté d’un certain charme. Très vite il organise avec le shérif des enchères publiques pour doter la police locale de moyens supplémentaires afin de lutter contre la violence des grandes villes qui pourrait déborder jusqu’ici, sans avoir à augmenter les impôts locaux. Le nombre de policier augmente et les habitants donnent volontiers ce qui encombre leurs caves et greniers pour alimenter les ventes qui attirent des villes alentour de potentiels acheteurs. Chaque semaine les ventes se succèdent, chaque jeudi Perly et le shérif se présentent chez les habitants pour réclamer des objets… réclamer ou réquisitionner ?
Quel roman !
Une intrigue qui débute gentiment, un village tranquille, une collecte de vieux objets et encombrants vendus au profit de la sécurité générale, puis lentement quand les greniers sont vidés, Perly soutire habilement à leurs propriétaires des objets de leur quotidien qui soi-disant ne leur servent pas ou plus. S’exprimant bien, paroles douces, gentillesse apparente envers les enfants ou les personnes âgées, quelques petits billets, un pourcentage modeste sur les ventes de leurs biens, le tout enveloppé dans le désir de sauvegarder les valeurs morales de l’ancien temps… Son pouvoir de persuasion tout en subtilité monte en puissance, les maisons sont vidées, les meubles, le bétail, les tracteurs… Un vaste projet immobilier est envisagé et il a besoin de « dégager » les occupants des terres visées.
Une lecture qui met mal à l’aise le lecteur. On assiste impuissant à la dépossession de leurs biens de braves gens, qui ne s’en rendent pas compte dans un premier temps, puis cèdent par peur : si résister était pire que d’être appauvri ? D’autant que ceux qui bronchent légèrement sont victimes d’accidents. Les Moore rouscaillent dans leur coin mais cèdent leurs affaires, se promettant que c’est la dernière fois, et le jeudi suivant, rebelote !
L’angoisse monte, l’agacement de ne voir aucune réaction, la rage devant l’emprise malfaisante et s’élargissant de Perly, ses partisans qui surveillent tout le monde et John qui semble bien faible. Jusqu’à quand ?
Excellent roman. Une formidable allégorie ou métaphore intemporelle sur la soumission. Chaque lecteur pourra y voir une allusion à des faits récents ou en cours, chez nous ou à l’étranger.
« - Mim, écoute-moi, dit-il en l’attirant sous les couvertures. Les choses sont ce qu’elles sont. Mais ils ne peuvent pas te prendre la chair de ta chair. Et ils ne peuvent pas prendre la terre, parce qu’on est dessus. – Des mots, John. Ca, ça ne les arrête pas. Qu’est-ce qu’ils ont fait tout cet été et cet automne ? – C’est encore l’Amérique. Ils peuvent pas. Il y a des limites. – Réfléchis. Toute la terre sous les grandes villes, c’étaient des fermes avant. Et d’une façon, je ne sais pas comment, ils ont fait partir les fermiers. »
 Joan Samson Délivrez-nous du bien Monsieur Toussaint Louverture - 296 pages -
Joan Samson Délivrez-nous du bien Monsieur Toussaint Louverture - 296 pages -
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Laurent Vannini
12/02/2024 | Lien permanent | Commentaires (2)
Louis Guilloux à Paris
 Louis Guilloux, né et mort à Saint-Brieuc (1899-1980), est un écrivain français. Grâce à une bourse il entre au lycée de Saint-Brieuc où il s'y lie d'amitié avec le professeur de philosophie Georges Palante (Il s’en inspirera pour composer le personnage de Cripure, héros du Sang Noir) et découvre Romain Rolland et Jules Valles dont il partagera la révolte. Durant la Première Guerre mondiale, en 1916, il est surveillant d'internat et l’année suivante il rencontre Jean Grenier, futur professeur d'Albert Camus et philosophe.
Louis Guilloux, né et mort à Saint-Brieuc (1899-1980), est un écrivain français. Grâce à une bourse il entre au lycée de Saint-Brieuc où il s'y lie d'amitié avec le professeur de philosophie Georges Palante (Il s’en inspirera pour composer le personnage de Cripure, héros du Sang Noir) et découvre Romain Rolland et Jules Valles dont il partagera la révolte. Durant la Première Guerre mondiale, en 1916, il est surveillant d'internat et l’année suivante il rencontre Jean Grenier, futur professeur d'Albert Camus et philosophe.
En 1920, il commence à écrire des récits et des contes qui sont ensuite publiés dans des journaux (Le Peuple, Ce soir...). En 1922, il devient « lecteur d'anglais » et traducteur pour le journal L'Intransigeant. Plus tard, il sera le traducteur de l'écrivain Margaret Kennedy, mais également de l'auteur américain Claude McKay (Home to Harlem), de John Steinbeck pour Les Pâturages du ciel (1948), et avec Didier Robert, d'une partie de la série des Hornblower, romans de marine de C. S. Forester.
Le premier roman de Louis Guilloux, La Maison du peuple, paraît en 1927. En 1935, Le Sang noir, manque de peu le prix Goncourt mais il est remarqué par André Malraux qui lui consacre dans Marianne (20 novembre 1935) un important article, puis par André Gide, qui en 1936 invite Guilloux à l'accompagner dans son célèbre voyage en URSS.
Auteur engagé, il signe la pétition parue le 15 avril 1927 dans la revue Europe contre la loi sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre qui abroge toute indépendance intellectuelle et toute liberté d’opinion. Son nom côtoie ceux d'Alain, Raymond Aron, Lucien Descaves, Henry Poulaille ou Jules Romains. En 1935, il participe au 1er congrès mondial des écrivains antifascistes et en devient le secrétaire, puis devient responsable pour les Côtes-du-Nord du « Secours rouge », ancêtre du « Secours populaire », qui vient en aide aux chômeurs et aux réfugiés espagnols. Durant la Seconde Guerre mondiale, sa maison de Saint-Brieuc au 13 rue Lavoisier est un lieu de rencontre de résistants. En 1942, il écrit Le Pain des rêves, qui reçoit le Prix du roman populiste.
Ecrivain majeur des années 1930, très engagé socialement, Louis Guilloux partagea sa vie entre Saint-Brieuc, sa ville natale à laquelle il était très attaché et qui sert de décors à plusieurs de ses livres et un petit studio parisien situé au 42 rue du Dragon, dans le sixième arrondissement, entre la rue du Four et le boulevard Saint-Germain.
Photos : Le Bouquineur Sources : Promenades littéraires dans Paris de Gilles Schlesser (Editions Parigramme) – Wikipédia
12/11/2017 | Lien permanent
Gustav Meyrink et Prague
 Gustav Meyrink est autrichien (1868-1932) et l’un des principaux écrivains de littérature fantastique en langue allemande. Ses œuvres sont fortement inspirées des sciences occultes dont il était un adepte. Si j’associe Meyrink et Prague (en Tchéquie) c’est que l’écrivain y vécu durant une vingtaine d’années et l’a beaucoup utilisée dans ses romans, je pense particulièrement à ses bouquins les plus connus, Le Golem et La Nuit de Walpurgis.
Gustav Meyrink est autrichien (1868-1932) et l’un des principaux écrivains de littérature fantastique en langue allemande. Ses œuvres sont fortement inspirées des sciences occultes dont il était un adepte. Si j’associe Meyrink et Prague (en Tchéquie) c’est que l’écrivain y vécu durant une vingtaine d’années et l’a beaucoup utilisée dans ses romans, je pense particulièrement à ses bouquins les plus connus, Le Golem et La Nuit de Walpurgis.
C'est en 1915 que Meyrink publia son premier roman, Le Golem. Le livre fut un succès énorme, il fut souvent réédité et fit l'objet de plusieurs adaptations cinématographiques par la suite. Un bouquin qui marqua tellement mon imagination jadis que lorsque je suis allé visiter Prague il y a deux ans, j’avais sans cesse à l’esprit ce Golem dont l’ombre me suivait partout dans les ruelles de la vieille ville et particulièrement dans l’ancien ghetto Juif. Revenons sur cette créature étrange…
« C’est alors que resurgit secrètement en moi la légende du Golem, cet être artificiel qu’un rabbin cabaliste a créé autrefois à partir de l’élément, ici même, dans ce ghetto, l’appelant à une existence machinale, sans pensée, grâce à un mot magique qu’il lui avait glissé derrière les dents. »
Il y eut des golems partout en Europe Centrale, mais seul celui de Prague devint célèbre. C’est rabbi Löw (1520-1609) qui en serait le créateur. Fabriqué avec de la glaise de la Vltava, le fleuve qui traverse Prague, et lui donnant l’apparence humaine, « la chose » s’animait quand le rabbi lui plaçait dans la bouche un chem, un morceau de parchemin sur lequel était inscrit le nom de Dieu car dans la tradition juive les lettres hébraïques sont dotées d’une puissance créatrice « qui attire les forces sidérales libres de l’univers ». Le golem était utilisé comme un serviteur possédant de supers pouvoirs « pour sonner les cloches de la synagogue et faire les gros travaux » ainsi que protéger la communauté juive contre les pogroms.
Un jour à la veille du sabbat, le rabbi parti à la prière oublia de retirer le chem de la bouche de l’être de glaise. Golem pris de folie furieuse, mis le ghetto à feu et à sang. Le rabbi Löw réussit à le calmer et le réduire en la poussière dont il était issu, en procédant ainsi : sur le chem était inscrit le mot « Emeth » qui signifie vérité en hébreu mais est aussi un des noms de Dieu. En effaçant le « E » il obtint « Meth » qui veut dire mort. D’après la légende, les restes du Golem reposeraient dans le grenier de la synagogue Vieille-Nouvelle qui est la plus vieille d’Europe, construite en 1270 ses premières pierres proviendraient du Temple de Jérusalem. Quant au rabbi Löw (Juda Liva ben Betsalel, dit rabbi Löw) il est enterré dans le Vieux cimetière juif fondé dans la première moitié du XVe siècle.
« Qui peut dire qu’il sait quelque chose sur le Golem ? On le relègue dans le domaine des légendes jusqu’au jour où un évènement survient dans les ruelles qui lui redonne brusquement vie. Alors pendant un certain temps tout le monde parle de lui, les rumeurs prennent des proportions monstrueuses et elles finissent par devenir si exagérées qu’elles sombrent du fait même de leur invraisemblance. »
Quant à Gustav Meyrink, après le suicide de son fils Fortunat à l’âge de 24 ans – signe du destin auquel il n’a pas dû rester insensible, c’est l’âge auquel Gustav avait failli se suicider lui-même – il survécu six mois avant de s’éteindre le 4 décembre 1932.
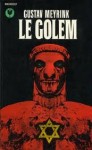 * Toutes les phrases entre guillemets sont extraites de mon édition du roman de Gustav Meyrink Le Golem paru chez Marabout (1969).
* Toutes les phrases entre guillemets sont extraites de mon édition du roman de Gustav Meyrink Le Golem paru chez Marabout (1969).
Source des photos : Le Bouquineur
10/11/2012 | Lien permanent
Alain Paraillous : La vie religieuse des campagnes d’autrefois
 Né en 1947, Alain Paraillous est toujours resté attaché à un monde paysan qu'il a connu dans son enfance sur les coteaux de Saint-Pierre-de-Buzet, dans le Lot-et-Garonne. Devenu professeur de lettres, il a exercé toute sa carrière au lycée d'Aiguillon, à deux lieues de son village qu'il n'a jamais pu se résoudre à quitter. Vers la cinquantaine, voulant laisser une trace de ce monde paysan qui disparaît, il se lance dans l’écriture et compte à ce jour pas loin d’une vingtaine d’ouvrages. La vie religieuse des campagnes d’autrefois est son dernier opus paru.
Né en 1947, Alain Paraillous est toujours resté attaché à un monde paysan qu'il a connu dans son enfance sur les coteaux de Saint-Pierre-de-Buzet, dans le Lot-et-Garonne. Devenu professeur de lettres, il a exercé toute sa carrière au lycée d'Aiguillon, à deux lieues de son village qu'il n'a jamais pu se résoudre à quitter. Vers la cinquantaine, voulant laisser une trace de ce monde paysan qui disparaît, il se lance dans l’écriture et compte à ce jour pas loin d’une vingtaine d’ouvrages. La vie religieuse des campagnes d’autrefois est son dernier opus paru.
Véritable vade-mecum des pratiques religieuses telles qu’elles étaient encore pratiquées durant l’enfance de l’auteur, ce petit bouquin fort sympathique dégage un délicieux fumet d’encens et de poussières mêlés. L’encens pour la religion bien entendu, la poussière car il rouvre la malle de souvenirs oubliés au grenier.
A travers plus d’une trentaine de chapitres, vous pourrez retrouver l’origine d’une fête comme les Cendres, la fête des Rois, ou bien des pratiques comme les processions, la messe en latin. Mais au-delà de l’aspect purement religieux, Alain Paraillous ne perd pas de vue que son propos est de mettre par écrit pour la postérité, la réalité d’un monde qui n’existe plus, ce monde paysan qu’il a fort bien connu puisque ce fut celui de sa propre famille. Son bouquin aborde donc aussi, le rôle de la fanfare de village ou de l’hospitalité paysanne par exemple.
Si le livre peut trouver sa place au rayon sociologie, il s’agit surtout d’un témoignage et non d’une analyse critique, où les souvenirs personnels de l’auteur et de ses parents donnent une touche de véracité incontestable et plaisante à lire.
Même si l’auteur s’en défend en fin d’ouvrage, « les adeptes d’une modernité à tous crins pourront accuser tel ou tel chapitre d’un excès de nostalgie », il est difficile de ne pas y lire une défense pro domo d’un mode de vie regretté et de tomber parfois, dans un léger excès idyllique. Je pense particulièrement au passage concernant les gitans qui auraient été bien accueillis en ce temps-là par les paysans, or il me semble que ce peuple a toujours été l’objet de méfiance depuis la nuit des temps…
Je ne blâme pas l’auteur pour sa nostalgie, car même moi qui suis un enfant de la grande ville exclusivement, j’ai l’impression en lisant ces pages de retrouver mon enfance des années cinquante (la première communion, l’office du dimanche), les années d’avant Vatican II. Souvenirs fantasmés d’une vie rêvée ? Et si la religion n’avait pas une place importante dans ma famille, sa place n’était pas neutre dans notre société alors.
L’écrivain écrit très simplement, utilisant parfois quelques tournures de phrases à l’ancienne, comme on dirait d’un bon pain, ce qui colle parfaitement avec le propos et fait de ce bouquin sans prétentions, une petite pépite que les gens de ma génération et les plus vieux encore, conserveront précieusement dans un coin de leur bibliothèque. Un paradoxe, puisque ce sont les plus jeunes qui devraient le lire pour apprendre ce qu’ils n’ont pas connu !
Sachez aussi, que deux cahiers de photos intercalés dans l’ouvrage viennent le compléter avec bonheur.
« « Faire le deuil » sous-entend qu’après la perte d’un être cher, on va s’habituer peu à peu à la blessure, s’efforcer de tourner la page, rechercher l’oubli,la cicatrice. Jusqu’à ce que la douleur s’apaise. La crémation, souvent suivie de la dispersion des cendres, participe à ce schéma. Plus rien ne doit rester. Tout autre était l’ancienne attitude, issue de l’héritage chrétien : la pierre tombale, avec le nom du défunt, sa date de naissance, celle de sa mort, parfois son portrait sépia sur un médaillon ovale, attestaient du refus d’oublier. »
 Alain Paraillous La vie religieuse des campagnes d’autrefois Editions Sud Ouest
Alain Paraillous La vie religieuse des campagnes d’autrefois Editions Sud Ouest
Une interview d’Alain Paraillous datant de 2009 et à propos d’un autre livre, mais qui donne une idée de l’auteur.
18/02/2013 | Lien permanent
Antoine Blondin : Les Enfants du bon Dieu
 Fils de parents bohèmes, Antoine Blondin (1922-1991) a connu la notoriété dès la publication de son premier livre, L'Europe buissonnière, qui capte l'attention d'auteurs comme Marcel Aymé et Roger Nimier qui lui accordent aussitôt leur amitié. Roman couronné en 1950 par le prix des Deux Magots. Se partageant entre le journalisme (il est l'auteur de nombreux articles parus notamment dans le journal L'Équipe pour lequel il suivra vingt-sept éditions du Tour de France et sept Jeux Olympiques, et obtient en 1972 le Prix Henri Desgrange de l'Académie des sports. Ses chroniques sur le Tour de France ont contribué à forger la légende de l'épreuve phare du sport cycliste) et la littérature, il laisse une grosse poignée de romans. Buvant souvent plus que de raison « ses amis en étaient venus, lorsqu'ils le croisaient dans la rue, à changer de trottoir de peur que Blondin ne les invite à boire un coup ». Les Enfants du bon Dieu, date de 1952.
Fils de parents bohèmes, Antoine Blondin (1922-1991) a connu la notoriété dès la publication de son premier livre, L'Europe buissonnière, qui capte l'attention d'auteurs comme Marcel Aymé et Roger Nimier qui lui accordent aussitôt leur amitié. Roman couronné en 1950 par le prix des Deux Magots. Se partageant entre le journalisme (il est l'auteur de nombreux articles parus notamment dans le journal L'Équipe pour lequel il suivra vingt-sept éditions du Tour de France et sept Jeux Olympiques, et obtient en 1972 le Prix Henri Desgrange de l'Académie des sports. Ses chroniques sur le Tour de France ont contribué à forger la légende de l'épreuve phare du sport cycliste) et la littérature, il laisse une grosse poignée de romans. Buvant souvent plus que de raison « ses amis en étaient venus, lorsqu'ils le croisaient dans la rue, à changer de trottoir de peur que Blondin ne les invite à boire un coup ». Les Enfants du bon Dieu, date de 1952.
Les bouquins de Blondin, c’est dans les brocantes et vides-greniers que j’en fais l’acquisition, ça leur va bien je trouve. Deux expériences passées – chroniquées ici, je vous laisse chercher – m’avaient réjoui aussi est-ce sans hésitation que je me suis plongé dans ce roman. Mais sachez-le tout de suite, je ne vais pas vous refaire le coup de l’écrivain oublié qu’il faut absolument lire, - du moins pas avec ce roman-là.
Dans le Paris des années 50. Le narrateur, Sébastien Perrin, est professeur d’’histoire aux écoles. Son métier ne le passionne pas vraiment et son mariage bourgeois avec Sophie aurait peut-être perduré sans anicroche si le destin ne l’avait pas remis face à la princesse Albertina d'Arunsberg-Giessen qui fût sa maîtresse quand il séjourna en Allemagne pour cause de S.T.O.
L’intrigue n’est pas bien folichonne et si l’on se cantonnait à ce seul critère, le bouquin serait mauvais. Point barre. N’y trouveront leur compte que ceux qui s’attendrissent à la lecture de textes datés, tant dans la forme que dans le fond, désuets en somme. Mais aussi ceux qui apprécient l’humour discret ou latent, les jeux avec les mots et les situations parfois saugrenues. En fait, le début est très bien, la description de l’immeuble où habite Sébastien et de ses locataires : bien vu, bien torché, poétique, touchant et souriant, le Blondin comme je l’aime. Bien aussi, en fil rouge pour ainsi dire, l’Histoire de France revisitée par l’écrivain. Mais ces bons points ne suffisent pas à sauver le roman, même s’il reste fréquentable pour les curieux et fouineurs des brocantes.
« Le vicomte n’a pas d’histoire. Sa femme lui en fait une. A contempler notre avenue qui file vers le viaduc du métro, elle a peur qu’on croie qu’elle habite dans l’arrondissement voisin. Effectivement, il s’en faut d’un rien. Elle en mourrait. C’est un bel arrondissement chaud, tout grouillant de commères, de crocheteurs et de camelots ; un village déjà, parmi ceux qui font à Paris une ceinture de flanelle rouge. Pour mettre les choses au point, elle donne des réceptions où son mari manque d’assurance. Le soir, ils s’injurient en lavant la vaisselle : trois invités se sont trompés, ils sont arrivés par la station « Cambronne ». C’est du propre. »
 Antoine Blondin Les Enfants du bon Dieu Club du meilleur livre - 249 pages –
Antoine Blondin Les Enfants du bon Dieu Club du meilleur livre - 249 pages –
26/12/2016 | Lien permanent | Commentaires (6)
Wallace Stegner : L’Envers du temps
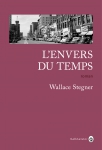 Wallace Earle Stegner (1909-1993) est un écrivain, romancier et historien américain. Né dans l'Iowa, il grandit dans le Montana ainsi qu'à Salt Lake City dans l'Utah et dans le sud de la Saskatchewan. Il a enseigné à l'Université du Wisconsin et à Harvard avant de s'installer à l'Université Stanford où il crée un cours d'écriture créative. Il a été le professeur d'étudiants comme Edward Abbey, Thomas McGuane, Ken Kesey et Larry McMurtry. L’Envers du temps (1979) inédit jusqu’à ce jour, vient de paraître.
Wallace Earle Stegner (1909-1993) est un écrivain, romancier et historien américain. Né dans l'Iowa, il grandit dans le Montana ainsi qu'à Salt Lake City dans l'Utah et dans le sud de la Saskatchewan. Il a enseigné à l'Université du Wisconsin et à Harvard avant de s'installer à l'Université Stanford où il crée un cours d'écriture créative. Il a été le professeur d'étudiants comme Edward Abbey, Thomas McGuane, Ken Kesey et Larry McMurtry. L’Envers du temps (1979) inédit jusqu’à ce jour, vient de paraître.
Bien que considéré comme un romancier écologiste, ce livre n’a rien à faire dans une collection Nature Writing et je ne fais pas là un procès à l’éditeur - qu’au demeurant j’apprécie beaucoup – mais dans le souci d’éclairer un éventuel lecteur. Il n’y a pas ici l’ombre du début de l’esquisse d’un roman de Nature Writing… nous serions plus, mais prenez-le avec des pincettes et des guillemets maousses, proches d’une Virginia Woolf, en plus accessible.
Bruce Mason, le narrateur, est un ambassadeur à la retraite installé à San Francisco. Le décès de sa tante le ramène à Salt Lake City, le temps de l’enterrement, une ville qu’il a quittée en 1932, soit depuis plus de quarante ans et où il a vécu sa jeunesse.
Ce retour inopiné dans la ville qui l’a vu grandir amène Bruce Mason à revivre son passé et se confronter au jeune homme qu’il fut. Sa visite de la cité au volant de sa voiture, ravive des trajets effectués jadis et lui remet des évènements qu’il pensait oubliés en mémoire. Le moindre petit rien éveille un souvenir, « un simple effleurement, et l’épiderme se souvenait ». Il revit donc son enfance auprès de ses parents aujourd’hui décédés, son père détesté tenancier de bar clandestin ou bootlegger itinérant, sa mère chérie complice du fils face à leur triste existence.
Mais il y a aussi cette boite, léguée par sa tante, qui une fois ouverte va s’avérer boite de Pandore, ressuscitant le jeune homme amoureux de Nola, son grand amour d’alors, les virées avec Bailey son copain dessalé ou son ami Mulder. Le narrateur, avec son œil d’aujourd’hui tente de mieux cerner les évènements et les situations d’hier et l’écrivain de disséquer les rapports homme/femme comme ils se présentent parfois.
L’ambassadeur retraité se revoit, gamin malingre alors et souffrant d’un complexe d’infériorité, pris entre un père étranger à sa famille, un copain Bailey trop sûr de lui et bien plus mature et cette vie avec Nola qu’il n’aura pas eue, le laissant célibataire à jamais. Son très court séjour à Salt Lake City sera l’occasion pour Mason de régler définitivement son compte à ce passé trop pesant.
Le roman est relativement dense, très bien écrit, assez détaillé (surtout concernant les vêtements !) avec des astuces narratives qui en épicent la lecture et nous donnent finalement un très bon livre, très fin et qui touche par sa nostalgie induite.
« Dangereux de presser le tube de la nostalgie. Impossible d’y remettre le dentifrice. Le risque était qu’il finisse par verser dans la confusion. Car les côtés sombres qu’il ne pouvait manquer de se remémorer concernant cette ville étaient au moins aussi nombreux que les aspects sentimentaux et plaisants, et le seul fait de chercher à s’y soustraire les faisait remonter à la surface. S’il leur donnait libre cours, ils pouvaient revenir en masse comme des mouches d’automne contre la fenêtre d’un grenier. »
 Wallace Stegner L’Envers du temps Gallmeister – 360 pages –
Wallace Stegner L’Envers du temps Gallmeister – 360 pages –
Traduit de l’américain par Eric Chédaille
21/09/2017 | Lien permanent | Commentaires (3)
Eric Chevillard : Oreille rouge
 Eric Chevillard, né en 1964 à La Roche-sur-Yon, est un écrivain français auteur de très nombreux ouvrages. Son roman, Oreille rouge, date de 2005.
Eric Chevillard, né en 1964 à La Roche-sur-Yon, est un écrivain français auteur de très nombreux ouvrages. Son roman, Oreille rouge, date de 2005.
Le héros du roman est un écrivain invité au Mali pour une résidence d’écriture. Certains sauteraient au plafond d’excitation, pas lui. Notre homme aime ses habitudes et n’est pas un fanatique des voyages (« Au nom de quoi faudrait-il partir ? Et s’il était plus aventureux de rester ? ») mais finalement il va se décider favorablement. Déjà on commence à cerner le bonhomme, les préparatifs ne sont pas une mince affaire pour lui, passeport, vaccins, penser à emporter tout un tas de médicaments… Un début d’intérêt pour ce voyage commence à poindre quand il annonce autour de lui qu’il va partir pour l’Afrique, ça lui donne une petite importance.
Un gentil petit roman qui a certainement beaucoup amusé Eric Chevillard quand il l’a écrit. Le texte est en trois parties, avant, pendant et après le voyage, fait de très courts paragraphes enchainant faits et réflexions divers, toujours sur un mode humoristique léger (« La grenouille ne risquait pas de se faire aussi grosse que le bœuf dans la fontaine : la chose eut donc lieu dans le fleuve. »).
Le thème du bouquin est donc le voyage. Le voyage vers l’exotique Afrique et qui plus est, par un écrivain sensé en retirer quelque chose, genre littérature de voyage. Notre homme se propose ainsi d’écrire le grand poème de l’Afrique, pas moins. Vous l’avez compris, Eric Chevillard fait dans la satire, satire douce et molle, mais satire quand même.
Muni d’un petit carnet en moleskine, l’arme absolue de l’écrivain-voyageur, notre homme au Mali y consigne des faits insignifiants, compile les idées reçues et les images convenues, tout en s’imaginant et s’étonnant lui-même d’être un grand voyageur. Venir ici et ne pas croiser d’hippopotames, serait une hérésie, vous allez tout savoir du bestiau en lisant ce bouquin. De retour en France, tout comme les soirées diapos d’autrefois saoulaient les malheureux amis conviés, la ramener sans arrêt pour tout et n’importe quoi, en se référant au Mali finit par lasser les proches les plus aimables.
Notons que certains passages sont assez poétiques, litote polie pour dire qu’on ne comprend pas trop ce que veux dire l’écrivain à cet instant. Alors que dire pour conclure ? Certes c’est amusant et souvent bien vu mais comment dire, c’est un peu lisse, ça manque d’aspérités (dans le sens positif ou négatif) pour en faire une tartine.
« Je passerais volontiers le restant de mes jours dans un de vos jolis petits greniers à mil ! s’écrie-t-il. C'est-à-dire qu’il y tiendrait une heure, puis ferait jouer son assurance rapatriement. Il circule parmi les étals avec l’air faussement préoccupé d’un qui vaque à de très importantes affaires pour cacher son malaise. La viande et le poisson sont frais pourtant : ils bourdonnent encore. Oreille rouge jaunissant presse le pas mais son nez ne saurait être aussi distrait que son œil qui se détourne et devient blanc. C’est ainsi qu’il visite le marché dont il vantera le soir même dans ses lettres la joyeuse animation. »
 Eric Chevillard Oreille rouge Les Editions de Minuit – 159 pages -
Eric Chevillard Oreille rouge Les Editions de Minuit – 159 pages -
15/04/2019 | Lien permanent
Le livre en odeur de sainteté
Je suis certain que beaucoup d’entre vous tout comme moi, ont déjà eu cette envie folle qu’on ne réalise que lorsque nous sommes à l’abri du regard des autres, plonger son nez au plus profond du sillon entre les pages d’un livre, pour en humer la délicieuse odeur. Car oui, les livres ont une odeur, du moins certains d’entre eux.
De mon expérience et armé de mon seul tarin qui n’a rien d’exceptionnel, je crois pouvoir dire qu’il y a deux sortes d’odeurs, celle des livres neufs et celle des vieux livres. Un tarbouif plus exercé y dénichera peut-être des nuances qui m’échappent, je me contenterai de mes deux options.
Le livre neuf il sent le neuf ! Lapalissade mais qui exprime bien ce qu’on ressent quand on ouvre l’ouvrage. Nulle main ne l’a touché avant nous, peut-être même que les pages craquent d’être écartées et déflorées même si on s’y prend avec la plus extrême délicatesse. J’écarte les feuillets à deux mains et lentement je plonge mon nez dans ce fumet promesse d’une découverte, à chaque fois renouvelée, une nouvelle aventure sensuelle, une nouvelle lecture. Vite, je referme le livre, le temps que mes fosses nasales et mes poumons se grisent de ce parfum entêtant. Et puis j’y retourne… Désormais ce livre est à moi, il m’a livré son intimité embaumée, nous allons pouvoir faire connaissance plus pleinement par la conversation entre l’auteur et son lecteur.
Le livre neuf ne sent pas toujours bon, certains ne sentent rien du tout mais entre les deux, je préfère encore le premier. Au moins a-t-il sa particularité, sa caractéristique. Si sa lecture m’a plu, j’oublierai son relent ; et s’il m’a déplu, sa puanteur ajoutera à mon agacement, « nul et puant, une lecture à éviter ! »
Reconnaissons néanmoins que le livre neuf, quand il sent, dégage une odeur chimique. Celle du mélange complexe des substances résultant de l’impression du livre, de la création de sa jaquette et des colles servant à l’assemblage. Toutes choses qui ne m’intéressent pas trop mais qui ont attiré le monde de la parfumerie puisque j’ai découvert qu’on vendait des parfums « aux eaux de bookstores » !
Et que dire de l’odeur des vieux livres ! Par définition, le vieux livre a vécu, il a un passé et de toutes ses années, ses passages de mains en mains, les épreuves qu’il a peut-être subies, le temps l’a marqué d’odeurs diverses et variées. La poussière, la saleté, les taches alimentaires éventuellement, comme le café ou le chocolat, d’autres moins ragoutantes (sang…) l’ont souillé. La moisissure, le papier vieilli qui se flétrit lui donnent une certaine noblesse. Celui-là on le respire avec respect, on y recherche l’impossible, découvrir/décrypter son histoire par l’odorat. On imagine, on suppute, on joint nos hypothèses à nos propres souvenirs, d’un livre inconnu aux odeurs incertaines on fait une madeleine de Proust espérant que le fumet nous livre ses secrets. Autant dire que les vieilles librairies de province, les vide-greniers, sont mes cuisines préférées, là où mon flaire me guide pour mes emplettes.
Jeunes gens, faites profiter vos narines de l’odeur des vieux livres de vos grands-parents ou parents, plus tard quand vous-mêmes serez vieux, les vieux livres de votre jeunesse ne sentiront pas la même chose, car les procédés de fabrication n’étant pas les mêmes, les effluves différeront.
05/03/2022 | Lien permanent | Commentaires (2)
Page : 1






