Rechercher : les grands cerfs
Bruce Chatwin : Le chant des pistes
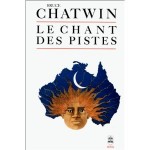 On ne présente plus Bruce Chatwin le fameux écrivain voyageur et de grande culture trop tôt disparu. Tous ses livres sont un pur régal pour ceux qui aiment les voyages, les rencontres et l’aventure, le tout baignant dans des références culturelles nombreuses et enrichissantes.
On ne présente plus Bruce Chatwin le fameux écrivain voyageur et de grande culture trop tôt disparu. Tous ses livres sont un pur régal pour ceux qui aiment les voyages, les rencontres et l’aventure, le tout baignant dans des références culturelles nombreuses et enrichissantes.
Avec Le chant des pistes nous parcourons l’Australie, non pas un pays mais un continent où la trace des premiers hommes interroge l’écrivain sur nos origines. Quant au titre du livre il fait référence à l’enquête menée sur le terrain pour comprendre la théorie des aborigènes qui veut que « lors de sa traversée du pays, chaque ancêtre avait laissé dans son sillage une suite de mots et de notes de musique et comment ces pistes de rêve formaient dans tout le pays des « voies » de communications entre les tribus les plus éloignées. Un chant était à la fois une carte et u topo-guide. Pour peu que vous connaissiez le chant, vous pouviez toujours vous repérer sur le terrain. »
Expert en arts, Bruce Chatwin ne manque pas de s’intéresser aux peintures rupestres et aux tableaux peints par les artistes locaux qui sous un abord naïf recèlent des pans de l’histoire de l’humanité. Un grand livre de voyage mais surtout une ode à l’humanité et une passerelle entre les cultures des quatre coins du monde, dont les similitudes identifiables ne peuvent que prouver nos origines communes.
« Les psychiatres, les politiciens, les tyrans nous assurent depuis toujours que la vie vagabonde est un comportement aberrant, une névrose, une forme d’expression des frustrations sexuelles, une maladie qui, dans l’intérêt de la civilisation, doit être combattue. Les propagandistes nazis affirmaient que les Tsiganes et les Juifs –peuples possédant le voyage dans leurs gènes- n’avaient pas leur place dans un Reich stable. Cependant à l’Est, on conserve toujours ce concept, jadis universel, selon lequel le voyage rétablit l’harmonie originelle qui existait entre l’homme et l’univers. »
 Bruce Chatwin Le chant des pistes Le Livre de Poche
Bruce Chatwin Le chant des pistes Le Livre de Poche
10/10/2012 | Lien permanent
Joan Didion : L’Amérique
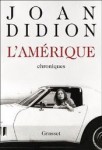 Joan Didion née en 1934 à Sacramento n’était pas très connue en France jusqu’à ces dernières années malgré son talent reconnu aux Etats-Unis, mais ce livre va certainement la faire sortir de son anonymat chez nous.
Joan Didion née en 1934 à Sacramento n’était pas très connue en France jusqu’à ces dernières années malgré son talent reconnu aux Etats-Unis, mais ce livre va certainement la faire sortir de son anonymat chez nous.
Il ne s’agit pas d’un roman, d’ailleurs le sous-titre imprimé sur la couverture est « chroniques » et dans ce genre littéraire, Joan Didion est un maître. A travers une dizaine de textes écrits entre 1960 et 1980, un recueil de reportages, elle nous raconte son Amérique. Car si nous plongeons avec délice dans le San Francisco hippie de 1967 ou si nous rencontrons John Wayne, c’est par le prisme de l’œil de Joan Didion, une Joan Didion flirtant avec ses problèmes psychologiques « Je me fais l’effet d’une somnambule, sensible uniquement à l’étoffe dont sont faits les mauvais rêves ». Les portraits, les réflexions sur l’époque et les lieux qu’elle fréquente sont empreints de cynisme mais néanmoins d’une cruelle lucidité. Les Doors, le groupe de rock, les Black Panthers, la « famille » Manson qui massacre Sharon Tate la femme de Roman Polanski, le meurtre d’une joggeuse dans Central Park à New York, autant de reportages et de regards sur une Amérique qui est en pleine mutation.
Un beau livre, très réaliste, écrit à la première personne, par une écrivaine jamais dupe des évènements qu’elle observe avec acuité, sachant prendre immédiatement le recul nécessaire à l’analyse. J’ai maintenant très envie d’explorer rapidement sa bibliographie.
« Rien de très grave ne pouvait arriver dans le rêve, rien qu’un homme ne pût affronter. Et pourtant. La voilà qui arriva, la rumeur, et au bout d’un moment les grands titres. « J’ai eu la peau du Grand C », annonça John Wayne, à la manière de John Wayne, traitant ces cellules renégates comme n’importe quel autre renégat, et pourtant nous sentions tous que l’issue de cet affrontement-là était pour une fois imprévisible, que c’était le seul et unique duel que Wayne risquait de perdre. »
 Joan Didion L’Amérique (Chroniques) chez Grasset
Joan Didion L’Amérique (Chroniques) chez Grasset
12/10/2012 | Lien permanent
Conte de Noël
 François Édouard Joachim Coppée (1842 – 1908), est un poète, dramaturge et romancier français. Coppée fut le poète populaire et sentimental de Paris et de ses faubourgs, des tableaux de rue intimistes du monde des humbles. Poète du souvenir d'une première rencontre amoureuse, de la nostalgie d'une autre existence ou de la beauté du crépuscule, il rencontra un grand succès populaire.
François Édouard Joachim Coppée (1842 – 1908), est un poète, dramaturge et romancier français. Coppée fut le poète populaire et sentimental de Paris et de ses faubourgs, des tableaux de rue intimistes du monde des humbles. Poète du souvenir d'une première rencontre amoureuse, de la nostalgie d'une autre existence ou de la beauté du crépuscule, il rencontra un grand succès populaire.
C’est à lui que j’ai confié le soin, cette année, de nous fournir notre conte de Noël : Les sabots du petit Wolff.
« Il était une fois, – il y a si longtemps que tout le monde a oublié la date, – dans une ville du nord de l’Europe, – dont le nom est si difficile à prononcer que personne ne s’en souvient, – il était une fois un petit garçon de sept ans, nommé Wolff, orphelin de père et de mère, et resté à la charge d’une vieille tante, personne dure et avaricieuse, qui n’embrassait son neveu qu’au Jour de l’An et qui poussait un grand soupir de regret chaque fois qu’elle lui servait une écuellée de soupe.
Mais le pauvre petit était d’un si bon naturel, qu’il aimait tout de même la vieille femme, bien qu’elle lui fit grand peur et qu’il ne pût regarder sans trembler la grosse verrue, ornée de quatre poils gris, qu’elle avait au bout du nez. Comme la tante de Wolff était connue de toute la ville pour avoir pignon sur rue et de l’or plein un vieux bas de laine, elle n’avait pas osé envoyer son neveu à l’école des pauvres ; mais elle avait tellement chicané, pour obtenir un rabais, avec le magister chez qui le petit Wolff allait en classe, que ce mauvais pédant, vexé d’avoir un élève si mal vêtu et payant si mal, lui infligeait très souvent, et sans justice aucune, l’écriteau dans le dos et le bonnet d’âne, et excitait même contre lui ses camarades, tous fils de bourgeois cossus, qui faisaient de l’orphelin leur souffre-douleur. Le pauvre mignon était donc malheureux comme les pierres du chemin et se cachait dans tous les coins pour pleurer, quand arrivèrent les fêtes de Noël.
La veille du grand jour, le maître d’école devait conduire tous ses élèves à la messe de minuit et les ramener chez leurs parents. Or, comme l’hiver était très rigoureux, cette année-là, et comme, depuis plusieurs jours, il était tombé une grande quantité de neige, les écoliers vinrent tous au rendez-vous chaudement empaquetés et emmitouflés, avec bonnets de fourrure enfoncés sur les oreilles, doubles et triples vestes, gants et mitaines de tricot et bonnes grosses bottines à clous et à fortes semelles. Seul, le petit Wolff se présenta grelottant sous ses habits de tous les jours et des dimanches, et n’ayant aux pieds que des chaussons de Strasbourg dans de lourds sabots. Ses méchants camarades, devant sa triste mine et sa dégaine de paysan, firent sur son compte mille risées ; mais l’orphelin était tellement occupé à souffler sur ses doigts et souffrait tant de ses engelures, qu’il n’y prit pas garde. – Et la bande de gamins, marchant deux par deux, magister en tête, se mit en route pour la paroisse.
Il faisait bon dans l’église, qui était toute resplendissante de cierges allumés ; et les écoliers, excités par la douce chaleur, profitèrent du tapage de l’orgue et des chants pour bavarder à demi-voix. Ils vantaient les réveillons qui les attendaient dans leurs familles. Le fils du bourgmestre avait vu, avant de partir, une oie monstrueuse, que des truffes tachetaient de points noirs comme un léopard. Chez le premier échevin, il y avait un petit sapin dans une caisse, aux branches duquel pendaient des oranges, des sucreries et des polichinelles. Et la cuisinière du tabellion avait attaché derrière son dos, avec une épingle, les deux brides de son bonnet, ce qu’elle ne faisait que dans ses jours d’inspiration, quand elle était sûre de réussir son fameux plat sucré.
Et puis, les écoliers parlaient aussi de ce que leur apporterait le petit Noël, de ce qu’il déposerait dans leurs souliers, que tous auraient soin, bien entendu, de laisser dans la cheminée avant d’aller se mettre au lit ; et dans les yeux de ces galopins, éveillés comme une poignée de souris, étincelait par avance la joie d’apercevoir, à leur réveil, le papier rose des sacs de pralines, les soldats de plomb rangés en bataillon dans leur boîte, les ménageries sentant le bois verni et les magnifiques pantins habillés de pourpre et de clinquant. Le petit Wolff, lui, savait bien, par expérience, que sa vieille avare de tante l’enverrait se coucher sans souper ; mais, naïvement, et certain d’avoir été, toute l’année, aussi sage et aussi laborieux que possible, il espérait que le petit Noël ne l’oublierait pas, et il comptait bien, tout à l’heure, placer sa paire de sabots dans les cendres du foyer.
La messe de minuit terminée, les fidèles s’en allèrent, impatients du réveillon, et la bande des écoliers, toujours deux par deux et suivant le pédagogue, sortit de l’église. Or, sous le porche, assis sur un banc de pierre surmonté d’une niche ogivale, un enfant était endormi, un enfant couvert d’une robe de laine blanche, et pieds nus, malgré la froidure. Ce n’était point un mendiant, car sa robe était propre et neuve, et, près de lui, sur le sol, on voyait, liés dans une serge, une équerre, une hache, une bisaiguë, et les autres outils de l’apprenti charpentier. Éclairé par la lueur des étoiles, son visage aux yeux clos avait une expression de douceur divine, et ses longs cheveux bouclés, d’un blond roux, semblaient allumer une auréole autour de son front. Mais ses pieds d’enfant, bleuis par le froid de cette nuit cruelle de décembre, faisaient mal à voir.
Les écoliers, si bien vêtus et chaussés pour l’hiver, passèrent indifférents devant l’enfant inconnu ; quelques-uns même, fils des plus gros notables de la ville, jetèrent sur ce vagabond un regard où se lisait tout le mépris des riches pour les pauvres, des gras pour les maigres. Mais le petit Wolff, sortant de l’église le dernier, s’arrêta tout ému devant le bel enfant qui dormait.
– « Hélas ! se dit l’orphelin, c’est affreux ! Ce pauvre petit va sans chaussures par un temps si rude... Mais, ce qui est encore pis, il n’a même pas, ce soir, un soulier ou un sabot à laisser devant lui, pendant son sommeil, afin que le petit Noël y dépose de quoi soulager sa misère ! » Et, emporté par son bon cœur, Wolff retira le sabot de son pied droit, le posa devant l’enfant endormi, et, comme il put, tantôt à cloche-pied, tantôt boitillant et mouillant son chausson dans la neige, il retourna chez sa tante.
– « Voyez le vaurien ! s’écria la vieille, pleine de fureur au retour du déchaussé. Qu’as-tu fait de ton sabot, petit misérable ? » Le petit Wolff ne savait pas mentir, et bien qu’il grelottât de terreur en voyant se hérisser les poils gris sur le nez de la mégère, il essaya, tout en balbutiant, de conter son aventure. Mais la vieille avare partit d’un effrayant éclat de rire.
– « Ah ! Monsieur se déchausse pour les mendiants ! Ah ! Monsieur dépareille sa paire de sabots pour un va-nu-pieds !... Voilà du nouveau, par exemple !... Eh bien, puisqu’il en est ainsi, je vais laisser dans la cheminée le sabot qui te reste, et le petit Noël y mettra cette nuit, je t’en réponds, de quoi te fouetter à ton réveil... Et tu passeras la journée de demain à l’eau et au pain sec... Et nous verrons bien si, la prochaine fois, tu donnes encore tes chaussures au premier vagabond venu ! » Et la méchante femme, après avoir donné au pauvre petit une paire de soufflets, le fit grimper dans la soupente où se trouvait son galetas. Désespéré, l’enfant se coucha dans l’obscurité et s’endormit bientôt sur son oreiller trempé de larmes.
Mais, le lendemain matin, quand la vieille, réveillée par le froid et secouée par son catarrhe, descendit dans sa salle basse, – ô merveille ! – elle vit la grande cheminée pleine de jouets étincelants, de sacs de bonbons magnifiques, de richesses de toutes sortes ; et, devant ce trésor, le sabot droit, que son neveu avait donné au petit vagabond, se trouvait à côté du sabot gauche, qu’elle avait mis là, cette nuit même, et où elle se disposait à planter une poignée de verges. Et, comme le petit Wolff, accouru aux cris de sa tante, s’extasiait ingénument devant les splendides présents de Noël, voilà que de grands rires éclatèrent au dehors. La femme et l’enfant sortirent pour savoir ce que cela signifiait, et virent toutes les commères réunies autour de la fontaine publique. Que se passait-il donc ? Oh ! Une chose bien plaisante et bien extraordinaire ! Les enfants de tous les richards de la ville, ceux que leurs parents voulaient surprendre par les plus beaux cadeaux, n’avaient trouvé que des verges dans leurs souliers.
Alors, l’orphelin et la vieille femme, songeant à toutes les richesses qui étaient dans leur cheminée, se sentirent pleins d’épouvante. Mais, tout à coup, on vit arriver M. le curé, la figure bouleversée. Au-dessus du banc placé près de la porte de l’église, à l’endroit même où, la veille, un enfant, vêtu d’une robe blanche et pieds nus, malgré le grand froid, avait posé sa tête ensommeillée, le prêtre venait de voir un cercle d’or, incrusté dans les vieilles pierres. Et tous se signèrent dévotement, comprenant que ce bel enfant endormi, qui avait auprès de lui des outils de charpentier, était Jésus de Nazareth en personne, redevenu pour une heure tel qu’il était quand il travaillait dans la maison de ses parents, et ils s’inclinèrent devant ce miracle que le bon Dieu avait voulu faire pour récompenser la confiance et la charité d’un enfant. »
24/12/2014 | Lien permanent
Tournons la page
Quand j’étais enfant et qu’il était question des années 2000, il s’agissait toujours de projections relevant de la science-fiction, c’est-à-dire de l’inimaginable.
Et puis ce matin, nous sommes en 2023 ! L’incroyable n’est plus qu’une vieille histoire, un souvenir ancien. De jeunes adultes autour de moi n’ont connu que ce siècle. Comment tout cela a-t-il pu advenir ? N’ai-je donc tant vécu que pour cet étonnement ? Me serais-je endormi durant le film ? Hibernatus, Hibernatus ! Pourtant, quand je rembobine le fil de mes souvenirs, tout s’enchaine logiquement, certes des détails m’échappent mais ce trou ne créé pas de malaise ; j’en ai vu des trucs incroyables alors mais tellement banals aujourd’hui : l’arrivée de la télévision dans nos foyers, le premier homme dans l’espace puis l’alunissage ce « grand pas pour l’humanité », le mur de Berlin qui s’effondre et bien plus tard les tours de New York. Le futur et hier se mêlent dans mon esprit, ce grand écart temporel rend désormais crédible à mes yeux ce qu’on nous prédit pour la fin de ce siècle.
Dans l’immédiat, mettons de côté le passé sans l’oublier, ignorons le futur temporairement, ne pensons qu’à aujourd’hui : nous sommes le 1er janvier 2023 et je vous souhaite à tous une très bonne année ! Une page se tourne, une autre s’ouvre, une vieille habitude bien connue pour nous autres lecteurs…
PS : pour des raisons médicales, mais bégnines, il est possible que je sois moins actif sur ce blog durant ce mois mais ce ne sera que passager et pour ne pas laisser le site abandonné, j'ai programmé plusieurs billets par avance...
01/01/2023 | Lien permanent | Commentaires (4)
Julian Barnes : Rien à craindre
 L’écrivain anglais Julian Barnes est né à Leicester en 1946. Après des études de langues et de littérature à l'Université d'Oxford, il travaille comme linguiste pour l'Oxford English Dictionary. Il entreprend une carrière de journaliste avant d’entamer une carrière d’écrivain. Il écrit aussi des romans policiers sous le pseudonyme de « Dan Kavanagh ». Julian Barnes est le seul écrivain étranger à avoir été primé à la fois par le Médicis (en 1986 pour Le perroquet de Flaubert) et le Femina (en 1992 pour Love, etc.).
L’écrivain anglais Julian Barnes est né à Leicester en 1946. Après des études de langues et de littérature à l'Université d'Oxford, il travaille comme linguiste pour l'Oxford English Dictionary. Il entreprend une carrière de journaliste avant d’entamer une carrière d’écrivain. Il écrit aussi des romans policiers sous le pseudonyme de « Dan Kavanagh ». Julian Barnes est le seul écrivain étranger à avoir été primé à la fois par le Médicis (en 1986 pour Le perroquet de Flaubert) et le Femina (en 1992 pour Love, etc.).
Rien à craindre est un hybride entre l’essai et les Mémoires, sous la forme d’un roman dont le sujet central est Dieu etla mort. Dès la première phrase du livre, le ton est donné « Je ne crois pas en Dieu, mais il me manque ».
La soixantaine passée, Julian Barnes commence à envisager la mort, du moins il lui accorde une réflexion plus profonde que lorsqu’il était plus jeune. Evoquer la mort, c’est aussi évoquer Dieu, « les gens ne croient à la religion que parce qu’ils ont peur de la mort ». Selon que l’on est croyant ou pas, l’au-delà n’aura pas le même goût, et même selon les religions il ne se présentera pas de la même façon. Bien différente encore sera l’idée de mort si on ne croit pas, athée ou agnostique verront la fin comme le point ultime dela vie. Maisa-t-on peur de la mort, ou peur de mourir ? Presque tout le monde craint l’une ou l’autre mais pas les deux « c’est comme s’il n’y avait pas assez de place dans l’esprit pour les deux ».
Quand on pense à la mort, le premier réflexe c’est de se rappeler de nos défunts, amis, proches et bien entendu parents. Julian Barnes se souvient de son père et de sa mère, leurs rapports, leurs travers, mais la mémoire est-elle fiable ? Quand il compare ses souvenirs avec ceux de son frère, un célèbre philosophe, les différences d’interprétation ou de mémorisation sont évidentes.
Pour l’aider dans sa tâche et cerner le « problème » de la mort, Julian Barnes fait appel aux écrivains qu’il connaît si bien. Montaigne, Jules Renard, Stendhal, Somerset Maugham, Flaubert bien sûr, Daudet évidemment, d’autres encore viennent nous donner leur version de ce qu’est la mort.
Arrivés à ce point vous devez penser que ce bouquin doit être particulièrement pénible à lire, pour ne pas dire mortel ! Pour être franc, moi-même j’ai eu du mal à entrer dans l’ouvrage, je le trouvais bavard et obligatoirement vain, puisque quoi qu’on dise ou pense de la mort, chacun à sa vérité et personne ne peut vous démentir, pour la bonne raison que nul n’en est revenu pour clore définitivement ce débat qui existe depuis une éternité. Mais Julian Barnes sait y faire, le livre est bien construit, le propos intelligent et étayé des écrits d’illustres écrivains et l’Anglais comme nombre de ses compatriotes, manie l’humour avec subtilité. J’ai d’ailleurs trouvé une certaine ressemblance entre certains passages de ce livre avec celui de son compatriote David Lodge, La Vie en sourdine , et coïncidence, ces deux bouquins sont parus la même année en 2008.
En conclusion, un livre que j’ai eu du mal à entamer mais qui au fil des pages a su fixer mon intérêt grâce à un sujet grave traité avec légèreté et intelligence.
« Mon grand-père avait coutume de se mettre de la brillantine dans les cheveux, et la têtière de son fauteuil Parker Knoll - à haut dossier et joues pleines contre lesquelles il pouvait somnoler - n'était pas seulement décorative. Ses cheveux avaient blanchi plus tôt que ceux de grand-mère; il avait une moustache militaire coupée court, une pipe à tuyau métallique et une blague à tabac qui distendait la poche de son cardigan. Il portait aussi un gros appareil acoustique: un autre aspect du monde adulte - ou plutôt, d'une phase lointaine de la vie adulte - dont mon frère et moi aimions nous moquer. «Pardon?» me criait-il ou lui criais-je satiriquement en mettant une main en coupe à l'oreille. Nous guettions le moment très prisé où l'estomac de grand-maman gronderait assez fort pour que grand-papa perçoive le bruit malgré sa surdité et demande: «Téléphone, Ma?» Après un grognement embarrassé de celle-ci, ils retournaient à la lecture de leurs journaux. Grand-père, dans son fauteuil masculin, son Sonotone sifflant parfois et sa pipe faisant un petit bruit de liquide aspiré quand il tirait dessus, hochait la tête en lisant le Daily Express, qui décrivait un monde où la vérité et la justice étaient constamment mises en péril par la Menace communiste. Dans son fauteuil plus moelleux et féminin - dans le coin rouge -, grand-mère émettait des tss-tss de désapprobation en lisant son Daily Worker, qui décrivait un monde où la vérité et la justice, dans leurs versions actualisées, étaient constamment mises en péril par le Capitalisme et l'Impérialisme. »
 Julian Barnes Rien à craindre Folio
Julian Barnes Rien à craindre Folio
09/10/2012 | Lien permanent
Thomas Bernhard : Un Enfant
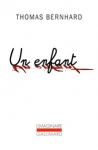 Né en 1931 à Heerlen aux Pays-Bas, Thomas Bernhard est le fils d'un cultivateur autrichien. Il fait ses études secondaires à Salzbourg et suit des cours de violon et de chant, puis de musicologie. Son premier recueil de poèmes paraît en 1957, suivi deux ans plus tard d'un livret de ballet. Il écrit des pièces dont plusieurs sont jouées dans de nombreux pays et en France à partir de 1960. Thomas Bernhard a obtenu en 1970 le prix Georg Büchner, la plus importante récompense littéraire d'Allemagne occidentale. Il est mort en 1989 à Gmunden (Autriche). Un Enfant, paru en 1982, vient d’être réédité.
Né en 1931 à Heerlen aux Pays-Bas, Thomas Bernhard est le fils d'un cultivateur autrichien. Il fait ses études secondaires à Salzbourg et suit des cours de violon et de chant, puis de musicologie. Son premier recueil de poèmes paraît en 1957, suivi deux ans plus tard d'un livret de ballet. Il écrit des pièces dont plusieurs sont jouées dans de nombreux pays et en France à partir de 1960. Thomas Bernhard a obtenu en 1970 le prix Georg Büchner, la plus importante récompense littéraire d'Allemagne occidentale. Il est mort en 1989 à Gmunden (Autriche). Un Enfant, paru en 1982, vient d’être réédité.
Récit autobiographique, Un Enfant, retrace l’enfance de l’écrivain quand il avait une dizaine d’années et vient compléter et achever le cycle formé par L'Origine (1975), La Cave (1976), Le Souffle (1978), Le Froid (1981).
Thomas Bernhard nait discrètement aux Pays-Bas d’une mère célibataire qui ne reviendra à Vienne qu’en 1932 pour le confier d'abord à ses grands-parents. L’enfant passe ses premières années dans la campagne près de Salzbourg. L'influence de son grand-père, l'écrivain Johannes Freumbichler, le marquera toute sa vie. Sa mère se marie en 1936 et deux ans plus tard, ils partent vivre en Bavière, mais ce dépaysement ne lui convient pas et ses résultats scolaires deviennent catastrophiques, il vit alors l'école comme un enfer. Ses grands-parents s'installent dans la région en 1939. En 1942, il fait un séjour dans un centre d'éducation national-socialiste pour enfants en Thuringe, où il est maltraité et humilié. Il est placé dans un internat nazi à Salzbourg en 1943, avant de revenir en Bavière, en 1944, à cause des bombardements alliés.
Un bouquin assez court mais écrit sans chapitres, ni paragraphes, ni sauts de lignes, un bloc compact – une caractéristique du style de l’écrivain - qui enfile avec brio, techniquement parlant, les nombreux évènements qui marquent cette tranche de vie racontée sans que la chronologie soit toujours respectée. Quant à l’écriture, si elle est parfaitement maîtrisée, elle s’autorise de très longues phrases parfois assez tarabiscotées, « Egalement à l’écrivain qu’on appelait un écrivain célèbre, qui vivait à Henndorf, nous allâmes rendre visite. »
Le texte ne s’adresse qu’aux fans de l’écrivain, comme souvent (toujours ?) quand il s’agit d’autobiographie. Ceux-ci, ayant une connaissance de l’œuvre de l’auteur, ne seront pas surpris de constater qu’on ne se marre pas beaucoup à le lire, ce n’est pas le genre de la maison ! C’est pourquoi je n’hésite pas à vous signaler ce mince trait d’humour, quasiment une pépite inespérée, « Au petit matin il apparut que j’avais confondu la porte de l’armoire à linge avec la porte des cabinets, les deux ayant été installées presque de façon semblable. » A la décharge de Thomas Bernhard il faut convenir qu’il n’a pas eu une vie facile non plus, entre une mère qui lui voue un amour/haine ponctué de coups de nerf de bœuf quand il fait des âneries (et il s’y entend), les vexations subies parce qu’il vient d’une famille pauvre ou parce qu’il pisse au lit, son jeune âge ne l’empêche pas de penser au suicide. Seules éclaircies, la compagnie du grand-père écrivain et anarchiste et les quelques succès en course à pied qui lui vaudront des honneurs ponctuels. On ne s’étonnera donc pas, plus tard, de trouver dans ses romans et textes, les traces de sa répugnance pour le monde, « l’abominable odeur d’un monde stupide où l’impuissance et la bassesse sont au pouvoir » et son pessimisme rampant.
Un bouquin que nous réserverons à un public très ciblé et concerné, j’en conviens.
« Mon grand-père avait passé en revue devant moi toutes les possibilités de faire s’effondrer le pont. Avec un explosif on peut tout anéantir, à condition qu’on le veuille. En théorie, chaque jour j’anéantis tout, comprends-tu ? disait-il. En théorie il était possible tous les jours et à tout instant désiré d’anéantir tout, de faire s’effondrer, d’effacer de la terre. Cette pensée, il la trouvait grandiose entre toutes. Moi-même je m’appropriai cette pensée et ma vie durant, je joue avec elle. Je tue quand je veux, je fais s’effondrer quand je veux, j’anéantis quand je veux. Mais la théorie est seulement de la théorie, disait mon grand-père, après quoi il allumait sa pipe. »
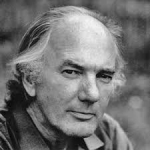 Thomas Bernhard Un Enfant Gallimard L’Imaginaire – 151 pages –
Thomas Bernhard Un Enfant Gallimard L’Imaginaire – 151 pages –
Traduit de l’allemand par Albert Kohn
02/05/2016 | Lien permanent | Commentaires (2)
Henri Bosco : L’Ane Culotte
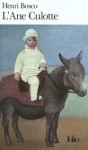 Le romancier Henri Bosco est né à Avignon (1888) et mort à Nice (1976). Chantre du Luberon, humaniste, Bosco aime cette montagne magique pour la simple et unique raison que « les hommes depuis la nuit des temps y ont vécu et souffert ». Ses romans constituent une évocation sensible de la vie provençale où son imagination débordante participe au pouvoir envoûtant de son écriture.
Le romancier Henri Bosco est né à Avignon (1888) et mort à Nice (1976). Chantre du Luberon, humaniste, Bosco aime cette montagne magique pour la simple et unique raison que « les hommes depuis la nuit des temps y ont vécu et souffert ». Ses romans constituent une évocation sensible de la vie provençale où son imagination débordante participe au pouvoir envoûtant de son écriture.
Une fois encore je dois faire mon mea culpa, j’avais toujours pensé que L’Ane Culotte (écrit en 1937) était un roman pour la jeunesse (en raison de son titre) et comme c’était l’un des plus connu de Bosco, j’avais ignoré cet écrivain. Pauvre de moi ! Autant dire que j’ai du pain sur la planche pour rattraper mon retard, au vu de l’œuvre considérable de ce très grand écrivain, couronné du Renaudot pour Le Mas Théotime (1945) entre autres distinctions.
Dans un petit village de Provence, un enfant, Constantin Gloriot, est fasciné par un âne étrange, l'âne Culotte, nommé ainsi parce qu'il porte des pantalons, « À vrai dire, ces pantalons ne recouvraient que ses deux pattes antérieures ». Un jour, Constantin désobéit et suit l'âne jusqu'à sa destination dans la montagne, au cœur d'un domaine secret Belles-Tuiles, où les animaux sauvages vivent sans crainte auprès d'un vieil homme mystérieux, Mr Cyprien.
On ne sait pas grand-chose de cet homme au village où il ne descend jamais, préférant y envoyer son âne pour qu’il en ramène quelques provisions. Seul le curé, l’abbé Chichambre, semble en savoir un peu sur la vie passée de cet étrange paroissien. Inexorablement attiré par ces lieux étranges, Constantin, gamin d’une dizaine d’années, va être entraîné dans une aventure dépassant son entendement.
Mr Cyprien, à l’aide de pouvoirs secrets, a recréé un petit Paradis terrestre autour de son mas. Les plantes et les arbres poussent à foison, les animaux y vivent en harmonie, la paix règne sur ce bout de montagne isolée. Le secret Mr Cyprien, très âgé, a repéré le jeune Constantin au cœur pur, il envisage de lui transmettre ses pouvoirs afin qu’il continue son œuvre. Mais ce nouveau Paradis n’échappera pas à la malédiction du premier, poussé contre son gré par une gamine du village, Constantin y dérobe une branche d’amandier…
J’aurais pu évoquer, grand-mère Saturnine qui régente la maisonnée, La Péguinotte domestique ronchon mais au grand cœur, Anselme le berger, Hyacinthe la petite souillon au rôle mystérieux, les gitans qui campent à proximité du village, tous ces personnages attachants qui peuplent le roman, mais je préfère vous en laisser la découverte.
Je sors de la lecture de ce très beau livre, estomaqué, tant je suis tombé sous le charme de cet écrivain. Tout y est magnifique, la description de la région nous restitue merveilleusement les sensations éprouvées quand on y a séjourné, le chaud soleil, les odeurs de la terre et des plantes, le bruit du vent dans les arbres, le chant des oiseaux. Sur cette terre de lumière, Henri Bosco réussit néanmoins à construire un roman de l’ombre, très vite le mystère plane puis l’étrange nous prend et ne nous lâchera plus. L’écriture est dense, le roman pas si long, on ne peut l’abandonner, on écarquille les yeux à suivre cette aventure merveilleuse qui mêle l’innocence de l’enfance, la sagesse des anciens, le mythe du paradis perdu et les diableries comme on les craint dans les provinces.
A propos de l’oeuvre de Henri Bosco, Raymond Dumay écrivait « Elle ne doit rien à l’école dite américaine qui fait d’un reportage un roman, mais elle nous rappelle l’existence de cette source cachée : l’âme ».
« Noir-Asile, malgré son air de solitude, m’attirait, tant par le secret de son site caché derrière d’énormes buissons de genêts d’or, que par je ne sais quel charme encore humain. Resté seul dans le grand jardin, je ne tardai pas à sentir l’attrait de cette cabane de chiens qui, pendant si longtemps, avait abrité les mystérieux conciliabules d’Hyacinthe avec elle-même. Après l’étrange, l’inoubliable Belles-Tuiles, c’était pour moi l’un des plus graves habitats de l’enfance. J’y revenais plus souvent, et je m’y attardais des heures entières, sans pourtant y entrer. Mais, adossé à ses parois de planches, assis dans l’herbe sèche qui sentait le feu de l’été, j’y reprenais peu à peu avec la terre tiède ce contact de plaisir et d’angoisse dont le souvenir, depuis lors, n’a cessé de troubler ma vie. Car j’aime la terre. »

09/10/2012 | Lien permanent
Ernest Hemingway : Le Vieil homme et la mer
 Ernest Miller Hemingway (1899-1961) est un écrivain, journaliste et correspondant de guerre américain. Il a écrit la plupart de ses œuvres entre le milieu des années 1920 et le milieu des années 1950, et sa carrière a culminé en 1954 lorsqu'il a remporté le prix Nobel de littérature, attribué « pour le style puissant et nouveau par lequel il maîtrise l'art de la narration moderne, comme vient de le prouver Le Vieil Homme et la Mer ». Hemingway est l'un des représentants les plus typiques de ce que l'on a appelé, aux États-Unis, la « génération perdue » dont les principaux écrivains de cette génération sont, outre Hemingway, Ezra Pound, T.S. Eliot et Gertrude Stein. Son roman, Le Vieil homme et la mer, est paru en 1952 et lui vaudra aussi le prix Pulitzer.
Ernest Miller Hemingway (1899-1961) est un écrivain, journaliste et correspondant de guerre américain. Il a écrit la plupart de ses œuvres entre le milieu des années 1920 et le milieu des années 1950, et sa carrière a culminé en 1954 lorsqu'il a remporté le prix Nobel de littérature, attribué « pour le style puissant et nouveau par lequel il maîtrise l'art de la narration moderne, comme vient de le prouver Le Vieil Homme et la Mer ». Hemingway est l'un des représentants les plus typiques de ce que l'on a appelé, aux États-Unis, la « génération perdue » dont les principaux écrivains de cette génération sont, outre Hemingway, Ezra Pound, T.S. Eliot et Gertrude Stein. Son roman, Le Vieil homme et la mer, est paru en 1952 et lui vaudra aussi le prix Pulitzer.
A Cuba, non loin de La Havane, Santiago est un vieux pêcheur, veuf et pauvre, qui n’a rien ramené dans ses filets depuis quatre-vingt-quatre jours. Un gamin qui l’appelle grand-père, l’accompagnait dans ses sorties en mer jusqu’à aujourd’hui, jusqu’à ce que ses parents le place chez un autre pêcheur jugé plus capable et lui permettant de rapporter quelques poissons au logis familial.
Le gosse est désolé, « C’est papa qui m’a fait partir. Je suis pas assez grand. Faut que j’obéisse, tu comprends », car il a beaucoup d’affection pour le vieil homme qui lui apprend la pêche.
Quand Santiago part à nouveau en mer, il se sent seul et vieux, et cette partie de pêche il le devine sera son grand coup ou bien sa fin. Un énorme espadon se prend à sa ligne, « Certains pesaient jusqu’à cinq cents kilos. (…) et le voilà accroché à la plus grosse pièce qu’il ait jamais trouvée. » Ragaillardi par cet heureux coup du sort, Santiago imagine le bénéfice qu’il va tirer de cette prise et la consolation morale de se savoir toujours le bon pêcheur que tous reconnaitront.
S’engage alors un combat héroïque, une de ces histoires de pêche au gros grandiose, comme on aime les conter dans les tavernes de tous les ports du monde. L’homme seul, arc-bouté au fond de son canot, tenant ses lignes, et le poisson gigantesque qui entraîne le tout vers le large. On ne peut s’éviter de penser au Moby Dick d’Herman Melville bien évidemment. Le vieux va en baver, car l’espadon va résister plusieurs jours, mais épuisé par ses efforts et attiré vers le bateau par le pêcheur, le poisson sera harponné et tué.
Le vieil homme semble récompensé de son acharnement et l’on espère que l’aventure est terminée pour lui, mais la vie n’est pas un long fleuve tranquille. « Une heure plus tard, le premier requin attaqua. » Dès lors, une course poursuite va s’engager entre l’homme riche de son gros butin filant vers la terre et les pillards à ailerons toutes dents dehors. « Le vieux compris que tout était fini. »
Si le bouquin venait de paraître, je tairais la fin, mais ce classique de la littérature est connu de tous et a fait l’objet d’un très beau film réalisé en 1958 par John Sturges avec Spencer Tracy dans le rôle du pêcheur.
J’ai dit classique et c’est vrai qu’il s’agit d’un livre immense. Plutôt mince en pagination, mais tellement riche en symboles et paraboles, la victoire dans la défaite, un thème cher à Hemingway. Si Santiago échoue complètement dans sa pêche, ne rapportant au port que la tête et l’arrête dorsale de l’espadon, ne pouvant donc rien en vendre sur le marché, en tant qu’homme il sort vainqueur de cette épreuve, par son colossal effort face à l’adversité, « Un homme, ça peut être détruit, mais pas vaincu. » Ne jamais s’avouer défait, la grande leçon de ce livre.
Il faudrait aussi s’attarder sur le style, des mots simples au service de thèmes grandioses comme la dignité, le respect, la nature toute puissante etc. Cette excellente idée de l’écrivain, faire soliloquer le pêcheur seul en mer pour rendre plus vivant le récit dans ce genre de huis-clos au milieu de l’océan. Suivre l’évolution des pensées du vieil homme, d’abord il capture un poisson qui n’est sensé qu’être un revenu pour lui et de quoi nourrir de nombreux pauvres gens, avant de témoigner d’un grand respect pour cette bête et son combat qui la met à égalité avec l’homme, au point d’en conclure « Y a personne qui mérite de le manger, digne et courageux comme il est, ce poisson-là. »
Jacques-Fernand Cahen dans La Littérature américaine, résume ainsi le roman, « cette fable si savamment composée, si parfaitement écrite, si riche en profonds symboles et d’une si passionnante lecture qu’elle enthousiasme aussi bien les enfants que les esprits les plus blasés. »
On ne saurait mieux dire et si vous ne deviez emporter qu’un seul livre sur une île déserte, c’est bien celui-là !
« Un ouragan, cela se flaire de loin. Si l’on est en mer, on peut observer les signes dans le ciel plusieurs jours à l’avance. « Les gens de la terre ne comprennent rien au ciel, pensait le vieux ; ils le regardent pas comme il faut. Sans compter que les nuages ça n’a pas la même forme vus de la terre ferme. En tout cas, y a pas d’ouragan en route pour le quart d’heure. »
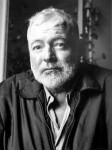 Ernest Hemingway Le Vieil homme et la mer Folio
Ernest Hemingway Le Vieil homme et la mer Folio
13/11/2012 | Lien permanent
Jean-Paul Dubois : La Succession
 Jean-Paul Dubois, né en 1950 à Toulouse, est un écrivain français. Il a suivi des études de sociologie avant d’être journaliste au service des sports de Sud Ouest, au Matin de Paris, puis grand reporter au Nouvel Observateur. Jean-Paul Dubois a publié une quinzaine de romans, un essai, deux recueils de nouvelles et deux recueils d'articles. La Succession son tout nouveau roman vient de paraître.
Jean-Paul Dubois, né en 1950 à Toulouse, est un écrivain français. Il a suivi des études de sociologie avant d’être journaliste au service des sports de Sud Ouest, au Matin de Paris, puis grand reporter au Nouvel Observateur. Jean-Paul Dubois a publié une quinzaine de romans, un essai, deux recueils de nouvelles et deux recueils d'articles. La Succession son tout nouveau roman vient de paraître.
Paul Katrakilis, le narrateur, vit à Miami depuis plusieurs années, depuis qu’il a rompu tout lien avec son père, médecin à Toulouse, dernier membre de sa famille. Il s’est fait une place dans le monde des joueurs professionnels de pelote basque, sa passion et son métier, après avoir abandonné la médecine, cause de son désaccord avec son géniteur. Il vit en Floride une sorte de bonheur, qu’on devine très vite fragile.
Ah ! Ces familles ! Que n’en disent pas les écrivains ! Il faut aussi admettre que chez les Katrakilis, c’est un peu spécial outre le fait que le petit Paul semblait être la cinquième roue du carrosse. Tout le monde vivait dans la grande demeure de Toulouse, le grand-père, le père et la mère de Paul, et le frère de la mère. Le grand-père, Spyridon Katrakilis, un ancien médecin de Staline, se serait enfui d'URSS avec dans ses bagages une lamelle du cerveau du petit père des peuples, ce qui nous vaut un savoureux chapitre sur l’autopsie de Staline ! Il y a aussi l'oncle Jules, et la mère, Anna, qui ont vécu comme mari et femme dans la maison familiale, heu… ? Quant à Adrian Katrakilis, le père, Paul vient d’apprendre son décès et il doit rentrer en France pour s’occuper de la succession. Notons aussi que toutes ces personnes sont décédées par suicide ! Une malédiction familiale ?
Au moins, la couverture du livre ne trompe pas sur son contenu : le titre dit bien de quoi il est question et la photo fait la part belle au jeu de pelote basque. Si vous n’êtes pas familiers de ce sport et de ces « types aux mains d’osier » vous allez pouvoir combler cette lacune, rien ne vous sera caché (épargné ?) de sa pratique à Miami, des people ou des vulgaires qui parient sur les matches, des grandes grèves historiques qui opposèrent les joueurs aux organisateurs… Mais après tout, on n’en sait jamais assez. Je m’attarde sur cet angle du roman, car c’est une composante de l’écriture de Jean-Paul Dubois, il digresse (beaucoup ?), on s’étonne souvent de voir la large place donnée à certains évènements apparemment mineurs au détriment d’autres plus forts en émotions ou développements qui pousseraient à la réflexion ; et pourtant, ces sensations de lecture en cours aboutissent, in fine, à donner du corps (et du cœur) à l’ouvrage. Jean-Paul est de ce bois d’écrivains qui par petites touches discrètes vous tissent des décors crédibles et des personnages ordinaires cachant des aspects peu ordinaires.
Paul aura donc une triste vie, ponctuée de petits moments de bonheur : son copain de pelote à Miami, un chien sauvé des eaux, une Norvégienne beaucoup plus âgée que lui ; par ailleurs, sa découverte dans les papiers de son père, de deux carnets Moleskine, lui fera reconsidérer ce père qu’il avait toujours vu comme « un bloc massif d’indifférence ». Il reprendra même durant plusieurs années, l’activité de médecin en rouvrant le cabinet du père. Mais tout roman a une fin et chez les Katrakilis elle est connue d’avance.
Un joli roman, sans esbroufe dans l’écriture ou les sujets abordés. Il y est beaucoup question de mort, de celle que l’on se choisit, de celle que certains peuvent donner à d’autres pour les soulager de leur souffrance extrême. Jean-Paul Dubois est un élégant, dans l’écriture comme dans les sentiments qui se dégagent de son ouvrage doux amère, ce que les habitués de l’auteur ne seront pas étonnés de retrouver ici.
« Enfant, je grandis donc devant Spyridon qui marinait devant sa tranche de cervelet, un père court vêtu vivant comme un célibataire, et une mère quasiment mariée à son propre frère qui aimait dormir contre sa sœur et devant les litanies de la télévision. Je ne savais pas ce que je faisais parmi ces gens-là et visiblement, eux non plus. (…) Le plus étrange, c’est que la mort traversa à plusieurs reprises notre maison et les survivants s’en aperçurent à peine, la regardant passer comme une vague femme de ménage. »
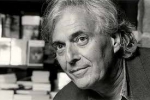 Jean Paul Dubois La Succession Editions de l’Olivier – 234 pages –
Jean Paul Dubois La Succession Editions de l’Olivier – 234 pages –
« Sur l’enveloppe je reconnus aussitôt la graphie de mon père. A l’intérieur, deux photos. Sur la première, son cabriolet Triumph Vitesse MK2 de 1969 vu de côté. Sur la seconde, un cliché très net en plan rapproché de son compteur kilométrique, en fait des miles, où l’on lisait « 77777 ». Rien d’autre. Pas le moindre mot. » (p.22)

29/08/2016 | Lien permanent | Commentaires (2)
Howard Fast : La Dernière frontière
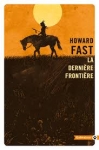 Howard Fast (1914-2003) est un romancier et scénariste américain. Il a également signé des romans policiers sous le pseudonyme de E.V. Cunningham. Howard Fast s'intéresse très tôt à la pensée de Karl Marx et devient membre d'une association d'écrivains proche du Parti communiste américain. Un voyage dans le Sud des Etats-Unis lui permet de constater la grande pauvreté résultant de la Grande Dépression et lui confirme le bien-fondé de son engagement politique. En 1974, Howard Fast s'installe en Californie où il collabore avec le milieu de la télévision par l'écriture de scénarios et vivra de sa plume jusqu'à sa mort en 2003. Passionné par l'histoire américaine, il utilisera ce matériau dans de nombreux romans dont La Dernière Frontière qui sera publié en 1941.
Howard Fast (1914-2003) est un romancier et scénariste américain. Il a également signé des romans policiers sous le pseudonyme de E.V. Cunningham. Howard Fast s'intéresse très tôt à la pensée de Karl Marx et devient membre d'une association d'écrivains proche du Parti communiste américain. Un voyage dans le Sud des Etats-Unis lui permet de constater la grande pauvreté résultant de la Grande Dépression et lui confirme le bien-fondé de son engagement politique. En 1974, Howard Fast s'installe en Californie où il collabore avec le milieu de la télévision par l'écriture de scénarios et vivra de sa plume jusqu'à sa mort en 2003. Passionné par l'histoire américaine, il utilisera ce matériau dans de nombreux romans dont La Dernière Frontière qui sera publié en 1941.
1878. Les Cheyennes sont chassés des Grandes Plaines et parqués en Territoire indien, aujourd’hui l'Oklahoma. Sur ces terres hostiles où règnent poussière et chaleur torride, les Cheyennes assistent à l'extinction programmée de leur peuple. Jusqu'à ce que trois cents d'entre eux, hommes, femmes, enfants, menés par leur vieux chef Little Wolf, décident de s'enfuir pour retrouver leur terre sacrée des Black Hills dans le Wyoming. Un périple fou, de près de mille-six-cents kilomètres durant plusieurs mois, de l’Oklahoma en passant par le Kansas et le Nebraska, du soleil de plomb aux températures polaires, avec à leurs trousses douze-milles hommes de l’armée et de la milice civile…
Roman, mais récit tiré d’une histoire bien réelle, issue de sources avérées, ce bouquin - ce très grand livre - est depuis bien longtemps devenu un classique de la « question Indienne » : L'arrivée des Européens en Amérique du Nord à partir du XVIème siècle provoqua d'importantes conséquences sur les Amérindiens. Leur nombre s'effondra à cause des maladies, des guerres et des mauvais traitements, leur mode de vie et leur culture subirent des mutations. Avec l'avancée de la Frontière (la ligne marquant la zone limite de l'implantation des populations d'origine européenne dans le contexte de la conquête de l'Ouest, c’est l'un des concepts historiques majeurs des Etats-Unis) et la colonisation des Blancs américains, ils perdirent la majorité de leur territoire, furent contraints d'intégrer des réserves. J’ai lu beaucoup de livres, romans ou non, sur le sort dramatique des peuples Amérindiens, celui-ci est l’un des meilleurs d’autant qu’il bénéficie, par rapport à d’autres, de son antériorité, un temps où il n’était pas de bon ton de la ramener sur ce sujet.
Que dire à ceux qui ne l’ont pas encore lu pour qu’ils s’y précipitent ? Sur la forme, on peut parler de western : une poignée d’Indiens quitte sa réserve sans autorisation, déclarant clairement qu’ils préfèrent retourner sur la terre de leurs ancêtres à leurs risques et périls, plutôt que crever en silence, de chaleur et de faim, ici en Oklahoma. L’armée envoie quelques hommes pour les rattraper, n’y arrive pas, gonfle ses effectifs, toujours en vain. Escarmouches, morts, climat épouvantable, squelettes ambulants, la tribu persévère dans sa remontée vers le Nord et la troupe des armées n’y peut rien. La force ridiculisée par la ruse opiniâtre de ceux qui n’ont rien à perdre, ceux qui sont déjà quasi morts.
Howard Fast ne laisse guère de place à la sentimentalité, l’extraordinaire puissance de sa prose simple suffit pour terrasser le lecteur. On sent que l’écrivain s’attache à raconter les faits, la vérité crue et insoutenable. Les dialogues sont la seule part romancée de l’affaire. Mêmes les tourments psychologiques des hommes en bleu semblent justes et réels. Tous les officiers ne réagissent pas de la même façon face à la situation, pour certains « un bon Indien est un Indien mort », pour d’autres la cruauté de la poursuite les trouble : d’un côté leur uniforme leur dicte de faire respecter la loi et les règlements mais de l’autre, ils ont bien conscience que les Indiens agissent pour une juste cause…
On a parlé de la forme, quant au fond, il y est question de liberté ou d’esclavage, de mourir libre ou de vivre sous le joug et dans quelles conditions atroces. Et plus largement, d’aborder ce débat intemporel, le sort réservé aux minorités, « pourquoi un groupe minoritaire dans notre République ne peut-il légalement occuper le pays qu’il a habité pendant des siècles ? »
Un roman qui prend aux tripes et laisse le lecteur k.o. les larmes aux yeux, je n’ai pas honte de l’avouer.
« Le vieux chef laissa lentement retomber ses mains. Son visage couleur de terre se creusa d’un sourire mi de pitié, mi de regret. Nu jusqu’à la ceinture, sans armes, il se présentait à cheval devant l’impartial jugement de l’Histoire. Il appartenait au passé, à un passé mort qui ne revivrait jamais plus, et il le savait. Deux siècles de guerres cruelles et sanguinaires entre Peaux-Rouges et Blancs atteignaient, semblait-il, leur point culminant dans ce face-à-face des deux antagonistes : le capitaine Murray, vêtu de la poussiéreuse tenue bleue, et le vieux chef cheyenne, à demi nu. Pourtant Murray n’éprouvait rien d’autre qu’une sombre colère – colère qui englobait sa propre personne, Little Wolf, ses hommes et toutes les forces qui l’avaient conduit pendant ces deux jours de poursuite folle. »
 Howard Fast La Dernière frontière Gallmeister Totem – 269 pages-
Howard Fast La Dernière frontière Gallmeister Totem – 269 pages-
Traduit de l’américain par Catherine de Palaminy
On trouve une photo du chef Little Wolf en page 52 du magnifique ouvrage Pieds nus sur la terre sacrée de T.C. McLuan (textes) et Edward S. Curtis (photos) paru chez Denoël (1974). Un autre livre incontournable sur ce sujet.
Et pour information : « Little Wolf deviendra plus tard un scout pour l'armée américaine sous le général Nelson Miles. Il est impliqué dans une discussion mouvementée sur une de ses filles, qui aboutit à la mort de Starving Elk. Prétendument, Little Wolf était intoxiqué quand il le tua au Poste de Commerce d'Eugenie Lamphere le 12 décembre 1880. Little Wolf entame alors un exil volontaire à la suite de ce déshonneur. Il finit sa vie à la réserve des Cheyennes du Nord où il meurt en 1904. George Bird Grinnell, un ami proche et ethnographe qui a documenté la vie de Little Wolf, a dit de lui qu'il était « le plus grand Indien qu'il ait jamais connu » ».
06/04/2020 | Lien permanent | Commentaires (4)


