Rechercher : les grands cerfs
Tim Gautreaux : Nos disparus
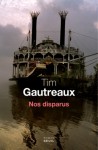 Timothy Martin Gautreaux, né en 1947 à Morgan City en Louisiane où il vit toujours, est le fils d'un capitaine de remorqueur. Professeur émérite d'anglais à la South Eastern Louisiana University, il est l'auteur d’un premier roman, Le Dernier Arbre en 2013, et de nouvelles publiées par The Atlantic Monthly, GQ, Harper's Magazine et The New Yorker. Son nouveau roman, Nos disparus, vient tout juste de paraître.
Timothy Martin Gautreaux, né en 1947 à Morgan City en Louisiane où il vit toujours, est le fils d'un capitaine de remorqueur. Professeur émérite d'anglais à la South Eastern Louisiana University, il est l'auteur d’un premier roman, Le Dernier Arbre en 2013, et de nouvelles publiées par The Atlantic Monthly, GQ, Harper's Magazine et The New Yorker. Son nouveau roman, Nos disparus, vient tout juste de paraître.
Sam Simoneaux, dont la famille a été massacrée quand il avait six mois, débarque en France avec l’armée américaine le jour de l’Armistice de la Grande Guerre. On l’envoie déminer les champs de bataille de l’Argonne durant quelques mois. Rentré à La Nouvelle-Orléans où il est devenu responsable d’étage aux grands magasins Krine, Sam ne peut empêcher l’enlèvement de Lily Weller, une gamine de trois ans. Licencié, sommé par les parents de retrouver leur enfant, il embarque comme troisième lieutenant à bord de l’Ambassador, bateau à aubes qui organise des excursions sur le Mississippi.
Sam est un garçon plutôt banal, élevé par son oncle dans le respect de la vie humaine, il n’aime pas la violence, d’un caractère doux et posé, emprunt de sagesse ou de bon sens, il mène sa vie comme il peut, c'est-à-dire comme un bouchon sur les flots, ce que l’écriture de Tim Gautreaux rend très bien, le ton est léger et la narration se déroule à un rythme de croisière (sic !), sans heurts. Pour autant, le récit ne manque pas d’aventures et de rebondissements, l’écrivain mariant, la vie à bord de ces bateaux montant ou redescendant le fleuve au son d’un orchestre de jazz, s’arrêtant de ville en ville pour faire le plein de clients, bouseux des campagnes prêts à s’alcooliser et s’étriper ou bien notables en goguette c’est selon, avec l’enquête de Sam qui s’étirera sur presqu’une année.
Le pauvre Sam devra jongler avec sa vie personnelle, marié, un enfant mort très jeune, un salaire de misère, le questionnement de ses collègues s’étonnant qu’il n’ait jamais eu l’idée de retrouver ceux qui avaient massacré ses parents, et la vie des autres, les parents de la petite fille enlevée musiciens sur l’Ambassador et les catastrophes dramatiques qui vont s’enchaîner, conséquences plus ou moins lointaines de l’enlèvement.
Tim Gautreaux, le plus simplement du monde, sans utiliser de grands mots ou concepts, aborde le problème de la vengeance, cette vendetta qui n’en finit jamais, et son inanité : « Et même si j’arrivais à me venger, tu peux être sur qu’il y en aurait un qui s’en tirerait, et avant deux ans, il débarquerait chez moi par une belle nuit pour nous attendre, tapi dans les broussailles, le couteau entre les dents. » Quand son enquête sur l’enlèvement et sa quête de vérité sur le massacre dont il a réchappé se rejoindront, Sam, incarnation de la bonté, saura prendre les décisions justes et sans lâcheté, dans le respect des valeurs qui lui ont été inculquées.
Un bon roman dont le plus grand attrait réside dans la tendresse profonde de l’auteur pour tous ses personnages, s’alliant à la perfection avec le rythme et le style de l’écriture. Aucune fausse note pour cette partition de jazz tirant plutôt vers le blues.
« Il sentit à sa posture qu’elle venait de prendre conscience que les gens disparaissaient soudain d’une façon qu’elle ne pouvait pas comprendre. Elle se mit à pleurer doucement, mais il devinait qu’elle aurait été incapable de dire ce qui la rendait triste. On lui avait expliqué que son père était parti au paradis, puis que sa mère était allé le rejoindre, et rien de tout cela n’avait vraiment de sens pour elle parce qu’elle vivait dans l’éternel présent de l’enfance où les divers mouvements de l’existence suffisent à vous occuper, et où passé et futur n’existent même pas. Il en était malade pour elle, mais pour lui-même aussi parce que la fragile petite épaule qu’il tenait dans sa paume aurait pu être celle de sa propre sœur ou de son propre frère, et il se sentit accablé par la conscience plus forte de la perte qu’il avait subie avant de savoir ce que le mot « perte » signifiait. »
 Tim Gautreaux Nos disparus Seuil - 541 pages –
Tim Gautreaux Nos disparus Seuil - 541 pages –
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Marc Amfreville
07/09/2014 | Lien permanent | Commentaires (4)
Philip Roth : J’ai épousé un communiste
 Philip Roth est né le 19 mars 1933 à Newark, dans le New Jersey, son œuvre couronnée de multiple prix en fait l’un des plus grands écrivains américains contemporains. Aujourd’hui il vit dans le Connecticut et en octobre 2012 il a déclaré à la presse qu’il arrêtait d’écrire. Paru en 2001, J’ai épousé un communiste, fait partie du cycle Nathan Zuckerman, et plus précisément de la Trilogie américaine, entre Pastorale américaine (1999) et La Tache (2002).
Philip Roth est né le 19 mars 1933 à Newark, dans le New Jersey, son œuvre couronnée de multiple prix en fait l’un des plus grands écrivains américains contemporains. Aujourd’hui il vit dans le Connecticut et en octobre 2012 il a déclaré à la presse qu’il arrêtait d’écrire. Paru en 2001, J’ai épousé un communiste, fait partie du cycle Nathan Zuckerman, et plus précisément de la Trilogie américaine, entre Pastorale américaine (1999) et La Tache (2002).
J’ai déjà lu une quinzaine de romans de l’auteur - et j’ai bien l’intention de tous les lire -, vous pouvez en conclure que c’est l’un de mes écrivains favoris, or, à ma plus grande stupéfaction j’ai eu de grosses difficultés avec ce livre. Deux fois je l’ai ouvert, deux fois je l’ai abandonné, le rapportant à ma bibliothèque. Cette fois-ci, je me suis obstiné mais ce fut douloureux…
Nathan Zuckerman, le narrateur, retrouve l’un de ses anciens professeurs, Murray Ringold, aujourd’hui un vieil homme prêt à bien des révélations sur le passé de son frère Ira, décédé, « Je suis la seule personne encore en vie qui sache l’histoire d’Ira, et toi tu es la seule personne encore en vie qui t’y intéresses »). Ira, le mentor de Nathan quand il était adolescent, vedette de radio et époux d’Eva Frame une ancienne gloire du cinéma muet.
Nathan qui croyait bien connaitre Ira va en apprendre de belles sur la vraie personnalité de cet homme au parcours chaotique débuté sur les chantiers, puis vedette de la radio et époux d’une star de cinéma. Ira, un homme broyé entre sa vie privée, ses problèmes de couple entre sa femme et sa belle-fille, elles-mêmes se trimballant leurs ennuis, et son lourd secret, être communiste dans l’Amérique des années 50 à l’époque du Maccarthysme où pendant deux ans (1953-1954), la commission présidée par McCarthy traqua d'éventuels agents, militants ou sympathisants communistes aux Etats-Unis dans une ambiance de chasse aux sorcières.
De nombreux thèmes sont abordés dans ce roman, le poids de l’Histoire écrasant les individus, la difficile situation des minorités (Juifs et/ou communistes), la trahison des proches (« C’est que la trahison se trouvait déstigmatisée et même récompensée comme jamais dans ce pays »). Ou, comme le dit Roth dans Le Monde (23 avril 1999) : « … un livre peuplé, tout comme la vie, d’imbéciles, de naïfs et de braves gens, arrêtés net dans leur réussite, victimes des pièges tendus par leur pays et leur époque, et par l’irréductible goût de l’espèce humaine pour la trahison et la vengeance. »
Le roman est dense, trop à mon goût au début (cent premières pages ?) ce qui explique mon renoncement par deux fois. Par la suite cela s’arrange, j’ai mieux suivi la narration, même si là aussi, on peut peiner quand on ne connait pas (ou ne se souvient plus) très bien de tous les acteurs et faits politiques de l’époque. Je critique beaucoup mais il y a bien entendu de nombreuses pages éblouissantes, tant par l’angle scénaristique que par la profondeur des analyses. Quand même !
Philip Roth n’a jamais écrit de mauvais romans mais celui-ci, en raison du début complexe, ne m’a pas vraiment emballé. En tout cas, je ne le conseille pas à qui n’a jamais encore ouvert un roman de l’écrivain.
« L’un des privilèges du Juif américain, c’est qu’il pouvait se permettre de donner libre cours à sa colère en public comme Ira le faisait ; d’être agressif dans ses convictions, de ne laisser aucune insulte invengée. On n’était pas obligé de hausser les épaules et de se résigner. On n’était pas obligé de museler ses réactions. Être américain à sa manière propre ne posait plus de problème. Il était permis de se montrer au grand jour pour faire valoir ses arguments. C’est une des plus grandes choses que l’Amérique ait donnée aux Juifs, ça, leur colère. (…) L’Amérique, c’était le paradis des Juifs en colère. Le Juif timoré existait encore, mais on n’était pas obligé d’adopter ce rôle-là si on n’en voulait pas. »
 Philip Roth J’ai épousé un communiste Gallimard – 405 pages –
Philip Roth J’ai épousé un communiste Gallimard – 405 pages –
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Josée Kamoun
19/04/2017 | Lien permanent | Commentaires (8)
Joseph Kessel : Le Coup de grâce
 Joseph Elie Kessel dit Joseph Kessel, est un aventurier, journaliste, reporter, aviateur et romancier français, membre de l'Académie française, né en 1898 en Argentine et mort en 1979 en France. En tant que journaliste Kessel appartient à la grande équipe qu’avait réunie Pierre Lazareff à Paris-Soir, et qui a fait l’âge d’or des grands reporters. Correspondant de guerre pendant la guerre d'Espagne, puis durant la « drôle de guerre », il rejoint après la défaite la Résistance avec son neveu Maurice Druon et c’est avec lui qu’il écrit le Chant des partisans. C’est également avec celui-ci qu’il franchit clandestinement les Pyrénées pour gagner Londres et s’engager dans les Forces aériennes françaises libres du général de Gaulle. A la Libération, il reprend son activité de grand reporter. Il est l'un des journalistes qui assistent au procès du maréchal Pétain en juillet-août 1945, et plus tard au procès de Nuremberg, pour le compte de France-Soir. Ses multiples voyages le conduisent en Palestine, en Afrique, en Birmanie, en Afghanistan etc. et nourriront son œuvre littéraire qui compte de très nombreux romans, comme Le Lion (1958) ou Les Cavaliers (1967). Le Coup de grâce qui vient de reparaître en collection de poche, date de 1932.
Joseph Elie Kessel dit Joseph Kessel, est un aventurier, journaliste, reporter, aviateur et romancier français, membre de l'Académie française, né en 1898 en Argentine et mort en 1979 en France. En tant que journaliste Kessel appartient à la grande équipe qu’avait réunie Pierre Lazareff à Paris-Soir, et qui a fait l’âge d’or des grands reporters. Correspondant de guerre pendant la guerre d'Espagne, puis durant la « drôle de guerre », il rejoint après la défaite la Résistance avec son neveu Maurice Druon et c’est avec lui qu’il écrit le Chant des partisans. C’est également avec celui-ci qu’il franchit clandestinement les Pyrénées pour gagner Londres et s’engager dans les Forces aériennes françaises libres du général de Gaulle. A la Libération, il reprend son activité de grand reporter. Il est l'un des journalistes qui assistent au procès du maréchal Pétain en juillet-août 1945, et plus tard au procès de Nuremberg, pour le compte de France-Soir. Ses multiples voyages le conduisent en Palestine, en Afrique, en Birmanie, en Afghanistan etc. et nourriront son œuvre littéraire qui compte de très nombreux romans, comme Le Lion (1958) ou Les Cavaliers (1967). Le Coup de grâce qui vient de reparaître en collection de poche, date de 1932.
Hippolyte Bibard, sergent cassé de grade, est envoyé à Beyrouth pour une mission inconnue. Là, il rencontre le commandant Féroud, alias Mehemet Pacha. Homme mystérieux et secret, Féroud règne sur un réseau immense à travers tout le Moyen-Orient d’où émanent des ordres implacables exécutés par une armée invisible. Entre les deux hommes naît une relation de chef à subordonné assez trouble basée sur une amitié profonde. Jusqu’au jour où Hippolyte séduit Violette, une jeune libanaise de petite vertu entraineuse dans un club tenu par l’un de ses amis, or la gamine est aussi la maîtresse cachée de Féroud.
Roman psychologique centré sur Hippolyte, un fort en gueule à la moralité douteuse, « un vrai mec » à la redresse qui va passer de la subjugation pour Féroud, à la haine puis à l’amitié rédemptrice envers cet homme qui le fascine.
L’écriture est énergique, l’intrigue file à belle allure mais disons-le clairement, le roman a terriblement vieilli. Trop même. Difficile d’accepter aujourd’hui cette virilité excessive, ce machisme outrancier, ce jeu de rôles trop daté, cette psychologie trop lourdingue sur le fond et la forme. A l’époque ça pouvait certainement être accepté, l’exotisme (Orient, haschisch, monde interlope) et cet angle sexuel et trouble (une sorte de ménage à trois avec une gosse de quinze ans, un beau mec viril, un amant plus âgé gaga d’amour) mais écrit comme ça l’est ici ça ne passe plus. Seul le grand âge de ce roman peut éventuellement s’attirer notre mansuétude polie… ?
« Le sergent se mit à marcher au hasard. Une colère homicide l’étouffait. Tout lui revenait en même temps à la mémoire : sa rencontre avec Mehemet, la peur qu’il avait dès lors ressentie, le respect qu’il avait eu pour lui, ce voyage dans le Horan où il l’avait presque aimé, les vexations quotidiennes acceptées depuis le retour, l’humiliation dernière. Et il ne savait plus ce qui le poignait davantage : des insultes de Mehemet ou de sa propre lâcheté. Il aurait voulu qu’un même coup les écrasât l’un l’autre pour mettre fin à la fois à sa haine pour Féroud et à son mépris pour lui-même. »
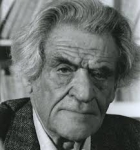 Joseph Kessel Le Coup de grâce Folio – 221 pages –
Joseph Kessel Le Coup de grâce Folio – 221 pages –
21/02/2017 | Lien permanent
Qu’est-ce qu’un bon roman ?
Vous lisez mes chroniques, vous en écrivez peut-être et vous comme moi en venons, à la conclusion de nos billets, par déclarer que tel roman est bon ou mauvais. Mais qu’entend-on par « bon » roman ?
Comme toujours, chacun placera le curseur sur l’échelle des valeurs au niveau qui lui conviendra en fonction de ses goûts et attentes. Néanmoins, j’imagine qu’il existe un seuil de consensus permettant d’affirmer que ce livre est bon et celui-ci mauvais. J’aimerais, par ce billet, que nous puissions dégager ce minimum requis pour pouvoir le déclarer.
Pour moi, un bon roman doit associer une bonne histoire avec une écriture à la hauteur, du moins est-ce la première idée me venant à l’esprit. Mais ce n’est pas si simple, évidemment. Ma seule certitude, un bon bouquin ne peut pas être mal écrit. Eventuellement dans ce cas, il nous fera passer un moment agréable mais il ne pourra jamais être qualifié de « bon » roman. Inversement, un roman très bien écrit, ne suffit pas pour en faire un bon roman.
Une bonne histoire, c'est-à-dire un bon scénario, est-ce réellement impératif ? J’en suis moins certain à la réflexion. J’accepte qu’il ne se passe rien, à proprement dit, si l’aspect psychologique doit primer. Deux types assis face à face dans un fauteuil et discutant tout du long, peuvent faire un excellent roman. Par contre je ne tolère pas les scénarios sans queue ni tête avec des scènes ridicules, sauf s’ils doivent servir à exprimer humour, dérision ou critique. Du coup la notion de « bonne histoire » me paraît moins importante que prévue et plus floue.
Histoire et écriture, mais il faudrait y ajouter un troisième critère – qui peut être facultatif mais qui ne fera qu’accentuer la beauté de l’ouvrage s’il est présent -, une thématique en arrière plan, à savoir une vision d’écrivain, une fiction insérée dans un contexte social ou se référant aux mœurs d’une époque. Avec le risque d’obtenir un roman trop daté.
Nous voilà bien. A ce point de l’enquête nous n’avons pas avancé d’un iota ! Il faut du style, oui ; un minium d’histoire, peut-être ; un arrière-plan sociologique pour y mettre de l’intelligence, pourquoi pas. Notre cocktail est particulièrement complexe à élaborer car il s’avère que tout dépend du dosage.
Devons-nous en conclure que la recette du « bon roman » n’existe pas ? Personnellement, c’est un peu ce que j’espère car s’il suffisait de s’y référer pour écrire un bon bouquin, la littérature perdrait tout ce qui fait son charme.
Je vous donne ici l’avis de James Salter, tiré d’une interview donnée au magazine Lire d’octobre : « Nous savons tous reconnaitre un grand livre mais personne ne sait exactement pourquoi il est grand. Ce qui est certain, c’est que ce n’est pas un livre à message, ni un livre à connotation politique, par exemple. Ces derniers peuvent être de bons livres s’ils collent aux obsessions de l’époque, mais c’est insuffisant pour en faire de grands livres. (…) Quoi alors ? Le style ? Je ne crois pas non plus que ce soit suffisant : il y a des livres superbement écrits mais d’un ennui terrible. Je crois que ce qui peut signaler au lecteur un grand livre est la voix de l’écrivain. Certains écrivains sont aphones, d’autres ont une voix. Qui peut expliquer pourquoi ? C’est ainsi. »
Si vous avez un avis sur la question, n’hésitez pas à venir apporter votre contribution au débat, nous sommes tous, j’en suis certain, curieux d’entendre d’autres voix.
31/10/2014 | Lien permanent | Commentaires (4)
Paul Morand : Eloge du repos
 Né à Paris en 1888, Paul Morand commence en 1913 une carrière de diplomate qui le conduira aux quatre coins du monde. Révoqué après la seconde guerre mondiale, il est rétabli dans ses fonctions d'ambassadeur en 1953 et mis à la retraite des Affaires étrangères en 1955. Elu à l'Académie française en 1968 il décède à Paris en 1976. Considéré comme l’un des pères du « style moderne » en littérature, il s'est imposé comme l'un des grands écrivains français du siècle dernier. Eloge du repos date de 1937, un texte assez court, genre d’essai, écrit rapidement après l’adoption de la loi sur les congés payés par le gouvernement du Front Populaire.
Né à Paris en 1888, Paul Morand commence en 1913 une carrière de diplomate qui le conduira aux quatre coins du monde. Révoqué après la seconde guerre mondiale, il est rétabli dans ses fonctions d'ambassadeur en 1953 et mis à la retraite des Affaires étrangères en 1955. Elu à l'Académie française en 1968 il décède à Paris en 1976. Considéré comme l’un des pères du « style moderne » en littérature, il s'est imposé comme l'un des grands écrivains français du siècle dernier. Eloge du repos date de 1937, un texte assez court, genre d’essai, écrit rapidement après l’adoption de la loi sur les congés payés par le gouvernement du Front Populaire.
Paul Morand assoit sa réflexion sur un constat simple : si on apprend un métier, on devrait aussi apprendre à se reposer et à prendre des vacances ! Et Morand s’y connait en « vacances » puisque ce petit bouquin a été écrit après onze ans de voyages autour du monde, entre sa mise en congé du quai d’Orsay (1926) peu avant son mariage avec la riche princesse Soutzo et son retour à la diplomatie (1938).
L’oisiveté doit s’apprendre, le repos véritable est dans la tête et tout l’argent du monde n’y changera rien, le repos de l’esprit ou de l’âme ne s’achète pas. L’auteur donne des conseils aux Français lorsqu’ils voyagent à l’étranger (ils ont des devoirs). Les temps libres permettent aussi la pratique de sports ou d’activités physiques (un esprit sain dans un corps sain). Mais la grande vérité reste dans « la vie intérieure, maîtresse de notre vrai repos. »
Je ne vais pas vous vendre ce bouquin comme étant exceptionnel ou à lire toutes affaires cessantes, néanmoins le lecteur qui s’y penchera sera étonné par la modernité de son écriture et surtout de son contenu qui reste souvent d’actualité. J’ai souligné un nombre invraisemblable de phrases ou coché des paragraphes me laissant pantois d’étonnement devant leur aspect visionnaire. Seule critique, au détour d’une phrase ou d’une autre, un nationalisme discret peut agacer le lecteur…
Réflexions sur les Français (« Il craint de ne pouvoir s’adapter au lendemain parce qu’en effet il a l’adaptation lente ; de là sa peur de l’avenir qui n’est qu’un excès de doute en face de tout devenir »), sur la mode (« dont on croit qu’elle invente, tandis qu’elle ne fait que s’adapter puis surenchérir »), sur son époque (« Notre époque est asphyxiée par la peur »), le monde littéraire (« les auteurs ont peur de la critique, les critiques ont peur des éditeurs, les éditeurs ont peur du lecteur et le lecteur a peur du miroir grimaçant que lui tendent les auteurs »), sur l’éducation scolaire… Quant aux voyageurs d’aujourd’hui, « Si les gens, actuellement, se déplacent tant, c’est qu’ils son malheureux : d’où les voyages d’agrément. » Enfin, sans condamner la vitesse, ce qui serait malvenu de la part de cet homme pressé ( !), il nous met en garde néanmoins contre elle, « puisque la mort c’est l’immobilité, le mouvement c’est la vie ; d’où beaucoup concluent que la grande vitesse, c’est la grande vie. »
Ce texte est loin d’être le plus connu de Paul Morand mais si vous tombez dessus n’hésitez pas à y jeter un œil : il se lit très vite et vous serez très étonné/amusé par sa clairvoyance et son actualité.
« Le Français souffre, car il se raidit et il se raidit parce qu’il refuse de laisser aller les choses ; il croit que ce qui arrive depuis quelques milliards d’années a été inventé spécialement pour le contrarier ; et dans ce monde hostile, il entend chevaucher seul l’évènement ; c’est un cavalier qui récuse tout contact avec sa monture et qui ne veut pas se poser sur le sol par l’entremise de ce socle vivant ; au lieu de s’asseoir, il se redresse, s’érige, réclame, raisonne ; il ne sait pas se mettre en boule, il ne sait pas se mouvoir selon des lignes courbes, il ne sait que marcher droit et il en est fier. »
 Paul Morand Eloge du repos Arléa – 125 pages –
Paul Morand Eloge du repos Arléa – 125 pages –
11/11/2016 | Lien permanent | Commentaires (4)
Dan O’Brien : Wild Idea
 Dan O'Brien est un écrivain américain né en 1947 dans l’Ohio. Fauconnier, éleveur, il est aussi professeur de littérature, d’écologie et spécialiste des espèces en voie de disparition. Il vit dans un ranch situé au pied des Black Hills dans le Dakota du Sud.
Dan O'Brien est un écrivain américain né en 1947 dans l’Ohio. Fauconnier, éleveur, il est aussi professeur de littérature, d’écologie et spécialiste des espèces en voie de disparition. Il vit dans un ranch situé au pied des Black Hills dans le Dakota du Sud.
Son nouvel ouvrage, Wild Idea, vient de paraître et Dan O’Brien reprend le thème déjà exploité en 2007 dans Les Bisons de Broken Heart. Son dernier récit n’est pas vraiment la suite de l’autre, il s’agit plutôt d’une nouvelle approche, ce qui parfois peut donner l’impression d’un déjà lu – mais relire du Dan O’Brien n’est ni une corvée, ni une punition, loin de là.
Défenseur de la Nature, O’Brien l’est et le prouve en s’investissant complètement dans ses combats. Dans Rites d’automne (1991) c’est le faucon pèlerin qui mobilisait ses forces, depuis il s’est attelé à relancer le peuplement en bisons des Grandes Plaines en s’appuyant sur un raisonnement simple, les bisons sont une source de viande d’excellente qualité pour les hommes, moins riche en cholestérol que le bœuf par exemple, et les bisons régénèrent le sol et la flore des Grandes Plaines ; donc faire prospérer les bisons est bon pour l’homme et la Nature ! L’entreprise de Dan O’Brien, nommée Wild Idea, consistera à élever des bisons sans hormones ni antibiotiques se nourrissant d'herbe pour fournir de la viande vendue par correspondance. Les bêtes sont abattues sur place, dans la prairie, grâce à un abattoir mobile qui évite tout stress aux animaux – les bisons sont « moissonnés » selon le joli terme employé par l’écrivain.
Le récit va nous entraîner dans une aventure, écologique, économique et tellement humaine aussi. C’est l’un des points forts de l’auteur de savoir marier plusieurs thèmes sans jamais nous ennuyer ou s’éterniser trop sur certains aspects. L’aventure écologique on l’a comprise ; l’aventure économique s’est de se lancer dans un projet grandiose qui demande de l’ambition, du cran et un développement constant avec vision à long terme, ce qui nécessite fatalement la recherche de capitaux ; et l’aventure humaine, elle est multiple, outre qu’elle sera menée au fil des années par Dan, sa compagne Jill et sa fille Jilian avec son ami, mais il y a aussi son vieux pote Erney que nous connaissons déjà (Les Bisons de Broken Heart) ou bien des rencontres avec des clients de l’entreprise, des investisseurs, des indiens lakota avec leurs traditions…
Tout est magnifique dans ce récit. Les longs périples sur les routes américaines, les paysages majestueux, la beauté rude des bisons. Un vrai film. Le lecteur a la sensation d’avoir ouvert en grand toutes ses fenêtres et de ressentir la caresse du vent dans ses cheveux. Mais il n’y a pas que cela, il y a de splendides pages regorgeant d’émotion, quand son ami Erney fait un AVC ou quand on voit Jilian passer d’enfant à femme, ou bien ces scènes avec ses chevaux, le vieux en fin de vie et le jeune qu’il faut débourrer et je ne vous parle pas du destin dramatique des chiens…
Le seul reproche qu’on puisse faire à ce bouquin, si tant est qu’on ose s’y risquer, c’est que par pudeur ou par nature, Dan O’Brien ait tendance à arrondir les angles et taire la dureté de sa vie, ou du moins à ne pas insister, ou de se laisser aller à un peu d’emphase de-ci, de-là. Enfin, c’était juste pour dire. Dan O’Brien est un grand écrivain et ce bouquin un pur ravissement.
« Puis Rocke s’est tourné pour faire face à la sombre ligne de bisons, à un kilomètre dans le sens du vent. Il a commencé à tambouriner et à chanter pour eux en lakota. Comme tant d’autres mœurs de cette tribu, le son lugubre et scandé de leur musique épousait parfaitement le paysage. Ca m’a donné des frissons dans la nuque mais ça m’a également rassuré. Connaissant Rocke comme je l’avais connu, j’entendais le chant d’une vie difficile, mêlée aux herbes dans le vent, aux oiseaux et aux saisons qui passaient. Je ne comprenais pas un mot mais les bisons avaient l’air de parfaitement savoir ce dont Rocke parlait. Au loin, les bosses noires se sont tournées et ont commencé, très lentement, à s’avancer vers nous. »
 Dan O’Brien Wild Idea Au Diable Vauvert – 395 pages –
Dan O’Brien Wild Idea Au Diable Vauvert – 395 pages –
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Walter Gripp
08/06/2015 | Lien permanent | Commentaires (2)
Pramoedya Ananta Toer : La Fille du Rivage
 Pramoedya Ananta Toer (1925-2006) est né sur l’île de Java. Après avoir été emprisonné par le gouvernement colonial hollandais de 1947 à 1949, il est envoyé en 1965, sous la dictature de Suharto, au bagne de Buru, dont il sort en 1979 sous la pression internationale. Grand humaniste, fidèle à ses idéaux jusqu’à la fin de sa vie en 2006, il est surveillé et systématiquement censuré. Son œuvre est immense avec plus de cinquante romans, nouvelles et essais, traduits dans près de quarante langues. La Fille du Rivage, datant de 1962, traduit chez nous en 2004, vient d’être réédité en poche. Pour la petite histoire, ce roman qui s’étale sur plusieurs années, est inspiré de la vie de la grand-mère de l’écrivain.
Pramoedya Ananta Toer (1925-2006) est né sur l’île de Java. Après avoir été emprisonné par le gouvernement colonial hollandais de 1947 à 1949, il est envoyé en 1965, sous la dictature de Suharto, au bagne de Buru, dont il sort en 1979 sous la pression internationale. Grand humaniste, fidèle à ses idéaux jusqu’à la fin de sa vie en 2006, il est surveillé et systématiquement censuré. Son œuvre est immense avec plus de cinquante romans, nouvelles et essais, traduits dans près de quarante langues. La Fille du Rivage, datant de 1962, traduit chez nous en 2004, vient d’être réédité en poche. Pour la petite histoire, ce roman qui s’étale sur plusieurs années, est inspiré de la vie de la grand-mère de l’écrivain.
A Java au début du XIXème siècle, colonie hollandaise. L’héroïne n’est jamais nommée, sauf par son surnom, Gadis Pantai (« La fille du rivage » en indonésien). Quatorze ans et fille d’un modeste pêcheur a été demandée en mariage par un riche chef de la région (un Bendoro). « Demandée » est une façon de parler car elle n’a pas vraiment le choix. Passer de son petit village où le minimum vital vous fait passer pour un rupin, au palais du Bendoro relève du changement de dimension. Une ascension sociale qui débute comme un conte de fée. Qui débute seulement…
La jeune fille va devoir s’acclimater à son nouvel environnement où elle doit tout apprendre. Le protocole, les prières (Coran) ou s’habituer à avoir une servante. Une vieille femme qui lui sera d’un grand secours tant qu’elle sera à ses côtés, une bonne âme qui comprend le désarroi de l’enfant et vient du même milieu social qu’elle. Il faut reconnaitre qu’en ce début de roman, le Bendoro n’est pas un méchant homme. Souvent absent pour ses affaires, il offre des cadeaux à son épouse et ne la rudoie pas. Au point qu’après cette période d’apprentissage, Gadis Pantai en vient à s’attacher à lui, presque jalouse quand il part plusieurs jours pour ses missions. Mais toujours, ses parents lui manquent, tout comme son village où la vie est si différente et si simple.
Jusque là on pourrait dire que tout se passe relativement bien pour la jeune fille mais bien entendu elle va devoir déchanter et je vous laisse le découvrir en vous cachant un évènement très important. Le final est particulièrement déchirant autant pour Gadis Pantai que pour le lecteur ; la tradition locale associée au pouvoir des nobles sur les pauvres va laminer notre pauvre héroïne qui va se retrouver seule au monde : éjectée du palais car répudiée par son maître (elle n’était qu’une épouse de pacotille, un noble ne pouvant réellement se marier avec une femme de condition inférieure) et elle-même abandonnant sa famille pour ne pas rentrer humiliée au village.
Finalement, La Fille du Rivage n’aura jamais vécu. Par la faute involontaire de ses parents qui espéraient par ce mariage la sortir de sa condition de pauvre, par la faute des traditions du pays avec ces mariages arrangés où une enfant peut être « vendue » et servir d’épouse temporaire à un homme riche et puissant.
C’est bien écrit, agréable à lire, et même si ce n’est pas le type de romans que je préfère, il est plutôt réussi. Seule vraie critique ou remarque : la longue séquence du retour au village avec les pirates et le mariage entre un local et une jeune femme accompagnant Gadis Pantai m’a semblé assez farfelue !? Mais vous me connaissez, il faut toujours que je relève un truc négatif…
« La servante avait grande envie de mettre en garde la jeune femme, mais elle n’osa pas. Elle eut peur. Elle savait bien que le Bandoro pouvait changer de première dame trente-six fois par jour sans que son autorité en soit le moins du monde affectée. Elle savait qu’un jour ou deux après avoir mis au monde son premier enfant, cette jeune femme innocente s’engagerait peut-être sur la même route qu’elle et la suivrait, sans le moindre doute : une vie d’esclave. Et cette jeune mère souffrirait plus qu’elle, parce qu’elle aurait un enfant mais devrait s’en aller sans lui. Elle ne pourrait pas le revoir. Et, si elle le revoyait, ce ne serait pas son enfant, mais celui du Bendoro, l’homme qu’elle devrait vénérer et servir. »
 Pramoedya Ananta Toer La Fille du Rivage Folio – 339 pages –
Pramoedya Ananta Toer La Fille du Rivage Folio – 339 pages –
Traduit de l’indonésien par François-René Daillie
16/10/2017 | Lien permanent
Philippe Manœuvre : Rock
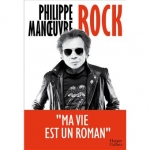 Philippe Manœuvre, né en 1954 à Sainte-Menehould (Marne), est un journaliste français, critique musical et éditorialiste dans la presse écrite, il est également animateur d'émissions de télévision et de radio et scénariste de bandes dessinées.
Philippe Manœuvre, né en 1954 à Sainte-Menehould (Marne), est un journaliste français, critique musical et éditorialiste dans la presse écrite, il est également animateur d'émissions de télévision et de radio et scénariste de bandes dessinées.
Bien que fan de rock moi-même, j’ai longtemps hésité à ouvrir cet ouvrage, une autobiographie du célèbre journaliste Philippe Manœuvre. Nous sommes de la même génération, celle du baby-boom, quoi que je sois son aîné d’une paire d’années, alors que pouvait-il m’apprendre que je ne sache déjà, son parcours m’étant tellement familier ?
Ses débuts dans la vie et de sa passion pour cette musique correspondent à ma propre expérience, d’ailleurs nous allions aux mêmes adresses acheter nos disques (L’Open Market de Marc Zermati aux Halles pour les bootlegs), nous étions tous deux au festival d’Auvers-sur-Oise en 1971, nous avons assisté aux mêmes concerts de ces fabuleuses années (Les Stones à Bruxelles en 1973) et nous sommes de grands admirateurs de ces Rolling Stones… mais si moi j’ai vécu dans l’anonymat, Manœuvre (que je ne connais pas personnellement qu’on se le dise) est devenu la figure emblématique du journaliste français, spécialiste du rock.
Philippe Manœuvre, dit Philman, c’est surtout Rock&Folk, le fameux magazine que je lis toujours depuis le premier numéro (1966), où il officiera entre 1973 et 2017 (avec une coupure de 1983 à 1990), date de sa retraite. Le type a tout fait, tout vu et porté plusieurs casquettes : dans le désordre, il a travaillé dans la presse écrite à Métal Hurlant, Les Nouvelles Littéraires, Playboy, Libération… pour la radio France Inter ou RTL… pour la télévision aussi sur Antenne 2 (dois-je rappeler « Les Enfants du Rock » ou « Sex Machine » dans les années 80), Canal+, Canal Jimmy et M6.
Outre le rock, Manœuvre s’est beaucoup investi dans la BD ainsi que dans l’édition avec sa collection Speed 17 aux Humanoïdes, nous permettant de découvrir pour la première fois en France, Charles Bukowski, Hunter Thomson ou Hubert Selby ou milieu des années 70. Là encore je lui dis merci !
Le bouquin ne s’attarde pas tellement sur les groupes rock étrangers, comment pourrait-il en être autrement, il les a presque tous vus et interviewés aux quatre coins du monde, par contre il consacre un chapitre complet à Gainsbourg très réussi, un à Johnny Hallyday et un autre, à l’une de ses idoles, Michel Polnareff.
Sur lui-même, il n’hésite pas à révéler son alcoolisme passé (durant 25 ans !), sa consommation de drogues et sa situation familiale. A ma grande surprise et déception dois-je dire, j’ai appris qu’il avait un intérêt pour le mysticisme, genre tarot divinatoire, sorciers… et qu’il aurait vu un OVNI !!! Peut-être sont-ce les séquelles des excès cités précédemment ?
Pour conclure, un bouquin sympa – mais sans plus – pour un public ciblé. Seule vraie déception, je l’ai trouvé beaucoup moins bien écrit que prévu, comparé à ses articles lus dans la presse depuis tant d’années… Mais Manœuvre restera toujours l’enfant du rock, son héraut à l’enthousiasme communicatif pour nous autres Français amoureux de cette musique.
« C’est le début de la collection Speed 17. On va faire très vite des bouquins (speed), on va essayer d’en faire dix-sept. Robial est ok pour nous imaginer une maquette novatrice. Pour lancer la collection, il faut frapper fort. Je réussis à convaincre le rédacteur en chef de Rock&Folk, Philippe Paringaux, de traduire un livre sur la tournée US des Rolling Stones, STP de Robert Greenfield. Nous en vendrons quatorze mille. Mais l’autre grande trouvaille de la collection, c’est Bukowski. Déniché par Philippe Garnier, journaliste à Rock&Folk et grand ami à moi, Bukowski est un phénomène. Personne n’a osé le traduire en français. Les éditions Grasset ont acheté un titre, mais l’éditeur est perplexe. Il trouve ça trop cru, trop sexe, trop alcoolisé. Philippe Garnier accepte de traduire Notes of a Dirty Old Man que nous proposons en français, sous le titre de Mémoires d’un vieux dégueulasse. Le livre parait en 1977, année punk. »
 Philippe Manœuvre Rock Harper Collins – 281 pages – Avec un cahier photos -
Philippe Manœuvre Rock Harper Collins – 281 pages – Avec un cahier photos -
12/11/2018 | Lien permanent | Commentaires (2)
Jean-Philippe Blondel : Un Hiver à Paris
 Jean-Philippe Blondel, né à Troyes en 1964, est un écrivain français. Tout en enseignant l'anglais dans un lycée près de Troyes depuis les années 1990, il mène en parallèle une carrière d'écrivain, en littérature générale comme en jeunesse. Dans une œuvre déjà conséquente, Un Hiver à Paris date de 2014.
Jean-Philippe Blondel, né à Troyes en 1964, est un écrivain français. Tout en enseignant l'anglais dans un lycée près de Troyes depuis les années 1990, il mène en parallèle une carrière d'écrivain, en littérature générale comme en jeunesse. Dans une œuvre déjà conséquente, Un Hiver à Paris date de 2014.
Victor, le narrateur de dix-neuf ans, est en prépa littéraire dans un lycée parisien des années 80, lui le provincial un peu perdu dans cette grande ville, pas très doué pour se faire des amis. Une ombre pour ses voisins de classe et professeurs mais alors qu’il entame de timides débuts de camaraderie avec Mathieu, celui-ci se suicide sous ses yeux en se jetant du haut d’un escalier dans l’enceinte du lycée…
Un évènement dramatique qui va conditionner le reste de la vie de notre narrateur. Au sein de l’établissement, l’ombre devient un pôle d’attraction, tout le monde pense que Victor et Mathieu étaient de bons amis, une imposture qui perturbe Victor, lui déplait mais en même temps n’est pas sans bénéfices puisqu’on s’intéresse à lui. Paul Rialto, le sage distant entouré d’une cour d’admirateurs, se rapproche de notre héros, une amitié se crée entre le fils de riches et notre modeste provincial, l’inconnu secret se livre et découvre des aspects de sa personnalité ; même une fille s’intéresse à Victor ! Une grande nouveauté pour lui, une liaison nait avec Armelle.
Et puis il y a Patrick, le père de Mathieu, au comble du désespoir. Son couple est en berne, son fils est décédé, il veut savoir, il veut comprendre, et lui aussi croit que seul Victor peut l’éclairer, étant le meilleur ami de son fils. Une étrange relation se noue entre les deux hommes, Patrick se confie à Victor, le vieux prend un adolescent comme confident ! Et Victor, voit dans cet homme, une sorte de père plus écoutant que le sien.
Cet évènement va conforter Victor dans le choix de son avenir, réaliser son rêve secret, devenir écrivain. Une fois encore Blondel met une part plus ou moins grande (je n’ai pas cherché à savoir dans quelle proportion) de sa propre existence dans ce roman.
Comment et pourquoi un jeune homme parti pour faire des études secondaires se suicide-t-il ? Quelle est la part des parents, si elle existe, dans ce drame ? Quel est le rôle de la solitude dans cette tragédie ? Des solitaires, à des degrés divers, tentent d’éclairer l’affaire : Victor, Patrick, Paul…
Le roman est agréable à lire, l’écriture de Jean-Philippe Blondel crée une ambiance ouatée où le lecteur peut reprendre le propos d’un acteur du livre « J’étais sur des rails. Je me laissais conduire. » Il y a aussi de très bons moments mais globalement, le roman m’a paru moyen, desservi (pour moi) par instants par des dialogues peu naturels ou mal torchés.
« - Mes parents sont adeptes du Grand Livre du mois parce que le représentant qui leur a vendu l’abonnement est un cousin de mon père. Ils reçoivent un roman par trimestre. Ils ne savent pas quoi en faire, alors ils ont acheté un petit meuble vitré en merisier et ils y emprisonnent vite le livre dès qu’il arrive. Je leur ai plusieurs fois suggéré d’arrêter les frais, mais ils ont peur, ils disent que ça doit être compliqué de se désabonner, il faut rédiger des courriers, et puis, c’est bien, les livres, quand on a un littéraire dans la famille, non ? – Tu as honte d’eux ? »
 Jean-Philippe Blondel Un Hiver à Paris Buchet-Castel – 268 pages -
Jean-Philippe Blondel Un Hiver à Paris Buchet-Castel – 268 pages -
05/07/2021 | Lien permanent | Commentaires (4)
Ivan Tourgueniev : Un bretteur
 Ivan Sergueïevitch Tourgueniev est un écrivain, romancier, nouvelliste et dramaturge russe né en 1818 à Orel en Russie et mort en 1883 à Bougival dans les Yvelines. Son père, officier supérieur, est issu d'une grande famille aristocratique d'origine tatare et sa mère, d'une famille de noblesse de service d'Orel est une riche propriétaire terrienne. C’est dans la propriété familiale que Tourgueniev s'initie à la chasse et à la nature, laquelle nature joue un grand rôle dans ses romans. Confié à des précepteurs russes et étrangers dont il reçoit une excellente éducation, il apprend le français, l’allemand, l’anglais, le grec et le latin. Avec un serf, il commence à écrire ses premiers poèmes. Très tôt, il se rend compte de l’injustice des hommes des classes supérieures envers les serfs, injustice contre laquelle il se révoltera et se battra toute sa vie. Son œuvre compte sept romans, une douzaine de pièces de théâtre, de la poésie et de très nombreuses nouvelles comme celle-ci, parue en 1847.
Ivan Sergueïevitch Tourgueniev est un écrivain, romancier, nouvelliste et dramaturge russe né en 1818 à Orel en Russie et mort en 1883 à Bougival dans les Yvelines. Son père, officier supérieur, est issu d'une grande famille aristocratique d'origine tatare et sa mère, d'une famille de noblesse de service d'Orel est une riche propriétaire terrienne. C’est dans la propriété familiale que Tourgueniev s'initie à la chasse et à la nature, laquelle nature joue un grand rôle dans ses romans. Confié à des précepteurs russes et étrangers dont il reçoit une excellente éducation, il apprend le français, l’allemand, l’anglais, le grec et le latin. Avec un serf, il commence à écrire ses premiers poèmes. Très tôt, il se rend compte de l’injustice des hommes des classes supérieures envers les serfs, injustice contre laquelle il se révoltera et se battra toute sa vie. Son œuvre compte sept romans, une douzaine de pièces de théâtre, de la poésie et de très nombreuses nouvelles comme celle-ci, parue en 1847.
Russie méridionale en 1829. Un régiment de cuirassier est cantonné dans un bourg. Deux hommes qu’a priori tout oppose deviennent amis : Loutchkov, le plus âgé, petit et laid, d’un naturel taciturne, inspirant la crainte autour de lui pour ses velléités de duelliste va se lier avec Kister, un jeune officier cultivé et élégant, dans l’armée par devoir plus que par passion. Les distractions sont rares dans le coin mais lors d’une réception chez un petit notable local, Macha, la fille de leur hôte, va venir perturber leur belle amitié…
Ivan Tourgueniev, en peu de pages, va développer l’évolution psychologique ou amoureuse entre ces trois personnages. Une grande tendresse amicale entre Kister et Macha dans un premier temps, puis le jeune homme et le lecteur réalisent que la proximité entre ceux-là résulte de la curiosité de la femme pour Loutchkov. Pourquoi ne s’intéresse-t-il pas à elle ? Quelle est sa vraie personnalité ? Le mystère est toujours attirant. Obligée de prendre les choses en main, Macha force sa chance et obtient un rendez-vous avec Loutchkov, avec la bénédiction de Kister qui souhaite tout le bien possible à son ami.
L’âme humaine est ainsi faite que rien n’est jamais simple et les points marqués par Loutchkov réveillent la jalousie de Kister qui réalise qu’il aime Macha. L’amitié entre les deux hommes s’effiloche et ce qui devait arriver, arrivera…
Un très bon texte du grand écrivain Russe : court, concis mais précis dans les descriptions des personnages ou des lieux, suffisamment évocateur lors des mises en situation avec une belle étude de caractères. Une lecture recommandée.
« Nénila Makarievna jeta à son mari un regard froid. Serge Serguéïtch tripota sa chaine de montre avec un certain embarras, prit sur la table son chapeau anglais à larges bords et partit vaquer aux soins du domaine. Son chien sortit derrière lui en courant, l’allure timide et humble. En animal intelligent qu’il était, il sentait que son seigneur et maître n’était pourtant pas dans la maison une autorité considérable, et il observait une conduite modeste et prudente. Nénila Makarievna s’approcha de sa fille, lui releva doucement la tête et la regarda dans les yeux avec tendresse. « Tu me le diras, quand tu seras amoureuses ? » demanda-telle. Macha baisa la main de sa mère avec un sourire, et hocha la tête plusieurs fois en signe d’affirmation. »
 Ivan Tourgueniev Un bretteur La Pléiade Romans et nouvelles complets Tome 1 – 49 pages –
Ivan Tourgueniev Un bretteur La Pléiade Romans et nouvelles complets Tome 1 – 49 pages –
Traduction par Françoise Flamant
18/04/2018 | Lien permanent


